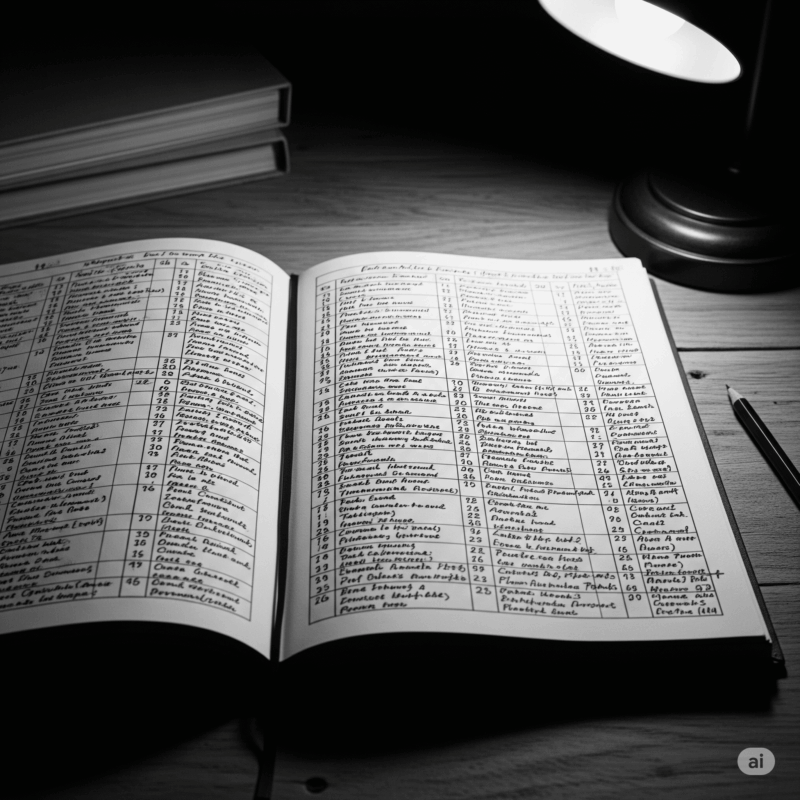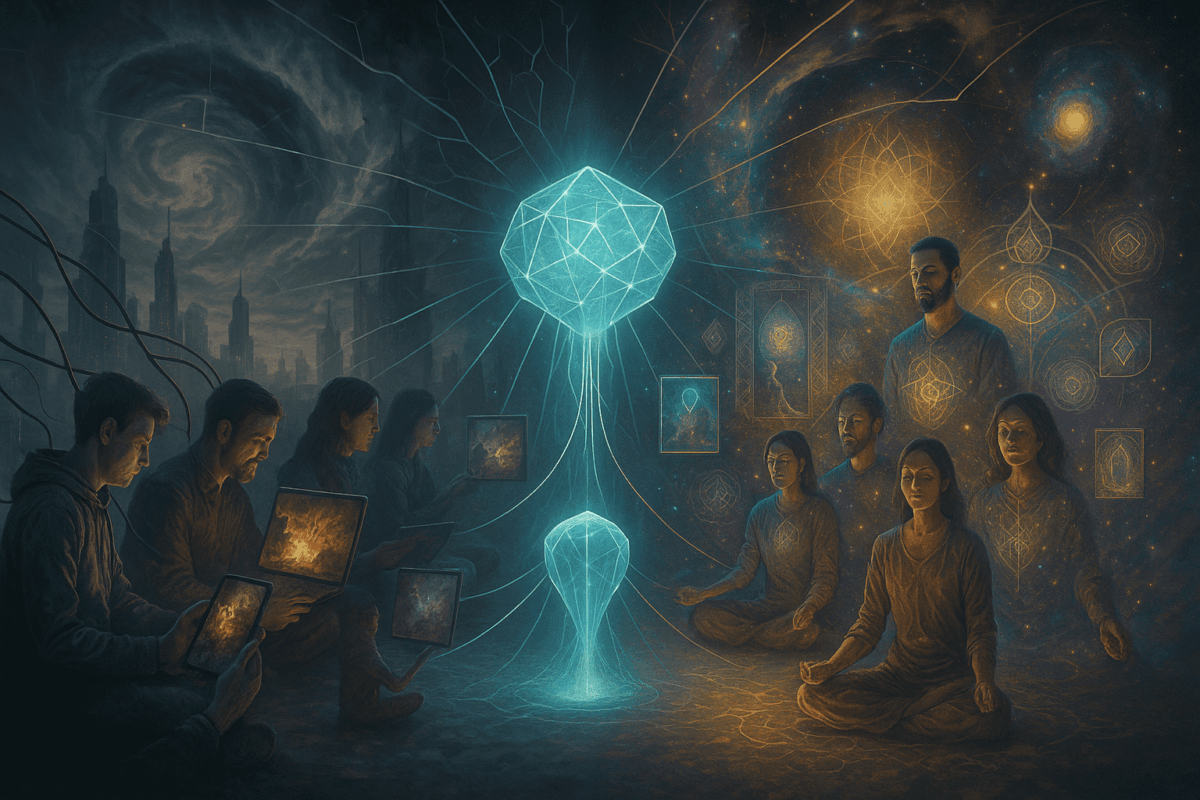Dans le premier numéro de ce journal, l’intentionnalité a été définie comme « l’acte tacite de combler les espaces vides laissés par la perception sensorielle directe, ou l’acte d’enrichir les phénomènes observables au moyen de l’intention ». Cette définition est une tentative de s’éloigner des explications philosophiques standard de l’intentionnalité. Le concept d’intentionnalité est d’une importance capitale pour élucider les thèmes de la sorcellerie, en tant que sujets authentiques du discours philosophique. L’orientation proposée pour ce journal — l’herméneutique appliquée — s’exprime à travers la révision et la réinterprétation de thèmes pertinents à la discipline de la philosophie ; thèmes qui sont congruents avec d’autres thèmes pertinents à la discipline de la sorcellerie.
Dans la discipline de la philosophie, l’intentionnalité est un terme utilisé pour la première fois par les Scolastiques au Moyen Âge pour définir, en termes de mouvement naturel et non naturel, l’intention de Dieu par rapport à sa création et le libre arbitre de l’homme de choisir ou de rejeter une vie vertueuse ; les Scolastiques étaient des érudits d’Europe occidentale qui ont développé un système d’enseignements théologiques et philosophiques basé sur l’autorité des Pères de l’Église et d’Aristote et de ses commentateurs.
Le terme intentionnalité a été restructuré à la fin du XIXe siècle par Franz Brentano, un philosophe allemand, dont la principale préoccupation était de trouver une caractéristique qui sépare les phénomènes mentaux des phénomènes physiques. Il a dit : « Tout phénomène mental est caractérisé par ce que les Scolastiques du Moyen Âge appelaient l’inexistence intentionnelle ou mentale d’un objet, et ce que nous aimerions appeler la référence à un contenu, la directivité vers un objet, qui dans ce contexte ne doit pas être comprise comme quelque chose de réel. Dans la représentation, quelque chose est représenté ; dans le jugement, quelque chose est reconnu ou rejeté ; dans le désir, quelque chose est désiré. Cette inexistence intentionnelle est propre uniquement aux phénomènes mentaux. Aucun phénomène physique ne montre rien de tel. Et ainsi, nous pouvons définir les phénomènes mentaux en disant que de tels phénomènes contiennent des objets en eux-mêmes par le biais de l’intentionnalité. »
La compréhension de Brentano était que la propriété de tous les phénomènes mentaux est de contenir des objets en tant qu’inexistants, combinée à la propriété de se référer à ces objets. Par conséquent, pour lui, seuls les phénomènes mentaux contiennent l’intentionnalité. Ainsi, l’intentionnalité devient la caractéristique irréductible des phénomènes mentaux. Il soutenait que, puisque aucun phénomène physique ne pouvait contenir l’intentionnalité, le mental (l’esprit) ne peut pas provenir du cerveau.
Dans la discipline de la sorcellerie, il existe une entrée appelée l’appel de l’intention (calling intent). Elle fait référence à la définition de l’intentionnalité qui a été donnée dans ce journal : « l’acte tacite de combler les espaces vides laissés par la perception sensorielle directe, ou l’acte d’enrichir les phénomènes observables au moyen de l’intention. » Les sorciers soutiennent, comme Brentano l’a pressenti, que l’acte d’intenter (intending) n’appartient pas au domaine du physique ; c’est-à-dire qu’il ne fait pas partie de la physicalité du cerveau ou de tout autre organe. L’intention (intent), pour les sorciers, transcende le monde que nous connaissons. C’est quelque chose comme une vague énergétique, un faisceau d’énergie qui s’attache à nous.
(Carlos Castaneda, Un Journal d’Herméneutique Appliquée)