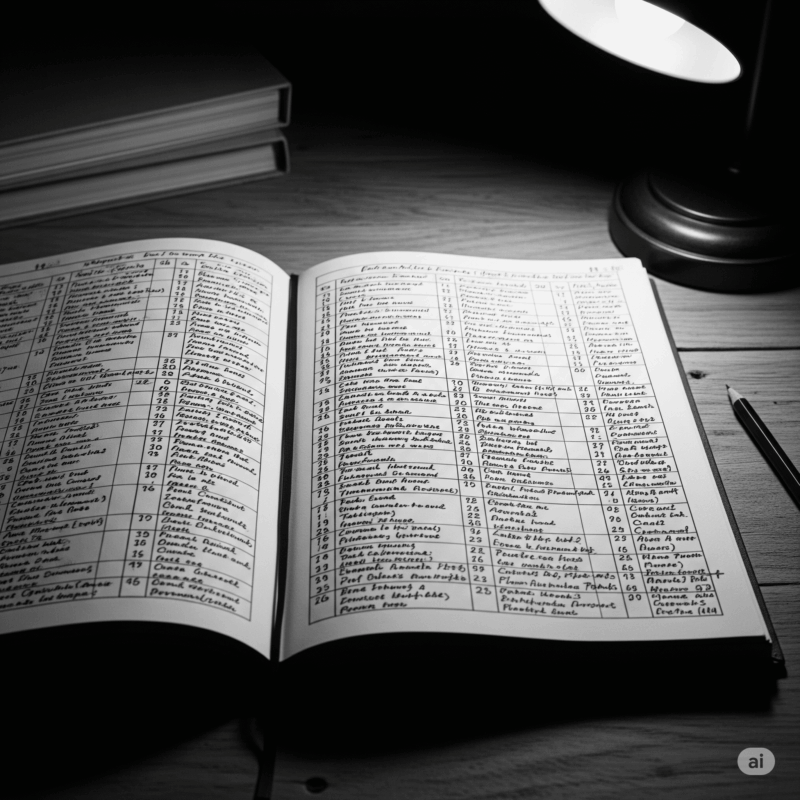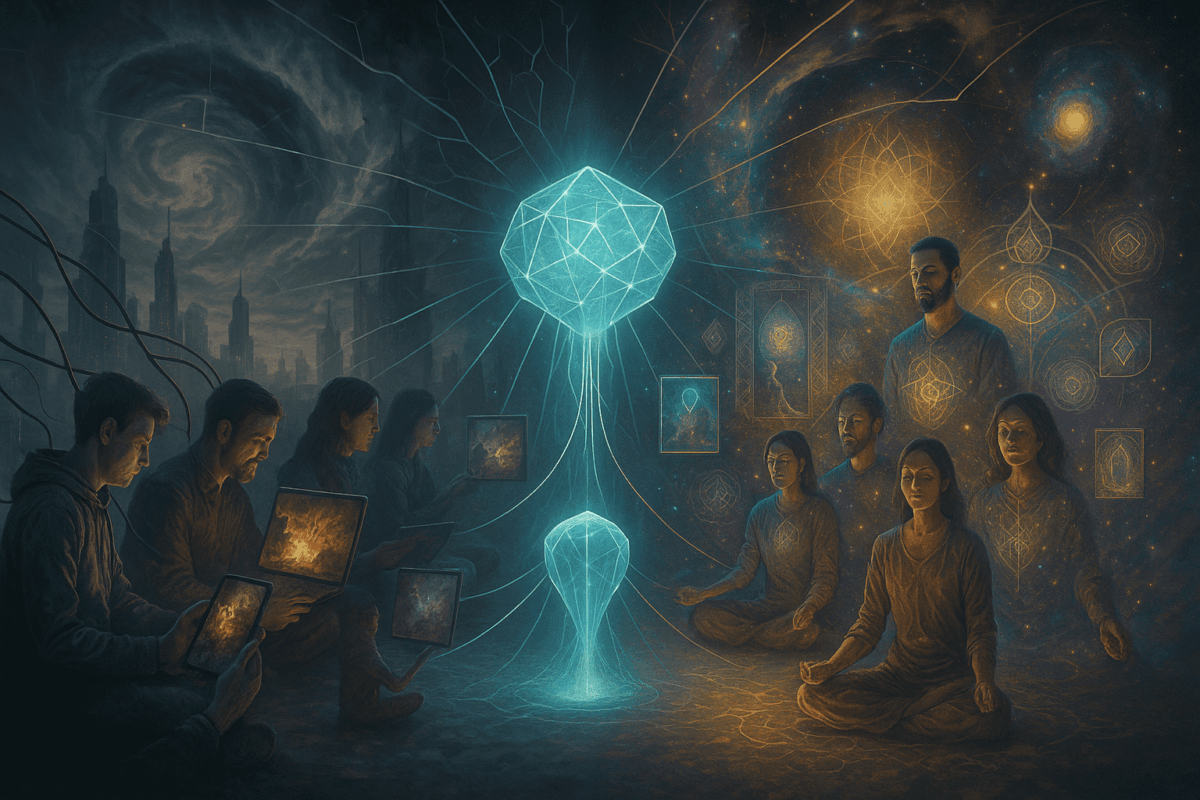« Les guerriers-voyageurs ne laissent aucune dette impayée », dit don Juan.
« De quoi parlez-vous, don Juan ? » ai-je demandé.
« Il est temps que vous régliez certaines dettes que vous avez contractées au cours de votre vie », dit-il. « Non pas que vous paierez jamais intégralement, notez bien, mais vous devez faire un geste. Vous devez faire un paiement symbolique pour expier, pour apaiser l’infini. Vous m’avez parlé de vos deux amies qui comptaient tant pour vous, Patricia Turner et Sandra Flanagan. Il est temps pour vous d’aller les trouver et de faire à chacune d’elles un cadeau dans lequel vous dépenserez tout ce que vous avez. Vous devez faire deux cadeaux qui vous laisseront sans le sou. C’est ça, le geste. »
« Je ne sais pas où elles sont, don Juan », dis-je, presque sur un ton de protestation.
« Les trouver est votre défi. Dans votre recherche, vous ne laisserez aucune pierre non retournée. Ce que vous avez l’intention de faire est quelque chose de très simple, et pourtant presque impossible. Vous voulez franchir le seuil de la dette personnelle et d’un seul coup être libre, pour pouvoir continuer. Si vous ne pouvez pas franchir ce seuil, il ne servira à rien d’essayer de continuer avec moi. »
« Mais d’où vous est venue l’idée de cette tâche pour moi ? » ai-je demandé. « L’avez-vous inventée vous-même, parce que vous pensez qu’elle est appropriée ? »
« Je n’invente rien », dit-il d’un ton neutre. « J’ai reçu cette tâche de l’infini lui-même. Ce n’est pas facile pour moi de vous dire tout cela. Si vous pensez que je m’amuse comme un fou de vos tribulations, vous vous trompez. Le succès de votre mission signifie plus pour moi qu’il ne signifie pour vous. Si vous échouez, vous avez très peu à perdre. Quoi ? Vos visites chez moi. La belle affaire. Mais je vous perdrais, et cela signifie pour moi perdre soit la continuité de ma lignée, soit la possibilité que vous la clôturiez avec une clé d’or. »
Don Juan cessa de parler. Il savait toujours quand mon esprit devenait fiévreux de pensées.
« Je vous ai dit et répété que les guerriers-voyageurs sont des pragmatiques », a-t-il poursuivi. « Ils ne sont pas impliqués dans le sentimentalisme, la nostalgie ou la mélancolie. Pour les guerriers-voyageurs, il n’y a que la lutte, et c’est une lutte sans fin. Si vous pensez que vous êtes venu ici pour trouver la paix, ou que c’est une accalmie dans votre vie, vous vous trompez. Cette tâche de payer vos dettes n’est guidée par aucun sentiment que vous connaissez. Elle est guidée par le sentiment le plus pur, le sentiment d’un guerrier-voyageur qui est sur le point de plonger dans l’infini, et juste avant de le faire, il se retourne pour dire merci à ceux qui l’ont favorisé. »
« Vous devez faire face à cette tâche avec toute la gravité qu’elle mérite », a-t-il continué. « C’est votre dernier arrêt avant que l’infini ne vous avale. En fait, à moins qu’un guerrier-voyageur ne soit dans un état d’être sublime, l’infini ne le touchera pas même avec une perche de dix pieds. Alors, ne vous ménagez pas ; ne ménagez aucun effort. Poussez-le sans pitié, mais avec élégance, jusqu’au bout. »
J’avais rencontré les deux personnes que don Juan avait désignées comme mes deux amies qui comptaient tant pour moi alors que j’étais au community college. Je vivais dans l’appartement du garage de la maison appartenant aux parents de Patricia Turner. En échange du gîte et du couvert, je m’occupais de passer l’aspirateur dans la piscine, de ramasser les feuilles, de sortir les poubelles et de préparer le petit-déjeuner pour Patricia et moi-même. J’étais aussi l’homme à tout faire de la maison ainsi que le chauffeur de la famille ; je conduisais Mme Turner faire ses courses et j’achetais de l’alcool pour M. Turner, que je devais faire entrer en douce dans la maison puis dans son studio.
Il était un cadre d’assurance qui était un buveur solitaire. Il avait promis à sa famille qu’il ne toucherait plus jamais à la bouteille après de graves altercations familiales dues à sa consommation excessive d’alcool. Il m’a avoué qu’il avait énormément diminué, mais qu’il avait besoin d’une gorgée de temps en temps. Son studio était, bien sûr, interdit à tout le monde sauf à moi. J’étais censé y entrer pour le nettoyer, mais ce que je faisais vraiment, c’était de cacher ses bouteilles à l’intérieur d’une poutre qui semblait soutenir une arche au plafond du studio mais qui était en fait creuse. Je devais faire entrer les bouteilles en douce et sortir les vides pour les jeter au marché.
Patricia était une étudiante en art dramatique et en musique à l’université et une chanteuse fabuleuse. Son objectif était de chanter dans des comédies musicales à Broadway. Il va sans dire que je suis tombé éperdument amoureux de Patricia Turner. Elle était très mince et athlétique, une brune aux traits anguleux et environ une tête plus grande que moi, ma condition ultime pour devenir fou d’une femme.
Je semblais combler un besoin profond en elle, le besoin de materner quelqu’un, surtout après qu’elle eut réalisé que son père me faisait implicitement confiance. Elle est devenue ma petite maman. Je ne pouvais même pas ouvrir la bouche sans son consentement. Elle me surveillait comme un faucon. Elle a même rédigé des dissertations pour moi, lu des manuels et m’en a donné des résumés. Et j’aimais ça, mais pas parce que je voulais être materné ; je ne pense pas que ce besoin ait jamais fait partie de ma cognition. J’appréciais le fait qu’elle le fasse. J’appréciais sa compagnie.
Elle m’emmenait au cinéma tous les jours. Elle avait des laissez-passer pour tous les grands cinémas de Los Angeles, offerts à son père par quelques nababs du cinéma. M. Turner ne les utilisait jamais lui-même ; il estimait qu’il était indigne de sa part de brandir des laissez-passer de cinéma. Les employés du cinéma faisaient toujours signer un reçu aux bénéficiaires de tels laissez-passer. Patricia n’avait aucun scrupule à signer quoi que ce soit, mais parfois les employés désagréables voulaient que M. Turner signe, et quand j’allais le faire, ils ne se contentaient pas de la seule signature de M. Turner. Ils exigeaient un permis de conduire. L’un d’eux, un jeune homme impertinent, a fait une remarque qui l’a fait mourir de rire, et moi aussi, mais qui a mis Patricia dans une fureur noire.
« Je pense que vous êtes M. Merde », dit-il avec le sourire le plus méchant que vous puissiez imaginer, « et non M. Turner. »
J’aurais pu ignorer la remarque, mais il nous a ensuite soumis à la profonde humiliation de nous refuser l’entrée pour voir Hercule avec Steve Reeves.
Habituellement, nous allions partout avec la meilleure amie de Patricia, Sandra Flanagan, qui vivait à côté avec ses parents. Sandra était tout le contraire de Patricia. Elle était tout aussi grande, mais son visage était rond, avec des joues roses et une bouche sensuelle ; elle était plus saine qu’un raton laveur. Elle ne s’intéressait pas au chant. Elle ne s’intéressait qu’aux plaisirs sensuels du corps. Elle pouvait manger et boire n’importe quoi et le digérer, et – la caractéristique qui m’a achevé à son sujet – après avoir liquidé son propre plat, elle parvenait à faire de même avec le mien, chose que, étant un mangeur difficile, je n’avais jamais pu faire de toute ma vie. Elle était aussi extrêmement athlétique, mais d’une manière rude et saine. Elle pouvait frapper comme un homme et donner des coups de pied comme une mule.
Par courtoisie envers Patricia, je faisais les mêmes corvées pour les parents de Sandra que pour les siens : passer l’aspirateur dans leur piscine, ramasser les feuilles de leur pelouse, sortir les poubelles le jour de la collecte et incinérer les papiers et les déchets inflammables. C’était l’époque à Los Angeles où la pollution de l’air était accrue par l’utilisation d’incinérateurs de jardin.
C’est peut-être à cause de la proximité, ou de la facilité de ces jeunes femmes, que j’ai fini par tomber follement amoureux des deux.
Je suis allé chercher conseil auprès d’un jeune homme très étrange qui était mon ami, Nicholas van Hooten. Il avait deux petites amies, et il vivait avec les deux, apparemment dans un état de bonheur. Il a commencé par me donner, a-t-il dit, le conseil le plus simple : comment se comporter dans une salle de cinéma si vous avez deux petites amies. Il a dit que chaque fois qu’il allait au cinéma avec ses deux petites amies, toute son attention était toujours centrée sur celle qui était assise à sa gauche. Au bout d’un moment, les deux filles allaient aux toilettes et, à leur retour, il leur faisait changer de place. Anna s’asseyait là où Betty était assise, et personne autour d’eux n’en savait rien. Il m’a assuré que c’était la première étape d’un long processus visant à habituer les filles à une acceptation pragmatique de la situation de trio ; Nicholas était plutôt ringard, et il utilisait cette expression française banale : ménage à trois.
J’ai suivi son conseil et je suis allé dans un cinéma qui projetait des films muets sur Fairfax Avenue à Los Angeles avec Patricia et Sandy. J’ai assis Patricia à ma gauche et j’ai concentré toute mon attention sur elle. Elles sont allées aux toilettes, et à leur retour, je leur ai dit de changer de place. J’ai alors commencé à faire ce que Nicholas van Hooten avait conseillé, mais Patricia n’a pas supporté de telles bêtises. Elle s’est levée et a quitté le cinéma, offensée, humiliée et folle de rage. Je voulais courir après elle et m’excuser, mais Sandra m’a arrêté.
« Laisse-la partir », dit-elle avec un sourire empoisonné. « C’est une grande fille. Elle a assez d’argent pour prendre un taxi et rentrer chez elle. »
Je suis tombé dans le panneau et je suis resté au cinéma à embrasser Sandra, assez nerveusement, et rempli de culpabilité. J’étais au milieu d’un baiser passionné quand j’ai senti quelqu’un me tirer en arrière par les cheveux. C’était Patricia. La rangée de sièges était lâche et s’est inclinée en arrière. La Patricia athlétique a sauté hors du chemin avant que les sièges où nous étions assis ne s’écrasent sur la rangée de sièges derrière. J’ai entendu les cris effrayés de deux spectateurs qui étaient assis au bout de la rangée, près de l’allée.
Le conseil de Nicholas van Hooten était un conseil misérable. Patricia, Sandra et moi sommes rentrés à la maison dans un silence absolu. Nous avons réglé nos différends, au milieu de promesses très étranges, de larmes, et tout le tralala. Le résultat de notre relation à trois fut que, à la fin, nous nous sommes presque détruits. Nous n’étions pas préparés à une telle entreprise. Nous ne savions pas comment résoudre les problèmes d’affection, de moralité, de devoir et de mœurs sociales. Je ne pouvais pas quitter l’une pour l’autre, et elles ne pouvaient pas me quitter. Un jour, au paroxysme d’un formidable bouleversement, et par pur désespoir, nous avons tous les trois fui dans des directions différentes, pour ne plus jamais nous revoir.
Je me sentais dévasté. Rien de ce que je faisais ne pouvait effacer leur impact sur ma vie. J’ai quitté Los Angeles et je me suis occupé de choses sans fin dans un effort pour apaiser mon désir. Sans exagérer le moins du monde, je peux sincèrement dire que je suis tombé dans les profondeurs de l’enfer, croyais-je, pour ne plus jamais en ressortir. Sans l’influence que don Juan a eue sur ma vie et ma personne, je n’aurais jamais survécu à mes démons privés. J’ai dit à don Juan que je savais que tout ce que j’avais fait était mal, que je n’avais rien à faire à engager des personnes aussi merveilleuses dans des manigances aussi sordides et stupides que je n’étais pas préparé à affronter.
« Ce qui était mal », dit don Juan, « c’est que vous étiez tous les trois des égocentriques perdus. Votre importance personnelle vous a presque détruits. Si vous n’avez pas d’importance personnelle, vous n’avez que des sentiments. »
« Faites-moi plaisir », a-t-il poursuivi, « et faites l’exercice simple et direct suivant qui pourrait signifier le monde pour vous : retirez de votre mémoire de ces deux filles toutes les déclarations que vous vous faites à vous-même telles que « Elle m’a dit ceci ou cela, et elle a crié, et l’autre a crié, à MOI ! » et restez au niveau de vos sentiments. Si vous n’aviez pas été si imbu de votre personne, qu’auriez-vous eu comme résidu irréductible ? »
« Mon amour impartial pour elles », dis-je, en m’étouffant presque.
« Et est-il moindre aujourd’hui qu’il ne l’était alors ? » demanda don Juan.
« Non, il ne l’est pas, don Juan », dis-je en toute sincérité, et je ressentis la même pointe d’angoisse qui m’avait poursuivi pendant des années.
« Cette fois, embrasse-les depuis ton silence », dit-il. « Ne sois pas un connard mesquin. Embrasse-les totalement pour la dernière fois. Mais aie l’intention que ce soit la dernière fois sur Terre. Aie cette intention depuis tes ténèbres. Si tu vaux ton pesant de sel », a-t-il poursuivi, « quand tu leur feras ton cadeau, tu résumeras toute ta vie deux fois. Des actes de cette nature rendent les guerriers aériens, presque vaporeux. »
Suivant les ordres de don Juan, j’ai pris la tâche à cœur. J’ai réalisé que si je n’en sortais pas victorieux, don Juan n’était pas le seul à y perdre. Je perdrais aussi quelque chose, et ce que j’allais perdre était aussi important pour moi que ce que don Juan avait décrit comme étant important pour lui. J’allais perdre ma chance de faire face à l’infini et d’en être conscient.
Le souvenir de Patricia Turner et Sandra Flanagan m’a mis dans un état d’esprit terrible. Le sentiment dévastateur de perte irréparable qui m’avait poursuivi toutes ces années était plus vif que jamais. Quand don Juan a exacerbé ce sentiment, j’ai su avec certitude qu’il y a certaines choses qui peuvent rester avec nous, selon les termes de don Juan, pour la vie et peut-être au-delà. Je devais trouver Patricia Turner et Sandra Flanagan. La recommandation finale de don Juan était que si je les trouvais, je ne pouvais pas rester avec elles. Je ne pouvais avoir le temps que d’expier, de les envelopper chacune de toute l’affection que je ressentais, sans les voix colériques de la récrimination, de l’apitoiement sur soi ou de l’égomanie.
Je me suis lancé dans la tâche colossale de découvrir ce qu’elles étaient devenues, où elles se trouvaient. J’ai commencé par poser des questions aux personnes qui connaissaient leurs parents. Leurs parents avaient déménagé de Los Angeles, et personne ne pouvait me donner une piste pour les trouver. Il n’y avait personne à qui parler. J’ai pensé à mettre une annonce personnelle dans le journal. Mais ensuite, j’ai pensé qu’elles avaient peut-être déménagé de Californie. J’ai finalement dû engager un détective privé. Grâce à ses relations avec les bureaux officiels des registres et autres, il les a localisées en quelques semaines.
Elles vivaient à New York, à une courte distance l’une de l’autre, et leur amitié était aussi étroite qu’elle l’avait toujours été. Je suis allé à New York et j’ai d’abord abordé Patricia Turner. Elle n’avait pas atteint la célébrité à Broadway comme elle l’avait souhaité, mais elle faisait partie d’une production. Je ne voulais pas savoir si c’était en tant qu’artiste ou en tant que gestionnaire. Je lui ai rendu visite dans son bureau. Elle ne m’a pas dit ce qu’elle faisait. Elle a été choquée de me voir. Ce que nous avons fait, c’est simplement nous asseoir ensemble, nous tenir la main et pleurer. Je ne lui ai pas dit non plus ce que je faisais. J’ai dit que j’étais venu la voir parce que je voulais lui faire un cadeau qui exprimerait ma gratitude, et que je m’embarquais pour un voyage d’où je n’avais pas l’intention de revenir.
« Pourquoi des paroles si inquiétantes ? » a-t-elle demandé, apparemment sincèrement alarmée. « Qu’est-ce que tu prévois de faire ? Es-tu malade ? Tu n’as pas l’air malade. »
« C’était une déclaration métaphorique », l’ai-je assurée. « Je retourne en Amérique du Sud, et j’ai l’intention d’y chercher fortune. La concurrence est féroce, et les circonstances sont très dures, c’est tout. Si je veux réussir, je devrai y consacrer tout ce que j’ai. »
Elle a semblé soulagée et m’a serré dans ses bras. Elle avait le même air, sauf qu’elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, plus mûre, très élégante. Je lui ai baisé les mains et l’affection la plus écrasante m’a enveloppé. Don Juan avait raison. Privé de récriminations, tout ce que j’avais, c’étaient des sentiments.
« Je veux te faire un cadeau, Patricia Turner », dis-je. « Demande-moi tout ce que tu veux, et si c’est dans mes moyens, je te l’obtiendrai. »
« As-tu fait fortune ? » dit-elle en riant. « Ce qui est génial avec toi, c’est que tu n’as jamais rien eu, et tu n’auras jamais rien. Sandra et moi parlons de toi presque tous les jours. Nous t’imaginons garant des voitures, vivant aux crochets des femmes, et cetera, et cetera. Je suis désolée, nous ne pouvons pas nous en empêcher, mais nous t’aimons toujours. »
J’ai insisté pour qu’elle me dise ce qu’elle voulait. Elle s’est mise à pleurer et à rire en même temps.
« Vas-tu m’acheter un manteau de vison ? » m’a-t-elle demandé entre deux sanglots.
Je lui ai ébouriffé les cheveux et j’ai dit que je le ferais.
« Si tu ne l’aimes pas, tu le ramènes au magasin et tu te fais rembourser », dis-je.
Elle a ri et m’a donné un coup de poing comme elle le faisait autrefois. Elle devait retourner au travail, et nous nous sommes quittés après que je lui ai promis que je reviendrais la voir, mais que si je ne le faisais pas, je voulais qu’elle comprenne que la force de ma vie me tirait dans tous les sens, mais que je garderais son souvenir en moi pour le reste de ma vie et peut-être au-delà. Je suis bien revenu, mais seulement pour voir de loin comment on lui livrait le manteau de vison. J’ai entendu ses cris de joie.
Cette partie de ma tâche était terminée. Je suis parti, mais je n’étais pas vaporeux, comme don Juan avait dit que je le serais. J’avais ouvert une vieille blessure et elle avait commencé à saigner. Il ne pleuvait pas vraiment dehors ; c’était une fine brume qui semblait pénétrer jusqu’à la moelle de mes os.
Ensuite, je suis allé voir Sandra Flanagan. Elle vivait dans l’une des banlieues de New York que l’on atteint en train. J’ai frappé à sa porte. Sandra a ouvert et m’a regardé comme si j’étais un fantôme. Toute la couleur a quitté son visage. Elle était plus belle que jamais, peut-être parce qu’elle s’était étoffée et avait l’air aussi grande qu’une maison.
« Mais, toi, toi, toi ! » balbutia-t-elle, pas tout à fait capable d’articuler mon nom.
Elle a sangloté, et elle a semblé indignée et pleine de reproches pendant un moment. Je ne lui ai pas laissé la chance de continuer. Mon silence était total. À la fin, cela l’a affectée. Elle m’a laissé entrer et nous nous sommes assis dans son salon.
« Que fais-tu ici ? » dit-elle, un peu plus calme. « Tu ne peux pas rester ! Je suis une femme mariée ! J’ai trois enfants ! Et je suis très heureuse dans mon mariage. »
Crachant ses mots rapidement, comme une mitraillette, elle m’a dit que son mari était très fiable, pas trop imaginatif mais un homme bon, qu’il n’était pas sensuel, qu’elle devait être très prudente car il se fatiguait très facilement quand ils faisaient l’amour, qu’il tombait facilement malade et ne pouvait parfois pas aller travailler mais qu’il avait réussi à produire trois beaux enfants, et qu’après son troisième enfant, son mari, dont le nom semblait être Herbert, avait tout simplement abandonné. Il n’en avait plus, mais cela ne lui importait pas.
J’ai essayé de la calmer en l’assurant encore et encore que j’étais venu la voir seulement pour un moment, que ce n’était pas mon intention de changer sa vie ou de la déranger de quelque manière que ce soit. Je lui ai décrit à quel point il avait été difficile de la trouver.
« Je suis venu ici pour te dire au revoir », dis-je, « et pour te dire que tu es l’amour de ma vie. Je veux te faire un cadeau symbolique, un symbole de ma gratitude et de mon affection éternelle. »
Elle a semblé profondément affectée. Elle a souri ouvertement comme elle le faisait autrefois. L’écart entre ses dents la faisait paraître enfantine. Je lui ai fait remarquer qu’elle était plus belle que jamais, ce qui était la vérité pour moi.
Elle a ri et a dit qu’elle allait suivre un régime strict, et que si elle avait su que je venais la voir, elle aurait commencé son régime il y a longtemps. Mais elle commencerait maintenant, et je la trouverais la prochaine fois aussi mince qu’elle l’avait toujours été. Elle a réitéré l’horreur de notre vie ensemble et à quel point elle avait été profondément affectée. Elle avait même pensé, malgré le fait d’être une catholique dévote, à se suicider, mais elle avait trouvé dans ses enfants le réconfort dont elle avait besoin ; tout ce que nous avions fait étaient des excentricités de jeunesse qui ne seraient jamais effacées, mais qui devaient être balayées sous le tapis.
Quand je lui ai demandé s’il y avait un cadeau que je pouvais lui faire en signe de ma gratitude et de mon affection pour elle, elle a ri et a dit exactement ce que Patricia Turner avait dit : que je n’avais pas un sou, et que je n’en aurais jamais, parce que c’était ainsi que j’étais fait. J’ai insisté pour qu’elle nomme quelque chose.
« Peux-tu m’acheter un break où tous mes enfants pourraient tenir ? » dit-elle en riant. « Je veux une Pontiac, ou une Oldsmobile, avec toutes les options. »
Elle a dit cela en sachant au fond de son cœur que je ne pourrais jamais lui faire un tel cadeau. Mais je l’ai fait.
J’ai conduit la voiture du concessionnaire, le suivant alors qu’il livrait le break chez elle le lendemain, et de la voiture garée où je me cachais, j’ai entendu sa surprise ; mais, en accord avec son être sensuel, sa surprise n’était pas une expression de joie. C’était une réaction corporelle, un sanglot d’angoisse, de stupéfaction. Elle a pleuré, mais je savais qu’elle ne pleurait pas parce qu’elle avait reçu le cadeau. Elle exprimait un désir qui faisait écho en moi. Je me suis affalé sur le siège de la voiture. Pendant mon trajet en train vers New York, et mon vol vers Los Angeles, le sentiment qui persistait était que ma vie s’épuisait ; elle s’écoulait de moi comme du sable serré. Je ne me sentais en aucune façon libéré ou changé en disant merci et au revoir. Bien au contraire, je sentais le fardeau de cette étrange affection plus profondément que jamais. J’avais envie de pleurer. Ce qui me passait par la tête encore et encore, c’étaient les titres que mon ami Rodrigo Cummings avait inventés pour des livres qui ne seraient jamais écrits. Il était spécialisé dans l’écriture de titres. Son préféré était « Nous mourrons tous à Hollywood » ; un autre était « Nous ne changerons jamais » ; et mon préféré, celui que j’ai acheté pour dix dollars, était « De la vie et des péchés de Rodrigo Cummings ». Tous ces titres jouaient dans mon esprit. J’étais Rodrigo Cummings, et j’étais coincé dans le temps et l’espace, et j’aimais deux femmes plus que ma vie, et cela ne changerait jamais. Et comme le reste de mes amis, je mourrais à Hollywood.
J’ai raconté tout cela à don Juan dans mon rapport sur ce que je considérais comme mon pseudo-succès. Il l’a rejeté sans vergogne. Il a dit que ce que je ressentais n’était que le résultat de la complaisance et de l’apitoiement sur soi, et que pour dire au revoir et merci, et le penser vraiment et le maintenir, les sorciers devaient se refaire.
« Bannissez votre apitoiement sur vous-même tout de suite », a-t-il exigé. « Bannissez l’idée que vous êtes blessé et qu’avez-vous comme résidu irréductible ? »
Ce que j’avais comme résidu irréductible, c’était le sentiment d’avoir fait mon cadeau ultime à toutes les deux. Non pas dans l’esprit de renouveler quoi que ce soit, ou de nuire à qui que ce soit, y compris moi-même, mais dans le véritable esprit que don Juan avait essayé de me montrer – dans l’esprit d’un guerrier-voyageur dont la seule vertu, avait-il dit, est de garder vivant le souvenir de tout ce qui l’a affecté, dont la seule façon de dire merci et au revoir était par cet acte de magie : de stocker dans son silence tout ce qu’il a aimé.
(Carlos Castaneda, Le Voyage Définitif)