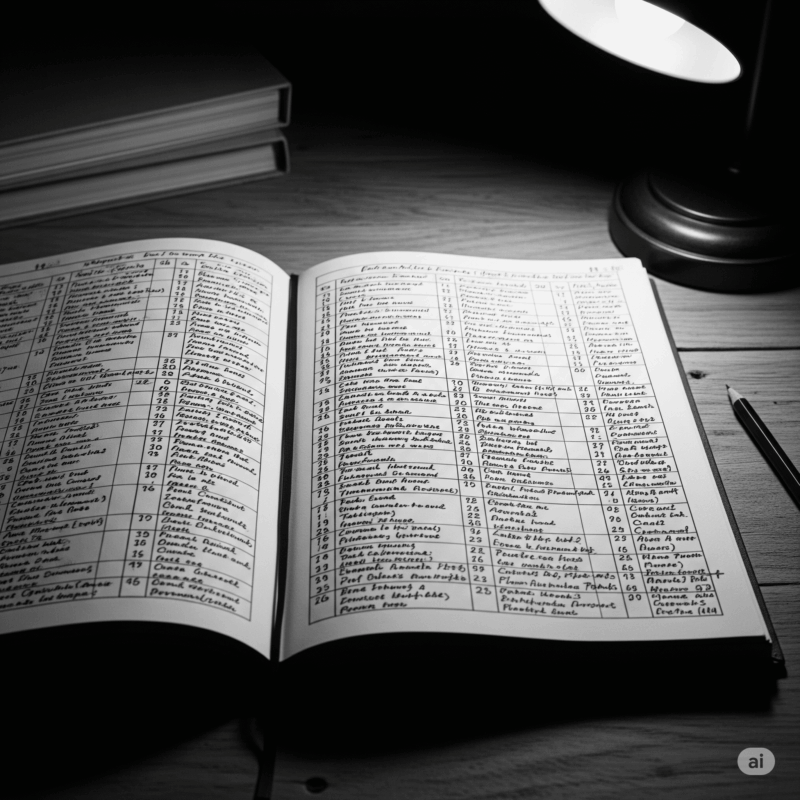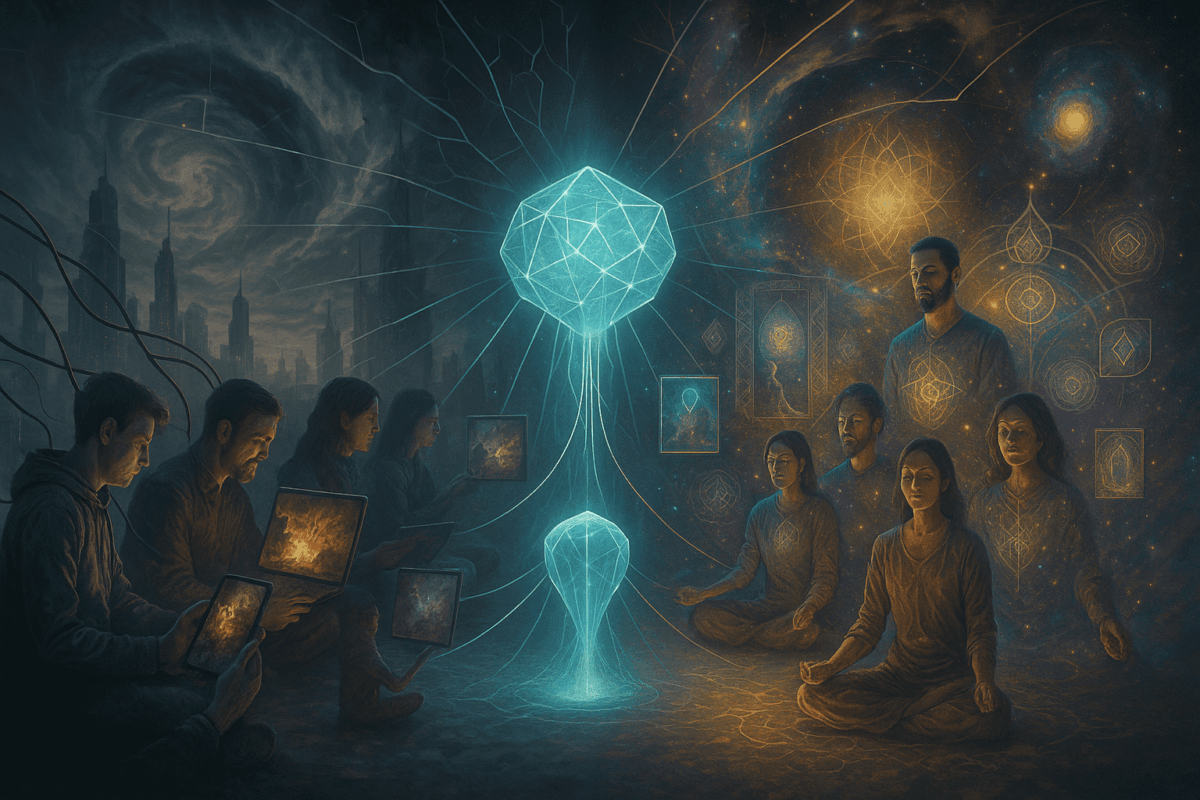Il n’y avait qu’un seul sentier menant au plateau plat. Une fois sur le plateau lui-même, j’ai réalisé qu’il n’était pas aussi étendu qu’il avait paru lorsque je l’avais regardé de loin. La végétation sur le plateau n’était pas différente de la végétation en contrebas : des arbustes ligneux d’un vert délavé qui avaient l’apparence ambiguë d’arbres.
Au début, je n’ai pas vu le gouffre. Ce n’est que lorsque don Juan m’y a conduit que j’ai pris conscience que le plateau se terminait par un précipice ; ce n’était pas vraiment un plateau mais simplement le sommet plat d’une montagne de bonne taille. La montagne était ronde et érodée sur ses faces est et sud ; cependant, sur une partie de ses côtés ouest et nord, elle semblait avoir été coupée au couteau. Du bord du précipice, j’ai pu voir le fond du ravin, peut-être à six cents pieds plus bas. Il était couvert des mêmes arbustes ligneux qui poussaient partout.
Toute une rangée de petites montagnes au sud et au nord de ce sommet donnait la nette impression qu’elles avaient fait partie d’un canyon gigantesque, vieux de millions d’années, creusé par une rivière qui n’existait plus. Les bords de ce canyon avaient été effacés par l’érosion. À certains endroits, ils avaient été nivelés avec le sol. La seule portion encore intacte était la zone où je me trouvais.
« C’est de la roche solide », dit don Juan comme s’il lisait mes pensées. Il a pointé du menton vers le fond du ravin. « Si quelque chose tombait de ce bord jusqu’en bas, il se briserait en éclats sur la roche, là-bas. »
Ce fut le dialogue initial entre don Juan et moi, ce jour-là, sur ce sommet de montagne. Avant d’y aller, il m’avait dit que son temps sur Terre était arrivé à son terme. Il partait pour son voyage définitif. Ses déclarations furent dévastatrices pour moi. J’ai vraiment perdu pied, et je suis entré dans un état de fragmentation bienheureuse, peut-être similaire à ce que les gens éprouvent lorsqu’ils ont une dépression nerveuse. Mais il y avait un fragment central de moi-même qui restait cohérent : le moi de mon enfance. Le reste n’était que flou, incertitude. J’avais été fragmenté depuis si longtemps que redevenir fragmenté était le seul moyen de sortir de ma dévastation.
Une interaction des plus particulières entre différents niveaux de ma conscience a eu lieu par la suite. Don Juan, son cohort don Genaro, deux de ses apprentis, Pablito et Nestor, et moi avions grimpé jusqu’à ce sommet de montagne. Pablito, Nestor et moi étions là pour nous occuper de notre dernière tâche en tant qu’apprentis : sauter dans un abîme, une affaire des plus mystérieuses, que don Juan m’avait expliquée à divers niveaux de conscience mais qui est restée une énigme pour moi jusqu’à ce jour.
Don Juan a dit en plaisantant que je devrais prendre mon bloc-notes et commencer à prendre des notes sur nos derniers moments ensemble. Il m’a gentiment piqué dans les côtes et m’a assuré, en cachant son rire, que cela n’aurait été que justice, puisque j’avais commencé sur le chemin des guerriers-voyageurs en prenant des notes. Don Genaro est intervenu et a dit que d’autres guerriers-voyageurs avant nous s’étaient tenus sur ce même sommet plat avant de s’embarquer pour leur voyage vers l’inconnu. Don Juan s’est tourné vers moi et d’une voix douce a dit que bientôt j’entrerais dans l’infini par la force de mon pouvoir personnel, et que lui et don Genaro n’étaient là que pour me dire adieu. Don Genaro est intervenu à nouveau et a dit que j’étais là aussi pour faire de même pour eux.
« Une fois que vous êtes entré dans l’infini », dit don Juan, « vous не pouvez plus dépendre de nous pour vous ramener. Votre décision est alors nécessaire. Vous seul pouvez décider de revenir ou non. Je dois aussi vous avertir que peu de guerriers-voyageurs survivent à ce type de rencontre avec l’infini. L’infini est séduisant au-delà de toute croyance. Un guerrier-voyageur trouve que retourner dans le monde du désordre, de la compulsion, du bruit et de la douleur est une affaire des plus rebutantes. Vous devez savoir que votre décision de rester ou de revenir n’est pas une question de choix raisonnable, mais une question d’intention. »
« Si vous choisissez de ne pas revenir », a-t-il poursuivi, « vous disparaîtrez comme si la terre vous avait avalé. Mais si vous choisissez de revenir, vous devez serrer votre ceinture et attendre comme un vrai guerrier-voyageur jusqu’à ce que votre tâche, quelle qu’elle soit, soit terminée, que ce soit par un succès ou une défaite. »
Un changement très subtil a alors commencé à se produire dans ma conscience. J’ai commencé à me souvenir de visages de personnes, mais je n’étais pas sûr de les avoir rencontrées ; d’étranges sentiments d’angoisse et d’affection ont commencé à monter. La voix de don Juan n’était plus audible. J’aspirais à des personnes que je doutais sincèrement d’avoir jamais rencontrées. J’ai été soudainement possédé par l’amour le plus insupportable pour ces personnes, quelles qu’elles aient pu être. Mes sentiments pour elles dépassaient les mots, et pourtant je ne pouvais pas dire qui elles étaient. Je sentais seulement leur présence, comme si j’avais vécu une autre vie auparavant, ou comme si je ressentais des sentiments pour des personnes dans un rêve. J’ai senti que leurs formes extérieures changeaient ; elles commençaient par être grandes et finissaient par être petites. Ce qui restait intact, c’était leur essence, la chose même qui produisait mon désir insupportable pour elles.
Don Juan est venu à mes côtés et m’a dit : « L’accord était que vous restiez dans la conscience du monde quotidien. » Sa voix était dure et autoritaire. « Aujourd’hui, vous allez accomplir une tâche concrète », a-t-il poursuivi, « le dernier maillon d’une longue chaîne ; et vous devez le faire dans votre humeur la plus grande de raison. »
Je n’avais jamais entendu don Juan me parler sur ce ton de voix. Il était un homme différent à cet instant, et pourtant il m’était tout à fait familier. Je lui ai obéi docilement et je suis retourné à la conscience du monde de la vie quotidienne. Je ne savais pas que je faisais cela, cependant. Il m’a semblé, ce jour-là, que j’avais acquiescé à don Juan par peur et par respect.
Don Juan m’a ensuite parlé sur le ton auquel j’étais habitué. Ce qu’il a dit était aussi très familier. Il a dit que l’épine dorsale d’un guerrier-voyageur est l’humilité et l’efficacité, agissant sans rien attendre et supportant tout ce qui l’attend.
Je suis alors passé par un autre changement de mon niveau de conscience. Mon esprit s’est concentré sur une pensée, ou un sentiment d’angoisse. J’ai alors su que j’avais fait un pacte avec certaines personnes pour mourir avec elles, et je ne me souvenais pas qui elles étaient. J’ai senti, sans l’ombre d’un doute, qu’il était mal que je meure seul. Mon angoisse est devenue insupportable.
Don Juan m’a parlé. « Nous sommes seuls », dit-il. « C’est notre condition, mais mourir seul n’est pas mourir dans la solitude. »
J’ai pris de grandes goulées d’air pour effacer ma tension. En respirant profondément, mon esprit s’est éclairci.
« Le grand problème avec nous les hommes, c’est notre fragilité », a-t-il poursuivi. « Quand notre conscience commence à grandir, elle grandit comme une colonne, juste au milieu de notre être lumineux, du sol vers le haut. Cette colonne doit atteindre une hauteur considérable avant que nous puissions compter sur elle. À ce stade de votre vie, en tant que sorcier, vous perdez facilement votre prise sur votre nouvelle conscience. Quand vous faites cela, vous oubliez tout ce que vous avez fait et vu sur le chemin des guerriers-voyageurs parce que votre conscience retourne à la conscience de votre vie quotidienne. Je vous ai expliqué que la tâche de chaque sorcier masculin est de récupérer tout ce qu’il a fait et vu sur le chemin des guerriers-voyageurs alors qu’il était à de nouveaux niveaux de conscience. Le problème de chaque sorcier masculin est qu’il oublie facilement parce que sa conscience perd son nouveau niveau et tombe au sol à la moindre occasion. »
« Je comprends exactement ce que vous dites, don Juan », dis-je. « C’est peut-être la première fois que je prends pleinement conscience de la raison pour laquelle j’oublie tout, et pourquoi je me souviens de tout plus tard. J’ai toujours cru que mes changements étaient dus à une condition pathologique personnelle ; je sais maintenant pourquoi ces changements ont lieu, et pourtant je ne peux pas verbaliser ce que je sais. »
« Ne vous inquiétez pas des verbalisations », dit don Juan. « Vous verbaliserez tout ce que vous voudrez en temps voulu. Aujourd’hui, vous devez agir sur votre silence intérieur, sur ce que vous savez sans savoir. Vous savez à la perfection ce que vous avez à faire, mais cette connaissance n’est pas encore tout à fait formulée dans vos pensées. »
Au niveau des pensées ou des sensations concrètes, tout ce que j’avais, c’étaient de vagues sentiments de savoir quelque chose qui ne faisait pas partie de mon esprit. J’ai eu, alors, le sentiment le plus clair d’avoir fait un grand pas en arrière ; quelque chose semblait avoir chuté en moi. C’était presque une secousse. J’ai su que j’étais entré dans un autre niveau de conscience à cet instant.
Don Juan m’a alors dit qu’il est obligatoire qu’un guerrier-voyageur dise au revoir à toutes les personnes qu’il laisse derrière lui. Il doit dire son au revoir d’une voix forte et claire afin que son cri et ses sentiments restent à jamais enregistrés dans ces montagnes.
J’ai longtemps hésité, non par timidité, mais parce que je ne savais pas qui inclure dans mes remerciements. J’avais complètement intériorisé le concept des sorciers selon lequel les guerriers-voyageurs ne peuvent rien devoir à personne.
Don Juan m’avait inculqué un axiome de sorcier : « Les guerriers-voyageurs paient avec élégance, générosité et une facilité inégalée chaque faveur, chaque service qui leur est rendu. De cette manière, ils se débarrassent du fardeau d’être endettés. »
J’avais payé, ou j’étais en train de payer, tous ceux qui m’avaient honoré de leurs soins ou de leur sollicitude. J’avais récapitulé ma vie à un point tel que je n’avais laissé aucune pierre non retournée. Je croyais sincèrement à cette époque que je ne devais rien à personne. J’ai exprimé mes croyances et mon hésitation à don Juan.
Don Juan a dit que j’avais en effet récapitulé ma vie minutieusement, mais il a ajouté que j’étais loin d’être libre de dettes.
« Et vos fantômes ? » a-t-il poursuivi. « Ceux que vous ne pouvez plus toucher ? »
Il savait de quoi il parlait. Pendant ma récapitulation, je lui avais raconté chaque incident de ma vie. Parmi les centaines d’incidents que je lui ai relatés, il en avait isolé trois comme des exemples de dettes que j’avais contractées très tôt dans la vie, et à cela s’ajoutait ma dette envers la personne qui avait été déterminante dans ma rencontre avec lui. J’avais remercié abondamment mon ami, et j’avais eu la sensation que quelque chose là-dehors reconnaissait mes remerciements. Les trois autres étaient restées des histoires de ma vie, des histoires de personnes qui m’avaient fait un cadeau inconcevable, et que je n’avais jamais remerciées.
Une de ces histoires concernait un homme que j’avais connu quand j’étais enfant. Son nom était M. Leandro Acosta. Il était l’ennemi juré de mon grand-père, son véritable némésis. Mon grand-père avait accusé cet homme à plusieurs reprises de voler des poulets de sa ferme avicole. L’homme n’était pas un vagabond, mais quelqu’un qui n’avait pas un emploi stable et défini. C’était une sorte de franc-tireur, un joueur, un maître de nombreux métiers : homme à tout faire, guérisseur autoproclamé, chasseur et fournisseur de spécimens de plantes et d’insectes pour les herboristes et les guérisseurs locaux, et de tout type d’oiseau ou de mammifère pour les taxidermistes ou les animaleries.
Les gens croyaient qu’il gagnait des tonnes d’argent, mais qu’il ne pouvait pas le garder ou l’investir. Ses détracteurs comme ses amis croyaient qu’il aurait pu établir l’entreprise la plus prospère de la région, en faisant ce qu’il savait faire de mieux – chercher des plantes et chasser des animaux – mais qu’il était maudit par une étrange maladie de l’esprit qui le rendait agité, incapable de s’occuper de quoi que ce soit pendant une longue période.
Un jour, alors que je me promenais au bord de la ferme de mon grand-père, j’ai remarqué que quelqu’un m’observait entre les buissons épais à l’orée de la forêt. C’était M. Acosta. Il était accroupi à l’intérieur des buissons de la jungle même et aurait été totalement hors de vue sans mes yeux perçants de huit ans.
« Pas étonnant que mon grand-père pense qu’il vient voler des poulets », pensai-je. Je croyais que personne d’autre que moi n’aurait pu le remarquer ; il était totalement dissimulé par son immobilité. J’avais saisi la différence entre les buissons et sa silhouette par le sentiment plutôt que par la vue. Je me suis approché de lui. Le fait que les gens le rejetaient si violemment, ou l’aimaient si passionnément, m’intriguait au plus haut point.
« Que faites-vous là, M. Acosta ? » ai-je demandé audacieusement.
« Je chie en regardant la ferme de ton grand-père », dit-il, « alors tu ferais mieux de ficher le camp avant que je me lève, à moins que tu n’aimes l’odeur de la merde. »
Je me suis éloigné un peu. Je voulais savoir s’il faisait vraiment ce qu’il prétendait. C’était le cas. Il s’est levé. J’ai pensé qu’il allait quitter le buisson et venir sur les terres de mon grand-père et peut-être traverser jusqu’à la route, mais il ne l’a pas fait. Il a commencé à marcher vers l’intérieur, dans la jungle.
« Hé, hé, M. Acosta ! » ai-je crié. « Puis-je venir avec vous ? »
J’ai remarqué qu’il avait arrêté de marcher ; c’était encore plus un sentiment qu’une vision réelle car le buisson était si dense.
« Tu peux certainement venir avec moi si tu peux trouver une entrée dans le buisson », dit-il.
Ce n’était pas difficile pour moi. Dans mes heures de loisir, j’avais marqué une entrée dans le buisson avec une pierre de bonne taille. J’avais découvert par un processus sans fin d’essais et d’erreurs qu’il y avait un espace pour ramper là, qui, si je le suivais sur trois ou quatre mètres, se transformait en un véritable sentier sur lequel je pouvais me tenir debout et marcher.
M. Acosta est venu vers moi et a dit : « Bravo, gamin ! Tu l’as fait. Oui, viens avec moi si tu veux. »
Ce fut le début de mon association avec M. Leandro Acosta. Nous partions en expéditions de chasse quotidiennes. Notre association devint si évidente, puisque j’étais absent de la maison de l’aube au crépuscule, sans que personne ne sache jamais où j’allais, que finalement mon grand-père m’a sévèrement réprimandé.
« Tu dois choisir tes connaissances », dit-il, « ou tu finiras par être comme eux. Je ne tolérerai pas que cet homme t’affecte de quelque manière que ce soit. Il pourrait certainement te transmettre son élan, oui. Et il pourrait influencer ton esprit à être exactement comme le sien : inutile. Je te le dis, si tu ne mets pas fin à cela, je le ferai. J’enverrai les autorités après lui pour vol de mes poulets, parce que tu sais très bien qu’il vient tous les jours et les vole. »
J’ai essayé de montrer à mon grand-père l’absurdité de ses accusations. M. Acosta n’avait pas besoin de voler des poulets. Il avait l’immensité de cette jungle à sa disposition. Il aurait pu tirer de cette jungle tout ce qu’il voulait. Mais mes arguments ont rendu mon grand-père encore plus furieux. J’ai alors réalisé que mon grand-père enviait secrètement la liberté de M. Acosta, et M. Acosta s’est transformé pour moi, par cette prise de conscience, d’un gentil chasseur en l’expression ultime de ce qui est à la fois interdit et désiré.
J’ai tenté de réduire mes rencontres avec M. Acosta, mais l’attrait était tout simplement trop écrasant pour moi. Puis, un jour, M. Acosta et trois de ses amis ont proposé que je fasse quelque chose que M. Acosta n’avait jamais fait auparavant : attraper un vautour vivant, non blessé. Il m’a expliqué que les vautours de la région, qui étaient énormes, avec une envergure de cinq à six pieds, avaient sept types de chair différents dans leur corps, et que chacun de ces sept types servait à un but curatif spécifique. Il a dit que l’état désiré était que le corps du vautour ne soit pas blessé. Le vautour devait être tué par un tranquillisant, pas par la violence. Il était facile de leur tirer dessus, mais dans ce cas, la viande perdait sa valeur curative. L’art était donc de les attraper vivants, chose qu’il n’avait jamais faite. Il avait cependant compris qu’avec mon aide et l’aide de ses trois amis, il avait le problème résolu. Il m’a assuré que c’était une conclusion naturelle à laquelle il était parvenu après des centaines d’occasions où il avait observé le comportement des vautours.
« Nous avons besoin d’un âne mort pour accomplir cet exploit, ce que nous avons », a-t-il déclaré avec exubérance.
Il m’a regardé, attendant que je pose la question de ce qui serait fait avec l’âne mort. Comme la question n’a pas été posée, il a continué.
« Nous enlevons les intestins, et nous mettons des bâtons là-dedans pour garder la rondeur du ventre. »
« Le chef des urubus à tête rouge est le roi ; il est le plus grand, le plus intelligent », a-t-il poursuivi. « Il n’existe pas d’yeux plus perçants. C’est ce qui fait de lui un roi. C’est lui qui repérera l’âne mort, et le premier qui se posera dessus. Il se posera sous le vent de l’âne pour vraiment sentir qu’il est mort. Les intestins et les organes mous que nous allons retirer du ventre de l’âne, nous les empilerons près de son arrière-train, à l’extérieur. De cette façon, on dirait qu’un chat sauvage en a déjà mangé une partie. »
« Ensuite, paresseusement, le vautour s’approchera de l’âne. Il prendra son temps. Il viendra en sautillant-volant, puis il se posera sur la hanche de l’âne mort et commencera à secouer le corps de l’âne. Il le retournerait s’il n’y avait pas les quatre bâtons que nous planterons dans le sol dans le cadre de l’armature. Il se tiendra sur la hanche pendant un moment ; ce sera le signal pour que d’autres vautours viennent se poser à proximité. Ce n’est que lorsqu’il aura trois ou quatre de ses compagnons avec lui que le roi vautour commencera son travail. »
« Et quel est mon rôle dans tout ça, M. Acosta ? » ai-je demandé.
« Tu te caches à l’intérieur de l’âne », dit-il avec une expression impassible. « Rien de plus simple. Je te donne une paire de gants en cuir spécialement conçus, et tu t’assieds là et tu attends que le roi urubu déchire l’anus de l’âne mort avec son énorme bec puissant et y enfonce la tête pour commencer à manger. Alors tu l’attrapes par le cou avec les deux mains et tu ne le lâches pas. »
« Mes trois amis et moi nous cacherons à cheval dans un ravin profond. J’observerai l’opération avec des jumelles. Quand je verrai que vous avez attrapé le roi vautour par le cou, nous viendrons au galop et nous nous jetterons sur le vautour pour le maîtriser. »
« Pouvez-vous maîtriser ce vautour, M. Acosta ? » lui ai-je demandé. Non pas que je doutasse de son habileté, je voulais juste être rassuré.
« Bien sûr que je le peux ! » dit-il avec toute la confiance du monde. « Nous porterons tous des gants et des jambières en cuir. Les serres du vautour sont assez puissantes. Elles pourraient briser un tibia comme une brindille. »
Il n’y avait aucune issue pour moi. J’étais pris, cloué par une excitation exorbitante. Mon admiration pour M. Leandro Acosta ne connaissait pas de limites à ce moment-là. Je le voyais comme un vrai chasseur – ingénieux, rusé, compétent. « D’accord, alors faisons-le ! » dis-je.
« C’est mon garçon ! » dit M. Acosta. « Je m’attendais à autant de votre part. » Il avait mis une épaisse couverture derrière sa selle, et l’un de ses amis m’a simplement soulevé et m’a mis sur le cheval de M. Acosta, juste derrière la selle, assis sur la couverture.
« Tiens-toi à la selle », dit M. Acosta, « et en te tenant à la selle, tiens aussi la couverture. »
Nous sommes partis au petit trot. Nous avons chevauché pendant peut-être une heure jusqu’à ce que nous arrivions à des terres plates, sèches et désolées. Nous nous sommes arrêtés près d’une tente qui ressemblait à l’étal d’un vendeur sur un marché. Elle avait un toit plat pour l’ombre. Sous ce toit se trouvait un âne brun mort. Il ne semblait pas si vieux ; il ressemblait à un âne adolescent.
Ni M. Acosta ni ses amis ne m’ont expliqué s’ils avaient trouvé ou tué l’âne mort. J’ai attendu qu’ils me le disent, mais je n’allais pas demander. Pendant qu’ils faisaient les préparatifs, M. Acosta a expliqué que la tente était en place parce que les vautours étaient à l’affût à de grandes distances, tournoyant très haut, hors de vue, mais certainement capables de voir tout ce qui se passait.
« Ces créatures sont des créatures de la seule vue », dit M. Acosta. « Elles ont des oreilles misérables, et leur nez n’est pas aussi bon que leurs yeux. Nous devons boucher tous les trous de la carcasse. Je ne veux pas que vous regardiez par un trou, car ils verront votre œil et ne descendront jamais. Ils ne doivent rien voir. »
Ils ont mis des bâtons à l’intérieur du ventre de l’âne et les ont croisés, laissant assez de place pour que je puisse ramper à l’intérieur. À un moment donné, j’ai finalement osé poser la question que je mourais d’envie de poser.
« Dites-moi, M. Acosta, cet âne est sûrement mort de maladie, n’est-ce pas ? Pensez-vous que sa maladie pourrait m’affecter ? »
M. Acosta leva les yeux au ciel. « Allons ! Tu ne peux pas être aussi bête. Les maladies des ânes ne se transmettent pas à l’homme. Vivons cette aventure et ne nous inquiétons pas des détails stupides. Si j’étais plus petit, je serais moi-même à l’intérieur du ventre de cet âne. Sais-tu ce que c’est que d’attraper le roi des urubus ? »
Je l’ai cru. Ses paroles ont suffi à jeter sur moi un manteau de confiance inégalée. Je n’allais pas tomber malade et manquer l’événement des événements.
Le moment redouté est arrivé lorsque M. Acosta m’a mis à l’intérieur de l’âne. Puis ils ont étiré la peau sur l’armature et ont commencé à la coudre pour la fermer. Ils ont néanmoins laissé une grande zone ouverte en bas, contre le sol, pour que l’air puisse circuler. Le moment horrible pour moi est arrivé lorsque la peau a finalement été fermée sur ma tête comme le couvercle d’un cercueil. J’ai respiré fort, ne pensant qu’à l’excitation d’attraper le roi des vautours par le cou.
M. Acosta m’a donné des instructions de dernière minute. Il a dit qu’il me ferait savoir par un sifflement qui ressemblait à un chant d’oiseau quand le roi vautour volerait aux alentours et quand il aurait atterri, afin de me tenir informé et de m’empêcher de m’inquiéter ou de m’impatienter. Puis je les ai entendus démonter la tente, suivi du galop de leurs chevaux s’éloignant. C’était une bonne chose qu’ils n’aient pas laissé un seul espace ouvert pour regarder, car c’est ce que j’aurais fait. La tentation de lever les yeux pour voir ce qui se passait était presque irrésistible.
Un long moment s’est écoulé pendant lequel je n’ai pensé à rien. Puis j’ai entendu le sifflement de M. Acosta et j’ai présumé que le roi vautour tournait en rond. Ma présomption s’est transformée en certitude quand j’ai entendu le battement d’ailes puissantes, puis soudain, le corps de l’âne mort a commencé à se balancer comme s’il était dans une tempête de vent. Puis j’ai senti un poids sur le corps de l’âne, et j’ai su que le roi vautour avait atterri sur l’âne et ne bougeait plus. J’ai entendu le battement d’autres ailes et le sifflement de M. Acosta au loin. Alors je me suis préparé à l’inévitable. Le corps de l’âne a commencé à trembler alors que quelque chose commençait à déchirer la peau.
Puis, soudain, une énorme tête laide avec une crête rouge, un bec énorme et un œil perçant et ouvert a fait irruption. J’ai crié de frayeur et j’ai attrapé le cou avec les deux mains. Je pense que j’ai étourdi le roi vautour un instant car il n’a rien fait, ce qui m’a donné l’occasion de lui serrer le cou encore plus fort, puis l’enfer s’est déchaîné. Il a cessé d’être étourdi et a commencé à tirer avec une telle force que j’ai été écrasé contre la structure, et l’instant d’après, j’étais partiellement hors du corps de l’âne, armature et tout, m’accrochant au cou de la bête envahissante pour ma survie.
J’ai entendu le cheval de M. Acosta galoper au loin. Je l’ai entendu crier : « Lâche, mon garçon, lâche, il va s’envoler avec toi ! »
Le roi vautour allait en effet soit s’envoler avec moi accroché à son cou, soit me déchiqueter avec la force de ses serres. La raison pour laquelle il ne pouvait pas m’atteindre était que sa tête était à moitié enfoncée dans les viscères et l’armature. Ses serres n’arrêtaient pas de glisser sur les intestins lâches et elles ne m’ont jamais réellement touché. Une autre chose qui m’a sauvé, c’est que la force du vautour était employée à retirer son cou de mon étreinte et il ne pouvait pas avancer ses serres assez loin pour me blesser réellement. La chose suivante que je sus, c’est que M. Acosta avait atterri sur le vautour au moment précis où mes gants de cuir me glissaient des mains.
M. Acosta était fou de joie. « On l’a fait, mon garçon, on l’a fait ! » dit-il. « La prochaine fois, nous aurons des piquets plus longs dans le sol que le vautour ne pourra pas arracher, et tu seras attaché à la structure. »
Ma relation avec M. Acosta avait duré assez longtemps pour que nous attrapions un vautour. Puis mon intérêt à le suivre a disparu aussi mystérieusement qu’il était apparu et je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de le remercier pour toutes les choses qu’il m’avait apprises.
Don Juan a dit qu’il m’avait appris la patience d’un chasseur au meilleur moment pour l’apprendre ; et surtout, il m’avait appris à puiser dans la solitude tout le réconfort dont un chasseur a besoin.
« Vous ne pouvez pas confondre la solitude avec l’esseulement », m’a expliqué un jour don Juan. « La solitude pour moi est psychologique, de l’esprit. L’esseulement est physique. L’une est débilitante, l’autre réconfortante. »
Pour tout cela, avait dit don Juan, j’étais redevable à M. Acosta pour toujours, que je comprenne ou non la dette comme les guerriers-voyageurs la comprennent.
La deuxième personne à qui don Juan pensait que j’étais redevable était un enfant de dix ans que j’avais connu en grandissant. Son nom était Armando Velez. Tout comme son nom, il était extrêmement digne, guindé, un petit vieil homme. Je l’aimais beaucoup parce qu’il était ferme et pourtant très amical. C’était quelqu’un qui ne se laissait pas facilement intimider. Il se battait avec n’importe qui s’il le fallait et pourtant il n’était pas du tout une brute.
Nous deux avions l’habitude de partir en expéditions de pêche. Nous attrapions de très petits poissons qui vivaient sous les rochers et devaient être ramassés à la main. Nous mettions les petits poissons que nous attrapions à sécher au soleil et les mangions crus, parfois toute la journée.
J’aimais aussi le fait qu’il était très ingénieux et malin, ainsi qu’ambidextre. Il pouvait lancer une pierre avec sa main gauche plus loin qu’avec sa droite. Nous avions des jeux de compétition sans fin dans lesquels, à mon grand dam, il gagnait toujours. Il avait l’habitude de s’excuser en quelque sorte de gagner en disant : « Si je ralentis et que je te laisse gagner, tu me détesteras. Ce sera un affront à ta virilité. Alors essaie plus fort. »
En raison de son comportement excessivement guindé, nous l’appelions « Señor Velez », mais le « Señor » a été raccourci en « Sho », une coutume typique de la région d’Amérique du Sud d’où je viens.
Un jour, Sho Velez m’a demandé quelque chose d’assez inhabituel. Il a commencé sa demande, naturellement, comme un défi pour moi. « Je parie n’importe quoi », dit-il, « que je sais quelque chose que tu n’oserais pas faire. »
« De quoi parles-tu, Sho Velez ? »
« Tu n’oserais pas descendre une rivière en radeau. »
« Oh si, j’oserais. Je l’ai fait dans une rivière en crue. Je suis resté coincé sur une île pendant huit jours une fois. Ils ont dû me faire dériver de la nourriture. »
C’était la vérité. Mon autre meilleur ami était un enfant surnommé le Berger Fou. Nous sommes restés coincés sur une île lors d’une inondation une fois, sans aucun moyen pour personne de nous secourir. Les habitants de la ville s’attendaient à ce que l’inondation submerge l’île et nous tue tous les deux. Ils ont fait dériver des paniers de nourriture le long de la rivière dans l’espoir qu’ils atterriraient sur l’île, ce qu’ils ont fait. Ils nous ont maintenus en vie de cette manière jusqu’à ce que l’eau ait suffisamment baissé pour qu’ils puissent nous atteindre avec un radeau et nous tirer jusqu’aux rives de la rivière.
« Non, c’est une autre affaire », a poursuivi Sho Velez avec son attitude érudite. « Celle-ci implique de descendre une rivière souterraine en radeau. »
Il a souligné qu’une grande section d’une rivière locale traversait une montagne. Cette section souterraine de la rivière avait toujours été un endroit des plus intrigants pour moi. Son entrée dans la montagne était une grotte inquiétante de taille considérable, toujours remplie de chauves-souris et sentant l’ammoniac. On disait aux enfants de la région que c’était l’entrée de l’enfer : des fumées de soufre, de la chaleur, une puanteur.
« Tu peux parier tes putains de bottes, Sho Velez, que je ne m’approcherai jamais de cette rivière de ma vie ! » ai-je dit en criant. « Pas même en dix vies ! Il faut être vraiment fou pour faire une chose pareille. »
Le visage sérieux de Sho Velez est devenu encore plus solennel. « Oh », dit-il, « alors je devrai le faire tout seul. J’ai pensé un instant que je pourrais t’inciter à venir avec moi. Je me suis trompé. Tant pis pour moi. »
« Hé, Sho Velez, qu’est-ce qui t’arrive ? Pourquoi diable irais-tu dans cet endroit infernal ? »
« Je dois le faire », dit-il de sa petite voix bourrue. « Tu vois, mon père est aussi fou que toi, sauf qu’il est père et mari. Il a six personnes qui dépendent de lui. Sinon, il serait aussi fou qu’une chèvre. Mes deux sœurs, mes deux frères, ma mère et moi dépendons de lui. Il est tout pour nous. »
Je ne savais pas qui était le père de Sho Velez. Je ne l’avais jamais vu. Je ne savais pas ce qu’il faisait dans la vie. Sho Velez a révélé que son père était un homme d’affaires, et que tout ce qu’il possédait était en jeu, pour ainsi dire.
« Mon père a construit un radeau et veut y aller. Il veut faire cette expédition. Ma mère dit qu’il se défoule, mais je ne lui fais pas confiance », a poursuivi Sho Velez. « J’ai vu ton regard fou dans ses yeux. Un de ces jours, il le fera, et je suis sûr qu’il mourra. Alors, je vais prendre son radeau et entrer dans cette rivière moi-même. Je sais que je mourrai, mais mon père ne mourra pas. »
J’ai senti quelque chose comme un choc électrique me parcourir le cou, et je me suis entendu dire sur le ton le plus agité qu’on puisse imaginer : « Je le ferai, Sho Velez, je le ferai. Oui, oui, ce sera génial ! J’irai avec toi ! »
Sho Velez avait un sourire narquois sur le visage. Je l’ai compris comme un sourire de bonheur du fait que j’allais avec lui, et non du fait qu’il avait réussi à m’attirer. Il a exprimé ce sentiment dans sa phrase suivante. « Je sais que si tu es avec moi, je survivrai », dit-il.
Je me fichais que Sho Velez survive ou non. Ce qui m’avait galvanisé, c’était son courage. Je savais que Sho Velez avait le cran de faire ce qu’il disait. Lui et le Berger Fou étaient les seuls enfants courageux de la ville. Ils avaient tous les deux quelque chose que je considérais comme unique et inouï : le courage. Personne d’autre dans toute cette ville n’en avait. Je les avais tous testés. En ce qui me concernait, chacun d’entre eux était mort, y compris l’amour de ma vie, mon grand-père. Je le savais sans l’ombre d’un doute quand j’avais dix ans. L’audace de Sho Velez fut une prise de conscience stupéfiante pour moi. Je voulais être avec lui jusqu’au bout.
Nous avons prévu de nous rencontrer à l’aube, ce que nous avons fait, et nous deux avons porté le radeau léger de son père sur trois ou quatre miles hors de la ville, dans de basses montagnes vertes jusqu’à l’entrée de la grotte où la rivière devenait souterraine. L’odeur de guano de chauve-souris était écrasante. Nous avons rampé sur le radeau et nous nous sommes poussés dans le courant. Le radeau était équipé de lampes de poche, que nous avons dû allumer immédiatement. Il faisait nuit noire à l’intérieur de la montagne, et c’était humide et chaud. L’eau était assez profonde pour le radeau et assez rapide pour que nous n’ayons pas besoin de pagayer.
Les lampes de poche créaient des ombres grotesques. Sho Velez m’a chuchoté à l’oreille qu’il valait peut-être mieux ne pas regarder du tout, car c’était vraiment quelque chose de plus qu’effrayant. Il avait raison ; c’était nauséabond, oppressant. Les lumières ont agité les chauves-souris qui ont commencé à voler autour de nous, battant des ailes sans but. À mesure que nous nous enfoncions plus profondément dans la grotte, il n’y avait même plus de chauves-souris, juste de l’air stagnant, lourd et difficile à respirer. Après ce qui m’a semblé être des heures, nous sommes arrivés à une sorte de bassin où l’eau était très profonde ; elle bougeait à peine. On aurait dit que le courant principal avait été barré.
« Nous sommes coincés », me chuchota de nouveau Sho Velez à l’oreille. « Il n’y a aucun moyen pour le radeau de passer, et aucun moyen pour nous de revenir en arrière. »
Le courant était tout simplement trop fort pour que nous tentions même un voyage de retour. Nous avons décidé que nous devions trouver une sortie. J’ai alors réalisé que si nous nous tenions debout sur le radeau, nous pouvions toucher le plafond de la grotte, ce qui signifiait que l’eau avait été barrée presque jusqu’en haut de la grotte. À l’entrée, elle ressemblait à une cathédrale, d’environ cinquante pieds de haut. Ma seule conclusion était que nous étions au-dessus d’un bassin d’environ cinquante pieds de profondeur.
Nous avons attaché le radeau à un rocher et avons commencé à nager vers les profondeurs, essayant de sentir un mouvement d’eau, un courant. Tout était humide et chaud à la surface, mais très froid à quelques pieds en dessous. Mon corps a senti le changement de température et j’ai eu peur, une étrange peur animale que je n’avais jamais ressentie auparavant. J’ai refait surface. Sho Velez a dû ressentir la même chose. Nous nous sommes heurtés à la surface.
« Je pense que nous sommes sur le point de mourir », dit-il solennellement.
Je ne partageais pas sa solennité ni son désir de mourir. J’ai cherché frénétiquement une ouverture. Les eaux de crue avaient dû charrier des rochers qui avaient créé un barrage. J’ai trouvé un trou assez grand pour que mon corps de dix ans puisse passer. J’ai tiré Sho Velez vers le bas et je lui ai montré le trou. Il était impossible pour le radeau de le traverser. Nous avons retiré nos vêtements du radeau, nous les avons attachés en un paquet très serré et nous avons nagé vers le bas avec eux jusqu’à ce que nous retrouvions le trou et le traversions.
Nous nous sommes retrouvés sur un toboggan aquatique, comme ceux des parcs d’attractions. Des rochers recouverts de lichen et de mousse nous ont permis de glisser sur une grande distance sans nous blesser du tout. Puis nous sommes arrivés dans une énorme grotte aux allures de cathédrale, où l’eau continuait de couler, jusqu’à la taille. Nous avons vu la lumière du ciel au bout de la grotte et nous sommes sortis en pataugeant. Sans dire un mot, nous avons étalé nos vêtements et les avons laissés sécher au soleil, puis nous sommes retournés en ville. Sho Velez était presque inconsolable car il avait perdu le radeau de son père.
« Mon père serait mort là-bas », a-t-il finalement concédé. « Son corps n’aurait jamais traversé le trou par lequel nous sommes passés. Il est trop grand pour ça. Mon père est un homme grand et gros », a-t-il dit. « Mais il aurait été assez fort pour revenir à pied jusqu’à l’entrée. »
J’en doutais. De mémoire, par moments, en raison de l’inclinaison, le courant était étonnamment rapide. J’ai concédé que peut-être un grand homme désespéré aurait finalement pu se frayer un chemin à pied avec l’aide de cordes et beaucoup d’efforts.
La question de savoir si le père de Sho Velez serait mort là-bas ou non n’a pas été résolue alors, mais cela ne m’importait pas. Ce qui importait, c’est que pour la première fois de ma vie, j’avais ressenti le piquant de l’envie. Sho Velez était le seul être que j’aie jamais envié de ma vie. Il avait quelqu’un pour qui mourir, et il m’avait prouvé qu’il le ferait ; je n’avais personne pour qui mourir, et je n’avais rien prouvé du tout.
D’une manière symbolique, j’ai donné à Sho Velez tout le gâteau. Son triomphe était complet. Je me suis retiré. C’était sa ville, c’étaient ses gens, et il était le meilleur d’entre eux en ce qui me concernait. Quand nous nous sommes quittés ce jour-là, j’ai dit une banalité qui s’est avérée être une profonde vérité quand j’ai dit : « Sois le roi d’entre eux, Sho Velez. Tu es le meilleur. »
Je ne lui ai plus jamais parlé. J’ai délibérément mis fin à mon amitié avec lui. J’ai senti que c’était le seul geste que je pouvais faire pour signifier à quel point il m’avait profondément affecté.
Don Juan croyait que ma dette envers Sho Velez était impérissable, qu’il était le seul à m’avoir jamais appris que nous devons avoir quelque chose pour quoi mourir avant de pouvoir penser que nous avons quelque chose pour quoi vivre.
« Si vous n’avez rien pour quoi mourir », m’a dit un jour don Juan, « comment pouvez-vous prétendre que vous avez quelque chose pour quoi vivre ? Les deux vont de pair, avec la mort aux commandes. »
La troisième personne à qui don Juan pensait que j’étais redevable au-delà de ma vie et de ma mort était ma grand-mère du côté de ma mère. Dans mon affection aveugle pour mon grand-père – l’homme – j’avais oublié la véritable source de force de cette maisonnée : ma très excentrique grand-mère.
De nombreuses années avant que je n’arrive dans leur maisonnée, elle avait sauvé un Indien local d’un lynchage. Il était accusé d’être un sorcier. Des jeunes hommes en colère étaient en train de le pendre à un arbre sur la propriété de ma grand-mère. Elle est tombée sur le lynchage et l’a arrêté. Tous les lyncheurs semblaient avoir été ses filleuls et ils n’auraient pas osé s’opposer à elle. Elle a fait descendre l’homme et l’a ramené à la maison pour le soigner. La corde avait déjà coupé une profonde blessure à son cou. Ses blessures ont guéri, mais il n’a jamais quitté le côté de ma grand-mère. Il a prétendu que sa vie s’était terminée le jour du lynchage, et que toute nouvelle vie qu’il avait ne lui appartenait plus ; elle lui appartenait à elle. Étant un homme de parole, il a consacré sa vie à servir ma grand-mère. Il était son valet, son majordome et son conseiller. Mes tantes disaient que c’était lui qui avait conseillé à ma grand-mère d’adopter un nouveau-né orphelin comme son fils, ce qu’elles ressentaient plus qu’amèrement.
Quand je suis arrivé dans la maison de mes grands-parents, le fils adoptif de ma grand-mère avait déjà la fin de la trentaine. Elle l’avait envoyé étudier en France. Un après-midi, de nulle part, un homme costaud et très élégamment habillé est sorti d’un taxi devant la maison. Le chauffeur a porté ses valises en cuir jusqu’au patio. L’homme costaud a généreusement donné un pourboire au chauffeur. J’ai remarqué d’un seul coup d’œil que les traits de l’homme costaud étaient très frappants. Il avait de longs cheveux bouclés, de longs cils bouclés. Il était extrêmement beau sans être physiquement beau. Sa meilleure caractéristique était cependant son sourire radieux et ouvert, qu’il m’a immédiatement adressé.
« Puis-je vous demander votre nom, jeune homme ? » dit-il avec la plus belle voix de scène que j’aie jamais entendue.
Le fait qu’il m’ait appelé jeune homme m’avait instantanément conquis. « Mon nom est Carlos Aranha, monsieur », dis-je, « et puis-je à mon tour vous demander le vôtre ? »
Il a fait un geste de fausse surprise. Il a ouvert de grands yeux et a sauté en arrière comme s’il avait été attaqué. Puis il a commencé à rire bruyamment. Au son de son rire, ma grand-mère est sortie sur le patio. Quand elle a vu l’homme costaud, elle a crié comme une petite fille et lui a jeté les bras autour du cou dans une étreinte des plus affectueuses. Il l’a soulevée comme si elle ne pesait rien et l’a fait tournoyer. J’ai alors remarqué qu’il était très grand. Sa corpulence cachait sa taille. Il avait en fait le corps d’un combattant professionnel. Il a semblé remarquer que je le regardais. Il a fléchi ses biceps.
« J’ai fait un peu de boxe à mon époque, monsieur », dit-il, tout à fait conscient de ce que je pensais.
Ma grand-mère me l’a présenté. Elle a dit qu’il était son fils Antoine, son bébé, la prunelle de ses yeux ; elle a dit qu’il était un dramaturge, un metteur en scène, un écrivain, un poète.
Le fait qu’il soit si athlétique était son ticket gagnant avec moi. Je n’ai pas compris au début qu’il était adopté. J’ai cependant remarqué qu’il ne ressemblait pas du tout au reste de la famille. Alors que tous les membres de ma famille étaient des cadavres qui marchaient, il était vivant, vital de l’intérieur. Nous nous sommes merveilleusement bien entendus. J’aimais le fait qu’il s’entraînait tous les jours, en frappant un sac. J’aimais immensément que non seulement il frappait le sac, mais il le frappait aussi avec les pieds, dans le style le plus étonnant, un mélange de boxe et de coups de pied. Son corps était aussi dur qu’un roc.
Un jour, Antoine m’a avoué que son seul désir fervent dans la vie était d’être un écrivain de renom.
« J’ai tout », dit-il. « La vie a été très généreuse avec moi. La seule chose que je n’ai pas, c’est la seule chose que je veux : le talent. Les muses ne m’aiment pas. J’apprécie ce que je lis, mais je ne peux rien créer que j’aime lire. C’est mon tourment ; il me manque la discipline ou le charme pour séduire les muses, alors ma vie est aussi vide que possible. »
Antoine a poursuivi en me disant que la seule réalité qu’il avait était sa mère. Il appelait ma grand-mère son bastion, son soutien, son âme sœur. Il a fini par m’exprimer une pensée très troublante. « Si je n’avais pas ma mère », dit-il, « je ne vivrais pas. »
J’ai alors réalisé à quel point il était profondément lié à ma grand-mère. Toutes les histoires d’horreur que mes tantes m’avaient racontées sur l’enfant gâté Antoine sont devenues soudainement très vives pour moi. Ma grand-mère l’avait vraiment gâté au-delà de tout salut. Pourtant, ils semblaient si heureux ensemble. Je les voyais assis pendant des heures, sa tête sur ses genoux comme s’il était encore un enfant. Je n’avais jamais entendu ma grand-mère converser avec qui que ce soit pendant de si longues périodes.
Brusquement, un jour, Antoine a commencé à produire beaucoup d’écrits. Il a commencé à mettre en scène une pièce au théâtre local, une pièce qu’il avait écrite lui-même. Quand elle a été montée, ce fut un succès instantané. Ses poèmes ont été publiés dans le journal local. Il semblait avoir atteint une veine créative. Mais seulement quelques mois plus tard, tout a pris fin. Le rédacteur en chef du journal de la ville a publiquement dénoncé Antoine ; il l’a accusé de plagiat et a publié dans le journal la preuve de la culpabilité d’Antoine.
Ma grand-mère, bien sûr, n’a pas voulu entendre parler du mauvais comportement de son fils. Elle a tout expliqué comme un cas de profonde envie. Chacune de ces personnes dans cette ville était envieuse de l’élégance, du style de son fils. Ils étaient envieux de sa personnalité, de son esprit. En effet, il était la personnification de l’élégance et du savoir-faire. Mais il était un plagiaire, c’est sûr ; il n’y avait aucun doute là-dessus.
Antoine n’a jamais expliqué son comportement à personne. Je l’aimais trop pour lui demander quoi que ce soit à ce sujet. De plus, je m’en fichais. Ses raisons étaient ses raisons, en ce qui me concernait. Mais quelque chose s’était brisé ; à partir de ce moment, nos vies ont évolué par sauts et par bonds, pour ainsi dire. Les choses ont changé si radicalement dans la maison d’un jour à l’autre que je me suis habitué à tout attendre, le meilleur ou le pire. Une nuit, ma grand-mère est entrée dans la chambre d’Antoine de la manière la plus dramatique. Il y avait un regard de dureté dans ses yeux que je n’avais jamais vu auparavant. Ses lèvres tremblaient tandis qu’elle parlait.
« Quelque chose de terrible est arrivé, Antoine », a-t-elle commencé.
Antoine l’a interrompue. Il l’a suppliée de le laisser s’expliquer.
Elle l’a coupé brusquement. « Non, Antoine, non », dit-elle fermement. « Cela n’a rien à voir avec toi. Cela a à voir avec moi. En ce moment très difficile pour toi, quelque chose de plus grande importance encore est arrivé. Antoine, mon cher fils, mon temps est écoulé. »
« Je veux que tu comprennes que c’est inévitable », a-t-elle poursuivi. « Je dois partir, mais tu dois rester. Tu es la somme totale de tout ce que j’ai fait dans cette vie. Bon ou mauvais, Antoine, tu es tout ce que je suis. Tente ta chance dans la vie. À la fin, nous serons de toute façon réunis. En attendant, cependant, agis, Antoine, agis. N’importe quoi, peu importe quoi, tant que tu agis. »
J’ai vu le corps d’Antoine trembler d’angoisse. J’ai vu comment il a contracté tout son être, tous les muscles de son corps, toute sa force. C’était comme s’il avait changé de vitesse, passant de son problème, qui était comme une rivière, à l’océan.
« Promets-moi que tu ne mourras pas avant de mourir ! » lui a-t-elle crié.
Antoine a hoché la tête.
Ma grand-mère, le lendemain, sur les conseils de son sorcier-conseiller, a vendu tous ses biens, qui étaient assez considérables, et a remis l’argent à son fils Antoine. Et le jour suivant, très tôt le matin, la scène la plus étrange dont j’aie jamais été témoin s’est déroulée sous mes yeux de dix ans : le moment où Antoine a dit au revoir à sa mère. C’était une scène aussi irréelle que le décor d’un film ; irréelle dans le sens où elle semblait avoir été concoctée, écrite quelque part, créée par une série d’ajustements qu’un écrivain fait et qu’un réalisateur exécute.
Le patio de la maison de mes grands-parents était le décor. Antoine était le protagoniste principal, sa mère l’actrice principale. Antoine voyageait ce jour-là. Il allait au port. Il allait prendre un paquebot italien et traverser l’Atlantique vers l’Europe pour une croisière de loisir. Il était aussi élégamment habillé que jamais. Un chauffeur de taxi l’attendait devant la maison, klaxonnant impatiemment.
J’avais été témoin de la dernière nuit fiévreuse d’Antoine où il avait essayé aussi désespérément que quiconque peut essayer d’écrire un poème pour sa mère.
« C’est de la merde », me dit-il. « Tout ce que j’écris est de la merde. Je ne suis personne. »
Je l’ai assuré, même si je n’étais personne pour l’assurer, que tout ce qu’il écrivait était génial. À un moment donné, je me suis emporté et j’ai franchi certaines limites que je n’aurais jamais dû franchir.
« Crois-moi, Antoine », ai-je crié. « Je suis un pire personne que toi ! Tu as une mère. Je n’ai rien. Tout ce que tu écris est bien. »
Très poliment, il m’a demandé de quitter sa chambre. J’avais réussi à le faire se sentir stupide, d’avoir à écouter les conseils d’un gamin de rien du tout. J’ai amèrement regretté mon emportement. J’aurais aimé qu’il continue à être mon ami.
Antoine avait son élégant pardessus soigneusement plié, drapé sur son épaule droite. Il portait un très beau costume vert, en cachemire anglais.
Ma grand-mère a parlé. « Tu dois te dépêcher, mon cher », dit-elle. « Le temps presse. Tu dois partir. Si tu ne le fais pas, ces gens te tueront pour l’argent. »
Elle faisait référence à ses filles, et à leurs maris, qui étaient au-delà de la fureur quand ils ont découvert que leur mère les avait tranquillement déshérités, et que l’hideux Antoine, leur ennemi juré, allait s’en tirer avec tout ce qui leur revenait de droit.
« Je suis désolée de te faire subir tout ça », s’est excusée ma grand-mère. « Mais, comme tu le sais, le temps est indépendant de nos désirs. »
Antoine a parlé de sa voix grave et magnifiquement modulée. Il sonnait plus que jamais comme un acteur de théâtre. « Cela ne prendra qu’une minute, Mère », dit-il. « J’aimerais lire quelque chose que j’ai écrit pour vous. »
C’était un poème de remerciement. Quand il a eu fini de lire, il a fait une pause. Il y avait une telle richesse de sentiments dans l’air, un tel frémissement.
« C’était d’une beauté pure, Antoine », dit ma grand-mère en soupirant. « Cela exprimait tout ce que vous vouliez dire. Tout ce que je voulais entendre. » Elle fit une pause un instant. Puis ses lèvres s’ouvrirent sur un sourire exquis.
« Plagié, Antoine ? » a-t-elle demandé.
Le sourire d’Antoine en réponse à sa mère était tout aussi radieux. « Bien sûr, Mère », dit-il. « Bien sûr. »
Ils se sont étreints, en pleurant. Le klaxon du taxi a retenti avec encore plus d’impatience. Antoine m’a regardé là où je me cachais sous l’escalier. Il a légèrement hoché la tête, comme pour dire : « Au revoir. Prends soin de toi. » Puis il s’est retourné, et sans regarder à nouveau sa mère, il a couru vers la porte. Il avait trente-sept ans, mais il en paraissait soixante, il semblait porter un poids si gigantesque sur ses épaules. Il s’est arrêté avant d’atteindre la porte, quand il a entendu la voix de sa mère l’admonester pour la dernière fois.
« Ne te retourne pas pour regarder, Antoine », dit-elle. « Ne te retourne jamais pour regarder. Sois heureux, et agis. Agis ! C’est là le truc. Agis ! »
La scène m’a rempli d’une étrange tristesse qui dure jusqu’à ce jour – une mélancolie des plus inexplicables que don Juan a expliquée comme ma première prise de conscience que nous manquons de temps.
Le lendemain, ma grand-mère est partie avec son conseiller/serviteur/valet pour un voyage vers un lieu mythique appelé Rondonia, où son aide-sorcier allait obtenir sa guérison. Ma grand-mère était en phase terminale, bien que je ne le sache pas. Elle n’est jamais revenue, et don Juan a expliqué la vente de ses biens et le fait de les donner à Antoine comme une manœuvre suprême des sorciers exécutée par son conseiller pour la détacher des soins de sa famille. Ils étaient si en colère contre Mère pour son acte qu’ils ne se souciaient pas de savoir si elle reviendrait ou non. J’ai eu le sentiment qu’ils ne se sont même pas rendu compte qu’elle était partie.
Au sommet de cette montagne plate, je me suis remémoré ces trois événements comme s’ils s’étaient produits un instant auparavant. Quand j’ai exprimé mes remerciements à ces trois personnes, j’ai réussi à les ramener à ce sommet de montagne. À la fin de mes cris, ma solitude était quelque chose d’inexprimable. Je pleurais de manière incontrôlable.
Don Juan m’a très patiemment expliqué que la solitude est inadmissible chez un guerrier. Il a dit que les guerriers-voyageurs peuvent compter sur un être sur lequel ils peuvent concentrer tout leur amour, tous leurs soins : cette Terre merveilleuse, la mère, la matrice, l’épicentre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons ; l’être même vers lequel nous retournons tous ; l’être même qui permet aux guerriers-voyageurs de partir pour leur voyage définitif.
Don Genaro a alors procédé à un acte d’intention magique à mon profit. Allongé sur le ventre, il a exécuté une série de mouvements éblouissants. Il est devenu une masse de luminosité qui semblait nager, comme si le sol était une piscine. Don Juan a dit que c’était la manière de Genaro d’étreindre la terre immense, et que malgré la différence de taille, la terre reconnaissait le geste de Genaro. La vue des mouvements de Genaro et leur explication ont remplacé ma solitude par une joie sublime.
« Je ne supporte pas l’idée que vous partiez, don Juan », m’entendis-je dire. Le son de ma voix et ce que j’avais dit m’ont fait sentir gêné. Quand j’ai commencé à sangloter, involontairement, poussé par l’apitoiement sur moi-même, je me suis senti encore plus chagriné. « Qu’est-ce qui ne va pas avec moi, don Juan ? » ai-je marmonné. « Je ne suis pas comme ça d’habitude. »
« Ce qui vous arrive, c’est que votre conscience est de nouveau sur le qui-vive », répondit-il en riant.
Alors j’ai perdu tout vestige de contrôle et je me suis entièrement abandonné à mes sentiments d’abattement et de désespoir.
« Je vais être laissé seul », dis-je d’une voix perçante. « Qu’est-ce qui va m’arriver ? Que vais-je devenir ? »
« Mettons les choses ainsi », dit calmement don Juan. « Pour que je quitte ce monde et que j’affronte l’inconnu, j’ai besoin de toute ma force, de toute ma patience, de toute ma chance ; mais par-dessus tout, j’ai besoin de chaque once du courage d’acier d’un guerrier-voyageur. Pour rester derrière et se débrouiller comme un guerrier-voyageur, vous avez besoin de tout ce dont j’ai moi-même besoin. S’aventurer là-dehors, comme nous allons le faire, n’est pas une plaisanterie, mais rester derrière non plus. »
J’ai eu une explosion d’émotion et j’ai baisé sa main.
« Holà, holà, holà ! » dit-il. « La prochaine chose que vous allez faire, c’est un autel pour mes guaraches ! »
L’angoisse qui m’a saisi s’est transformée d’apitoiement sur moi-même en un sentiment de perte inégalée. « Vous partez ! » ai-je marmonné. « Mon Dieu ! Partir pour toujours ! »
À ce moment, don Juan m’a fait quelque chose qu’il avait fait à plusieurs reprises depuis le premier jour où je l’avais rencontré. Son visage s’est gonflé comme si la profonde inspiration qu’il prenait le gonflait. Il m’a tapé énergiquement dans le dos avec la paume de sa main gauche et a dit : « Relevez-vous de vos orteils ! Soulevez-vous ! »
L’instant d’après, j’étais de nouveau cohérent, complet, en contrôle. Je savais ce qu’on attendait de moi. Il n’y avait plus d’hésitation de ma part, ni d’inquiétude pour moi-même. Peu m’importait ce qui allait m’arriver quand don Juan partirait. Je savais que son départ était imminent. Il m’a regardé, et dans ce regard, ses yeux disaient tout.
« Nous ne serons plus jamais ensemble », dit-il doucement. « Vous n’avez plus besoin de mon aide ; et je ne veux pas vous l’offrir, car si vous valez votre pesant d’or en tant que guerrier-voyageur, vous me cracherez à l’œil pour vous l’offrir. Au-delà d’un certain point, la seule joie d’un guerrier-voyageur est sa solitude. Je n’aimerais pas non plus que vous essayiez de m’aider. Une fois que je serai parti, je serai parti. Ne pensez pas à moi, car je ne penserai pas à vous. Si vous êtes un guerrier-voyageur digne de ce nom, soyez impeccable ! Prenez soin de votre monde. Honorez-le ; gardez-le de votre vie ! »
Il s’est éloigné de moi. Le moment était au-delà de l’apitoiement sur soi, des larmes ou du bonheur. Il a secoué la tête comme pour dire au revoir, ou comme s’il reconnaissait ce que je ressentais.
« Oubliez le soi et vous ne craindrez rien, à quelque niveau de conscience que vous vous trouviez », dit-il.
Il a eu un accès de légèreté. Il m’a taquiné pour la dernière fois sur cette Terre.
« J’espère que vous trouverez l’amour ! » dit-il.
Il a levé sa paume vers moi et a étiré ses doigts comme un enfant, puis les a contractés contre sa paume.
« Ciao », dit-il.
Je savais qu’il était futile d’avoir des regrets ou de regretter quoi que ce soit, et qu’il était aussi difficile pour moi de rester derrière que pour don Juan de partir. Nous étions tous les deux pris dans une manœuvre énergétique irréversible que ni l’un ni l’autre ne pouvait arrêter. Néanmoins, je voulais rejoindre don Juan, le suivre où qu’il aille. La pensée m’a traversé l’esprit que peut-être si je mourais, il m’emmènerait avec lui.
J’ai alors vu comment don Juan Matus, le nagual, a conduit les quinze autres voyants qui étaient ses compagnons, ses pupilles, sa joie, un par un, à disparaître dans la brume de cette mesa, vers le nord. J’ai vu comment chacun d’eux s’est transformé en une masse de luminosité, et ensemble ils sont montés et ont flotté au-dessus du sommet de la montagne comme des lumières fantômes dans le ciel. Ils ont tourné une fois au-dessus de la montagne, comme don Juan avait dit qu’ils le feraient : leur dernière inspection, celle pour leurs yeux seuls ; leur dernier regard sur cette Terre merveilleuse. Et puis ils ont disparu.
Je savais ce que je devais faire. Mon temps était écoulé. Je suis parti à toute vitesse vers le précipice et j’ai sauté dans l’abîme. J’ai senti le vent sur mon visage un instant, puis la plus miséricordieuse des ténèbres m’a avalé comme une paisible rivière souterraine.
(Carlos Castaneda, Le Voyage Définitif)