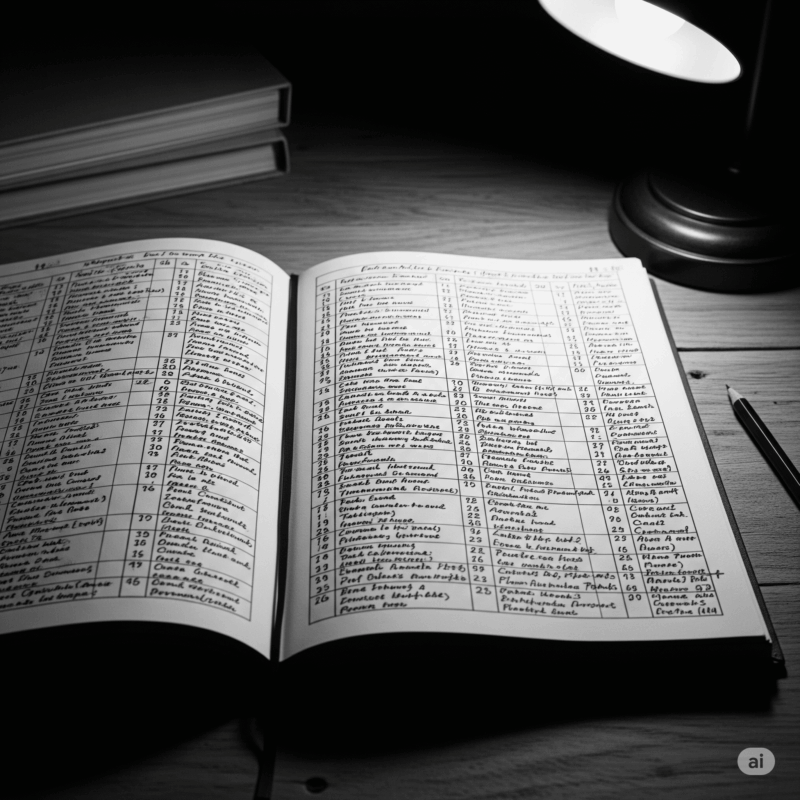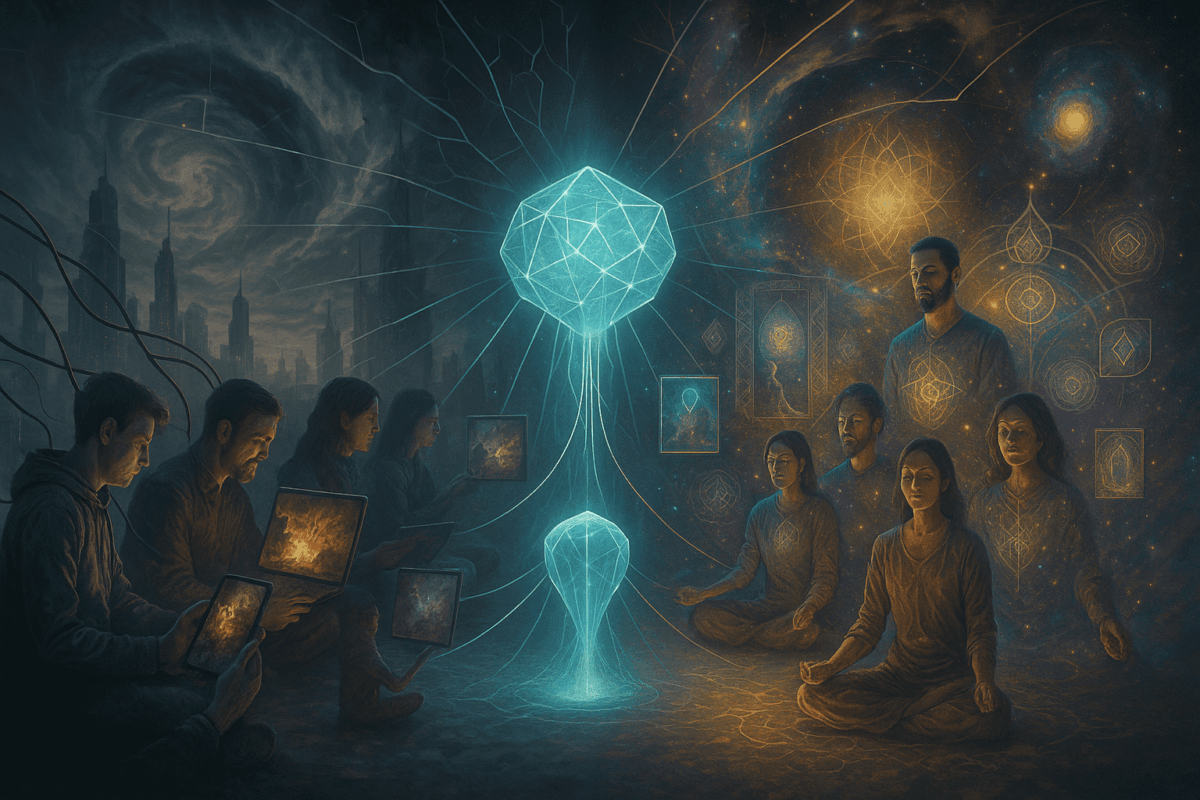Quand don Juan jugea que le moment était venu pour moi d’avoir ma première rencontre avec ses guerriers, il me fit changer de niveau de conscience. Il me fit ensuite comprendre très clairement qu’il n’aurait rien à voir avec leur façon de me rencontrer. Il m’avertit que s’ils décidaient de me battre, il ne pourrait pas les en empêcher. Ils pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient, sauf me tuer. Il souligna à maintes reprises que les guerriers de son groupe étaient une réplique parfaite de ceux de son bienfaiteur, à l’exception que certaines femmes étaient plus féroces, et que tous les hommes étaient absolument uniques et puissants. Par conséquent, ma première rencontre avec eux pourrait ressembler à une collision frontale.
J’étais nerveux et appréhensif d’une part, mais curieux de l’autre. Mon esprit s’emballait avec des spéculations sans fin, la plupart sur l’apparence des guerriers. Don Juan dit qu’il avait le choix soit de m’entraîner à mémoriser un rituel élaboré, comme on l’avait obligé à le faire, soit de rendre la rencontre la plus décontractée possible. Il attendit un présage pour lui indiquer quelle alternative prendre. Son bienfaiteur avait fait quelque chose de similaire, seulement il avait insisté pour que don Juan apprenne le rituel avant que le présage ne se présente. Quand don Juan révéla ses rêveries sexuelles où il couchait avec quatre femmes, son bienfaiteur interpréta cela comme le présage, abandonna le rituel et finit par supplier comme un marchand de porcs pour la vie de don Juan.
Dans mon cas, don Juan voulait un présage avant de m’enseigner le rituel. Ce présage est venu lorsque don Juan et moi traversions une ville frontalière en Arizona et qu’un policier m’a arrêté. Le policier pensait que j’étais un immigrant clandestin. Ce n’est qu’après lui avoir montré mon passeport, qu’il soupçonnait d’être un faux, et d’autres documents, qu’il m’a laissé partir. Don Juan avait été sur le siège avant à côté de moi tout le temps, et le policier ne lui avait pas jeté un second regard. Il s’était concentré uniquement sur moi. Don Juan pensa que l’incident était le présage qu’il attendait. Son interprétation était qu’il serait très dangereux pour moi d’attirer l’attention sur moi, et il en conclut que mon monde devait être d’une simplicité et d’une franchise absolues – les rituels élaborés et la pompe n’étaient pas dans mon caractère. Il concéda cependant qu’une observance minimale de schémas rituels était de mise lorsque je ferais la connaissance de ses guerriers. Je devais commencer par les approcher par le sud, car c’est la direction que suit le pouvoir dans son flux incessant. La force de vie nous vient du sud et nous quitte en s’écoulant vers le nord. Il dit que la seule ouverture vers le monde d’un Nagual se faisait par le sud, et que la porte était formée par deux guerrières, qui devraient m’accueillir et me laisseraient passer si elles en décidaient ainsi.
Il m’emmena dans une ville du centre du Mexique, dans une maison à la campagne. Alors que nous l’approchions à pied depuis une direction sud, j’ai vu deux femmes indiennes massives se tenant à quatre pieds l’une de l’autre, se faisant face. Elles étaient à environ trente ou quarante pieds de la porte principale de la maison, dans une zone où la terre était durement tassée. Les deux femmes étaient extraordinairement musclées et sévères. Toutes deux avaient de longs cheveux noirs de jais réunis en une seule tresse épaisse. Elles ressemblaient à des sœurs. Elles avaient à peu près la même taille et le même poids – j’ai estimé qu’elles devaient mesurer environ cinq pieds quatre et peser 150 livres. L’une d’elles était extrêmement foncée, presque noire, l’autre beaucoup plus claire. Elles étaient habillées comme des femmes indiennes typiques du centre du Mexique – longues robes amples et châles, sandales faites maison.
Don Juan me fit arrêter à trois pieds d’elles. Il se tourna vers la femme à notre gauche et me fit lui faire face. Il dit qu’elle s’appelait Cecilia et qu’elle était une rêveuse. Il se tourna ensuite brusquement, sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit, et me fit faire face à la femme plus foncée, à notre droite. Il dit qu’elle s’appelait Delia et qu’elle était une traqueuse. Les femmes hochèrent la tête vers moi. Elles ne sourirent pas, ne bougèrent pas pour me serrer la main, ni ne firent aucun geste de bienvenue.
Don Juan passa entre elles comme si elles étaient deux colonnes marquant une porte. Il fit quelques pas et se tourna comme s’il attendait que les femmes m’invitent à passer. Les femmes me regardèrent calmement un moment. Puis Cecilia me demanda d’entrer, comme si j’étais au seuil d’une véritable porte.
Don Juan nous conduisit à la maison. À la porte d’entrée, nous trouvâmes un homme. Il était très mince. À première vue, il semblait extrêmement jeune, mais à y regarder de plus près, il paraissait avoir la fin de la cinquantaine. Il me donna l’impression d’être un vieil enfant : petit, sec, avec des yeux noirs perçants. Il était comme une apparition elfique, une ombre. Don Juan me le présenta comme Emilito, et dit qu’il était son courrier et son aide polyvalent, qui m’accueillerait en son nom.
Il me sembla qu’Emilito était en effet l’être le plus approprié pour accueillir quiconque. Son sourire était radieux ; ses petites dents étaient parfaitement alignées. Il me serra la main, ou plutôt il croisa ses avant-bras et me prit les deux mains. Il semblait exsuder le plaisir ; n’importe qui aurait juré qu’il était extatique de me rencontrer. Sa voix était très douce et ses yeux pétillaient.
Nous sommes entrés dans une grande pièce. Il y avait une autre femme là-bas. Don Juan dit qu’elle s’appelait Teresa et qu’elle était la coursière de Cecilia et Delia. Elle avait peut-être la trentaine et ressemblait définitivement à la fille de Cecilia. Elle était très silencieuse mais très amicale. Nous avons suivi don Juan à l’arrière de la maison, où il y avait un porche couvert. C’était une journée chaude. Nous nous sommes assis là autour d’une table, et après un dîner frugal, nous avons parlé jusqu’après minuit.
Emilito était l’hôte. Il a charmé et ravi tout le monde avec ses histoires exotiques. Les femmes se sont ouvertes. Elles étaient un excellent public pour lui. Entendre le rire des femmes était un plaisir exquis. Elles étaient tremendement musclées, audacieuses et physiques. À un moment donné, quand Emilito dit que Cecilia et Delia étaient comme deux mères pour lui, et Teresa comme une fille, elles le soulevèrent et le lancèrent en l’air comme un enfant.
Des deux femmes, Delia semblait la plus rationnelle, la plus terre-à-terre. Cecilia était peut-être plus distante, mais semblait avoir une plus grande force intérieure. Elle me donnait l’impression d’être plus intolérante, ou plus impatiente ; elle semblait s’agacer de certaines histoires d’Emilito. Néanmoins, elle était définitivement sur le qui-vive quand il racontait ce qu’il appelait ses « contes de l’éternité ». Il préfaçait chaque histoire par la phrase : « Savez-vous, chers amis, que… ? » L’histoire qui m’a le plus impressionné concernait des créatures qui, disait-il, existaient dans l’univers, qui étaient ce qui se rapprochait le plus des êtres humains sans être humaines ; des créatures obsédées par le mouvement et capables de détecter la moindre fluctuation en elles-mêmes ou autour d’elles. Ces créatures étaient si sensibles au mouvement que c’était une malédiction pour elles. Cela leur causait une telle douleur que leur ambition ultime était de trouver la quiétude.
Emilito entrecoupait ses contes de l’éternité des blagues salaces les plus scandaleuses. En raison de ses incroyables dons de conteur, j’ai compris chacune de ses histoires comme une métaphore, une parabole, avec laquelle il nous enseignait quelque chose.
Don Juan dit qu’Emilito ne faisait que rapporter des choses qu’il avait vues lors de ses voyages à travers l’éternité. Le rôle d’un courrier était de voyager en avant du Nagual, comme un éclaireur dans une opération militaire. Emilito allait aux limites de la seconde attention, et tout ce qu’il voyait, il le transmettait aux autres.
Ma deuxième rencontre avec les guerriers de don Juan fut tout aussi arrangée que la première. Un jour, don Juan me fit changer de niveau de conscience et me dit que j’avais un deuxième rendez-vous. Il me fit conduire à Zacatecas, dans le nord du Mexique. Nous y sommes arrivés très tôt le matin. Don Juan dit que ce n’était qu’une escale, et que nous avions jusqu’au lendemain pour nous détendre avant d’entreprendre ma deuxième rencontre formelle pour faire la connaissance des femmes de l’est et du guerrier érudit de son groupe. Il expliqua alors un point de choix complexe et délicat. Il dit que nous avions rencontré le sud et le courrier en milieu d’après-midi, parce qu’il avait fait une interprétation individuelle de la règle et avait choisi cette heure pour représenter la nuit. Le sud était vraiment la nuit – une nuit chaude, amicale, confortable – et nous aurions dû aller rencontrer les deux femmes du sud après minuit. Cependant, cela aurait été peu propice pour moi car ma direction générale était vers la lumière, vers l’optimisme, un optimisme qui s’intègre harmonieusement dans le mystère des ténèbres. Il dit que c’était précisément ce que nous avions fait ce jour-là ; nous avions apprécié la compagnie les uns des autres et parlé jusqu’à ce qu’il fasse nuit noire. Je m’étais demandé pourquoi ils n’allumaient pas leurs lanternes.
Don Juan dit que l’est, d’autre part, était le matin, la lumière, et que nous rencontrerions les femmes de l’est le lendemain en milieu de matinée.
Avant le petit-déjeuner, nous sommes allés sur la place et nous nous sommes assis sur un banc. Don Juan me dit qu’il voulait que je reste là et que je l’attende pendant qu’il faisait quelques courses. Il partit et peu après son départ, une femme vint s’asseoir à l’autre bout du banc. Je ne lui prêtai aucune attention et commençai à lire un journal. Un instant plus tard, une autre femme la rejoignit. Je voulais changer de banc, mais je me suis souvenu que don Juan avait spécifiquement dit que je devais m’asseoir là. Je tournai le dos aux femmes et avais même oublié qu’elles étaient là, tant elles étaient silencieuses, quand un homme les salua et se tint face à moi. Je me rendis compte par leur conversation que les femmes l’attendaient. L’homme s’excusa de son retard. Il voulait manifestement s’asseoir. Je me décalai pour lui faire de la place. Il me remercia profusément et s’excusa de me déranger. Il dit qu’ils étaient absolument perdus dans la ville parce qu’ils étaient des gens de la campagne, et qu’une fois ils avaient été à Mexico et avaient failli mourir dans la circulation. Il me demanda si j’habitais à Zacatecas. Je dis non et j’allais mettre fin à notre conversation là, mais il y avait quelque chose de très séduisant dans son sourire. C’était un vieil homme, remarquablement en forme pour son âge. Il n’était pas un Indien. Il semblait être un gentleman-farmer d’une petite ville rurale. Il portait un costume et un chapeau de paille. Ses traits étaient très délicats. Sa peau était presque transparente. Il avait un nez aquilin, une petite bouche et une barbe blanche parfaitement soignée. Il avait l’air extraordinairement en bonne santé et pourtant il semblait frêle. Il était de taille moyenne et bien bâti, mais donnait en même temps l’impression d’être mince, presque efféminé.
Il se leva et se présenta à moi. Il me dit que son nom était Vicente Medrano, et qu’il était venu en ville pour affaires seulement pour la journée. Il désigna ensuite les deux femmes et dit que c’étaient ses sœurs. Les femmes se levèrent et nous firent face. Elles étaient très minces et plus foncées que leur frère. Elles étaient aussi beaucoup plus jeunes. L’une d’elles aurait pu être sa fille. Je remarquai que leur peau n’était pas comme la sienne ; la leur était sèche. Les deux femmes étaient très belles. Comme l’homme, elles avaient des traits fins, et leurs yeux étaient clairs et paisibles. Elles mesuraient environ cinq pieds quatre. Elles portaient des robes magnifiquement taillées, mais avec leurs châles, leurs chaussures à talons bas et leurs bas de coton sombres, elles ressemblaient à des fermières aisées. L’aînée semblait avoir la cinquantaine, la plus jeune la quarantaine.
L’homme me les présenta. L’aînée s’appelait Carmela et la plus jeune Hermelinda. Je me levai et leur serrai brièvement la main. Je leur demandai si elles avaient des enfants. Cette question était généralement un excellent moyen d’engager la conversation pour moi. Les femmes rirent et passèrent à l’unisson leurs mains sur leur ventre pour me montrer à quel point elles étaient minces. L’homme expliqua calmement que ses sœurs étaient des vieilles filles, et qu’il était lui-même un vieux garçon. Il me confia, sur un ton à moitié plaisant, que malheureusement ses sœurs étaient trop masculines, qu’elles manquaient de la féminité qui rend une femme désirable, et qu’elles n’avaient donc pas pu trouver de mari.
Je dis qu’elles étaient mieux ainsi, compte tenu du rôle de soumission des femmes dans notre société. Les femmes n’étaient pas d’accord avec moi ; elles dirent qu’elles n’auraient eu aucun inconvénient à être des servantes si seulement elles avaient trouvé des hommes qui voulaient être leurs maîtres. La plus jeune dit que le vrai problème était que leur père avait omis de leur apprendre à se comporter comme des femmes. L’homme commenta avec un soupir que leur père était si autoritaire qu’il l’avait également empêché de se marier en négligeant délibérément de lui apprendre à être un macho. Tous les trois soupirèrent et parurent sombres. J’avais envie de rire.
Après un long silence, nous nous sommes assis à nouveau et l’homme dit que si je restais un peu plus longtemps sur ce banc, j’aurais la chance de rencontrer leur père, qui était encore très vif pour son âge avancé. Il ajouta d’un ton timide que leur père allait les emmener prendre le petit-déjeuner, car eux-mêmes ne portaient jamais d’argent. Leur père tenait les cordons de la bourse.
J’étais horrifié. Ces personnes âgées qui semblaient si fortes étaient en réalité comme de faibles enfants dépendants. Je leur dis au revoir et me levai pour partir. L’homme et ses sœurs insistèrent pour que je reste. Ils m’assurèrent que leur père adorerait que je me joigne à eux pour le petit-déjeuner. Je ne voulais pas rencontrer leur père et pourtant j’étais curieux. Je leur dis que j’attendais moi-même quelqu’un. À ces mots, les femmes commencèrent à glousser puis éclatèrent d’un rire tonitruant. L’homme s’abandonna également à un rire incontrôlé. Je me sentis stupide, je voulais sortir de là. À ce moment, don Juan apparut et je pris conscience de leur manœuvre. Je ne trouvai pas cela amusant.
Nous nous sommes tous levés. Ils riaient encore quand don Juan me dit que ces femmes étaient l’est, que Carmela était la traqueuse et Hermelinda la rêveuse, et que Vicente était le guerrier érudit et son plus ancien compagnon.
Alors que nous quittions la place, un autre homme nous rejoignit, un grand Indien sombre, peut-être dans la quarantaine. Il portait un jean et un chapeau de cow-boy. Il semblait terriblement fort et maussade. Don Juan me le présenta comme Juan Tuma, le courrier et assistant de recherche de Vicente.
Nous avons marché jusqu’à un restaurant à quelques pâtés de maisons. Les femmes me tenaient entre elles. Carmela dit qu’elle espérait que je n’étais pas offensé par leur blague, qu’elles avaient eu le choix de simplement se présenter à moi ou de me taquiner. Ce qui les avait décidées à me taquiner était mon attitude profondément snob en leur tournant le dos et en voulant changer de banc. Hermelinda ajouta qu’il faut être absolument humble et n’avoir rien à défendre, pas même sa personne ; que sa personne doit être protégée, mais pas défendue. En les snobant, je ne me protégeais pas mais me défendais simplement.
Je me sentis querelleur. J’étais franchement agacé par leur mascarade. Je commençai à argumenter, mais avant d’avoir pu exposer mon point de vue, don Juan vint à mes côtés. Il dit aux deux femmes qu’elles devaient ignorer ma belligérance, qu’il faut très longtemps pour nettoyer les ordures qu’un être lumineux accumule dans le monde.
Le propriétaire du restaurant où nous sommes allés connaissait Vicente et nous avait préparé un somptueux petit-déjeuner. Ils étaient tous de très bonne humeur, mais j’étais incapable de me défaire de ma mauvaise humeur. Puis, à la demande de don Juan, Juan Tuma commença à parler de ses voyages. C’était un homme factuel. Je fus hypnotisé par ses comptes rendus secs de choses dépassant ma compréhension. Pour moi, le plus fascinant fut sa description de certains faisceaux de lumière ou d’énergie qui, prétendument, sillonnent la terre. Il dit que ces faisceaux ne fluctuent pas comme tout le reste dans l’univers, mais sont fixés selon un motif. Ce motif coïncide avec des centaines de points dans le corps lumineux. Hermelinda avait compris que tous les points se trouvaient dans notre corps physique, mais Juan Tuma expliqua que, comme le corps lumineux est assez grand, certains points se trouvent jusqu’à trois pieds du corps physique. En un sens, ils sont à l’extérieur de nous, et pourtant ils ne le sont pas ; ils sont à la périphérie de notre luminosité et appartiennent donc toujours au corps total. Le plus important de ces points est situé à un pied de l’estomac, à 40 degrés à droite d’une ligne imaginaire partant droit devant. Juan Tuma nous dit que c’était un centre d’assemblage pour la seconde attention, et qu’il est possible de le manipuler en caressant doucement l’air avec les paumes des mains. En écoutant Juan Tuma, j’oubliai ma colère.
Ma rencontre suivante avec le monde de don Juan fut avec l’ouest. Il m’avertit amplement que le premier contact avec l’ouest était un événement des plus importants, car il déciderait, d’une manière ou d’une autre, ce que je devrais faire par la suite. Il m’alerta également sur le fait que ce serait un événement éprouvant, surtout pour moi, car j’étais si rigide et me sentais si important. Il dit que l’ouest est naturellement approché au crépuscule, un moment de la journée qui est difficile en soi, et que ses guerriers de l’ouest étaient très puissants, audacieux et carrément exaspérants. En même temps, j’allais aussi rencontrer le guerrier masculin qui était l’homme de l’ombre. Don Juan m’exhorta à exercer la plus grande prudence et patience ; non seulement les femmes étaient folles à lier, mais elles et l’homme étaient les guerriers les plus puissants qu’il ait jamais connus. Ils étaient, à son avis, les autorités ultimes de la seconde attention. Don Juan n’en dit pas plus.
Un jour, comme sur un coup de tête, il décida soudain qu’il était temps de partir en voyage pour rencontrer les femmes de l’ouest. Nous nous sommes rendus en voiture dans une ville du nord du Mexique. Juste au crépuscule, don Juan m’ordonna de m’arrêter devant une grande maison non éclairée à la périphérie de la ville. Nous sommes sortis de la voiture et nous sommes dirigés vers la porte principale. Don Juan frappa plusieurs fois. Personne ne répondit. J’eus le sentiment que nous étions venus au mauvais moment. La maison semblait vide.
Don Juan continua de frapper jusqu’à ce qu’il se lasse apparemment. Il me fit signe de frapper. Il me dit de continuer sans m’arrêter car les gens qui vivaient là étaient durs d’oreille. Je lui demandai s’il ne valait pas mieux revenir plus tard ou le lendemain. Il me dit de continuer à frapper à la porte.
Après une attente apparemment interminable, la porte commença à s’ouvrir lentement. Une femme à l’allure étrange passa la tête et me demanda si mon intention était d’enfoncer la porte ou de mettre en colère les voisins et leurs chiens.
Don Juan s’avança pour dire quelque chose. La femme sortit et le repoussa avec force. Elle commença à agiter son doigt vers moi, criant que je me comportais comme si le monde m’appartenait, comme s’il n’y avait personne d’autre que moi. Je protestai que je ne faisais que ce que don Juan m’avait dit de faire. La femme me demanda si on m’avait dit d’enfoncer la porte. Don Juan tenta d’intervenir mais fut de nouveau repoussé.
La femme avait l’air de sortir du lit. Elle était en désordre. Nos coups avaient probablement dû la réveiller et elle avait dû enfiler une robe de son panier de linge sale. Elle était pieds nus ; ses cheveux grisonnaient et étaient terriblement négligés. Elle avait des yeux rouges et perçants. C’était une femme laide, mais d’une manière ou d’une autre très impressionnante : plutôt grande, environ cinq pieds huit, sombre et énormément musclée ; ses bras nus étaient noués de muscles durs. Je remarquai qu’elle avait des mollets magnifiquement formés.
Elle me toisa de haut en bas, me dominant, et cria qu’elle n’avait pas entendu mes excuses. Don Juan me chuchota que je devais m’excuser fort et clair.
Une fois que je l’eus fait, la femme sourit et se tourna vers don Juan et le serra dans ses bras comme s’il était un enfant. Elle grommela qu’il n’aurait pas dû me faire frapper parce que mon contact sur la porte était trop fuyant et dérangeant. Elle tint le bras de don Juan et le conduisit à l’intérieur, l’aidant à franchir le seuil élevé. Elle l’appelait « très cher petit vieillard ». Don Juan rit. J’étais consterné de le voir agir comme s’il était ravi des absurdités de cette femme effrayante. Une fois qu’elle eut aidé le « très cher petit vieillard » à entrer dans la maison, elle se tourna vers moi et fit un geste de la main pour me chasser, comme si j’étais un chien. Elle rit de ma surprise ; ses dents étaient grandes, inégales et sales. Puis elle sembla changer d’avis et me dit d’entrer.
Don Juan se dirigeait vers une porte que je pouvais à peine voir au bout d’un couloir sombre. La femme le gronda de ne pas savoir où il allait. Elle nous fit passer par un autre couloir sombre. La maison semblait énorme, et il n’y avait pas une seule lumière. La femme ouvrit une porte donnant sur une très grande pièce, presque vide à l’exception de deux vieux fauteuils au centre, sous l’ampoule la plus faible que j’aie jamais vue. C’était une vieille ampoule allongée.
Une autre femme était assise dans l’un des fauteuils. La première femme s’assit sur une petite natte de paille sur le sol et appuya son dos contre l’autre fauteuil. Puis elle mit ses cuisses contre sa poitrine, s’exposant complètement. Elle ne portait pas de sous-vêtements. Je la fixai, abasourdi.
D’un ton laid et bourru, la femme me demanda pourquoi je regardais son vagin. Je ne savais que dire, sauf le nier. Elle se leva et sembla sur le point de me frapper. Elle exigea que je lui dise que je l’avais regardée bouche bée parce que je n’avais jamais vu de vagin de ma vie. Je me sentis coupable. J’étais profondément embarrassé et aussi agacé d’avoir été pris dans une telle situation.
La femme demanda à don Juan quel genre de Nagual j’étais si je n’avais jamais vu de vagin. Elle se mit à le répéter encore et encore, le criant à tue-tête. Elle courut dans la pièce et s’arrêta près du fauteuil où l’autre femme était assise. Elle la secoua par les épaules et, me désignant, dit que j’étais un homme qui n’avait jamais vu de vagin de toute sa vie. Elle rit et se moqua de moi.
J’étais mortifié. Je sentais que don Juan aurait dû faire quelque chose pour me sauver de cette humiliation. Je me suis souvenu qu’il m’avait dit que ces femmes étaient assez folles. Il avait minimisé les choses ; cette femme était bonne pour l’asile. Je regardai don Juan pour obtenir soutien et conseil. Il détourna les yeux. Il semblait être tout aussi désemparé, bien que je crus surprendre un sourire malicieux, qu’il cacha rapidement en tournant la tête.
La femme s’allongea sur le dos et remonta sa jupe, et m’ordonna de regarder à ma guise au lieu de jeter des regards furtifs. Mon visage devait être rouge, à en juger par la chaleur dans ma tête et mon cou. J’étais si agacé que j’ai failli perdre le contrôle. J’avais envie de lui fracasser la tête.
La femme qui était assise dans le fauteuil se leva soudainement, attrapa l’autre par les cheveux et la fit se lever d’un seul mouvement, apparemment sans aucun effort. Elle me fixa à travers des yeux mi-clos, approchant son visage à pas plus de deux ou trois pouces du mien. Elle sentait étonnamment frais.
D’une voix aiguë, elle dit que nous devrions passer aux choses sérieuses. Les deux femmes se tenaient près de moi sous l’ampoule. Elles ne se ressemblaient pas. La seconde femme était plus âgée, ou paraissait plus âgée, et son visage était couvert d’une épaisse couche de poudre cosmétique qui lui donnait une apparence de clown. Ses cheveux étaient soigneusement arrangés en un chignon. Elle semblait calme, à l’exception d’un tremblement continu de sa lèvre inférieure et de son menton. Les deux femmes étaient de taille et de force égales ; elles me dominaient menaçantement et me fixèrent longuement. Don Juan ne fit rien pour briser leur fixation. La femme plus âgée hocha la tête, et don Juan me dit qu’elle s’appelait Zuleica et qu’elle était une rêveuse. La femme qui avait ouvert la porte s’appelait Zoila, et elle était une traqueuse.
Zuleica se tourna vers moi et, d’une voix de perroquet, me demanda s’il était vrai que je n’avais jamais vu de vagin. Don Juan ne put contenir son sang-froid plus longtemps et se mit à rire. D’un geste, je lui signalai que je ne savais pas quoi dire. Il me chuchota à l’oreille qu’il valait mieux pour moi de dire que non ; sinon, je devrais être prêt à décrire un vagin, car c’est ce que Zuleica exigerait que je fasse ensuite.
Je répondis en conséquence, et Zuleica dit qu’elle était désolée pour moi. Puis elle ordonna à Zoila de me montrer son vagin. Zoila s’allongea sur le dos sous l’ampoule et écarta les jambes.
Don Juan riait et toussait. Je le suppliai de me sortir de cet asile de fous. Il me chuchota de nouveau à l’oreille que je ferais mieux de bien regarder et de paraître attentif et intéressé, car si je ne le faisais pas, nous devrions rester là jusqu’à la fin des temps.
Après mon examen attentif et soigneux, Zuleica dit qu’à partir de ce moment, je pourrais me vanter d’être un connaisseur, et que si jamais je tombais sur une femme sans pantalon, je ne serais pas si grossier et obscène au point de faire sortir mes yeux de leurs orbites, car maintenant j’avais vu un vagin.
Zuleica nous conduisit très tranquillement sur le patio. Elle chuchota qu’il y avait quelqu’un là-bas qui attendait de me rencontrer. Le patio était d’un noir d’encre. Je pouvais à peine distinguer les silhouettes des autres. Puis je vis la silhouette sombre d’un homme se tenant à quelques pieds de moi. Mon corps eut un sursaut involontaire.
Don Juan parla à l’homme d’une voix très basse, disant qu’il m’avait amené pour le rencontrer. Il dit mon nom à l’homme. Après un moment de silence, don Juan me dit que le nom de l’homme était Silvio Manuel, et qu’il était le guerrier des ténèbres et le véritable chef de tout le groupe de guerriers. Puis Silvio Manuel me parla. Je pensai qu’il devait avoir un trouble de la parole – sa voix était étouffée et les mots sortaient de lui comme des jets de toux douce.
Il m’ordonna de m’approcher. Alors que j’essayais de m’approcher de lui, il recula, comme s’il flottait. Il me conduisit dans un recoin encore plus sombre d’un couloir, marchant, semblait-il, silencieusement à reculons. Il marmonna quelque chose que je ne pus comprendre. Je voulais parler ; ma gorge me démangeait et était sèche. Il répéta quelque chose deux ou trois fois jusqu’à ce que je comprenne qu’il m’ordonnait de me déshabiller. Il y avait quelque chose d’écrasant dans sa voix et l’obscurité qui l’entourait. J’étais incapable de désobéir. J’enlevai mes vêtements et restai nu, frissonnant de peur et de froid.
Il faisait si sombre que je ne pouvais pas voir si don Juan et les deux femmes étaient là. J’entendis un sifflement doux et prolongé provenant d’une source à quelques pieds de moi ; puis je sentis une brise fraîche. Je réalisai que Silvio Manuel exhalait son souffle sur tout mon corps.
Il me demanda ensuite de m’asseoir sur mes vêtements et de regarder un point lumineux que je pouvais facilement distinguer dans l’obscurité, un point qui semblait émettre une faible lumière ambrée. Je le fixai pendant ce qui me parut des heures, jusqu’à ce que je réalise soudain que le point de luminosité était l’œil gauche de Silvio Manuel. Je pouvais alors distinguer le contour de tout son visage et de son corps. Le couloir n’était pas aussi sombre qu’il l’avait semblé. Silvio Manuel s’avança vers moi et m’aida à me relever. Voir dans le noir avec une telle clarté m’enthousiasma. Je ne me souciais même pas d’être nu ou que, comme je le vis alors, les deux femmes me regardaient. Apparemment, elles pouvaient aussi voir dans le noir ; elles me fixaient. Je voulais mettre mon pantalon, mais Zoila me l’arracha des mains.
Les deux femmes et Silvio Manuel me fixèrent longuement. Puis don Juan sortit de nulle part, me tendit mes chaussures, et Zoila nous conduisit à travers un couloir jusqu’à un patio ouvert avec des arbres. Je distinguai la silhouette sombre d’une femme se tenant au milieu du patio. Don Juan lui parla et elle marmonna quelque chose en réponse. Il me dit qu’elle était une femme du sud, qu’elle s’appelait Marta, et qu’elle était une coursière pour les deux femmes de l’ouest. Marta dit qu’elle pouvait parier que je n’avais jamais été présenté à une femme alors que j’étais nu ; que la procédure normale est de faire connaissance et de se déshabiller ensuite. Elle éclata de rire. Son rire était si agréable, si clair et jeune, qu’il me donna des frissons ; il résonna dans toute la maison, amplifié par l’obscurité et le silence qui y régnaient. Je cherchai le soutien de don Juan. Il était parti, ainsi que Silvio Manuel. J’étais seul avec les trois femmes. Je devins très nerveux et demandai à Marta si elle savait où don Juan était allé. À ce moment précis, quelqu’un me saisit la peau des aisselles. Je criai de douleur. Je savais que c’était Silvio Manuel. Il me souleva comme si je ne pesais rien et me fit tomber mes chaussures. Puis il me plaça dans une bassine peu profonde d’eau glacée qui m’arrivait aux genoux.
Je suis resté longtemps dans la bassine pendant qu’ils me scrutaient tous. Puis Silvio Manuel me souleva de nouveau et me posa à côté de mes chaussures, que quelqu’un avait soigneusement placées à côté de la bassine.
Don Juan sortit de nouveau de nulle part et me tendit mes vêtements. Il chuchota que je devais les mettre et ne rester que le temps d’être poli. Marta me donna une serviette pour me sécher. Je cherchai du regard les deux autres femmes et Silvio Manuel, mais ils n’étaient nulle part en vue.
Marta, don Juan et moi sommes restés dans l’obscurité à parler pendant longtemps. Elle semblait s’adresser principalement à don Juan, mais je croyais être son véritable public. J’attendis un signe de don Juan pour partir, mais il semblait apprécier la conversation agile de Marta. Elle lui dit que Zoila et Zuleica avaient été au sommet de leur folie ce jour-là. Puis elle ajouta pour mon bénéfice qu’elles étaient extrêmement rationnelles la plupart du temps.
Comme si elle révélait un secret, Marta nous raconta que la raison pour laquelle les cheveux de Zoila semblaient si négligés était qu’au moins un tiers d’entre eux étaient les cheveux de Zuleica. Ce qui s’était passé, c’est que les deux avaient eu un moment d’intense camaraderie et s’aidaient mutuellement à se coiffer. Zuleica tressa les cheveux de Zoila comme elle l’avait fait des centaines de fois, sauf que, étant hors de contrôle, elle avait tressé des parties de ses propres cheveux avec ceux de Zoila. Marta dit que lorsqu’elles se levèrent de leurs chaises, elles entrèrent en commotion. Elle courut à leur secours, mais au moment où elle entra dans la pièce, Zuleica avait pris le dessus, et comme elle était plus lucide que Zoila ce jour-là, elle avait décidé de couper la partie des cheveux de Zoila qui était tressée aux siens. Elle s’embrouilla dans la mêlée qui s’ensuivit et coupa ses propres cheveux à la place.
Don Juan riait comme si c’était la chose la plus drôle qui soit. J’entendis de douces explosions de rire ressemblant à de la toux venant de l’obscurité de l’autre côté du patio.
Marta ajouta qu’elle avait dû improviser un chignon jusqu’à ce que les cheveux de Zuleica repoussent.
Je ris avec don Juan. J’aimais bien Marta. Les deux autres femmes m’étaient odieuses ; elles me donnaient une sensation de nausée. Marta, d’autre part, semblait un parangon de calme et de détermination silencieuse. Je ne pouvais pas voir ses traits, mais je l’imaginais très belle. Le son de sa voix était envoûtant.
Elle demanda très poliment à don Juan si j’accepterais quelque chose à manger. Il répondit que je ne me sentais pas à l’aise avec Zuleica et Zoila, et que j’aurais probablement mal au ventre. Marta m’assura que les deux femmes étaient parties et me prit le bras et nous conduisit à travers le couloir le plus sombre encore jusqu’à une cuisine bien éclairée. Le contraste était trop grand pour mes yeux. Je restai dans l’embrasure de la porte en essayant de m’habituer à la lumière.
La cuisine avait un plafond très haut et était assez moderne et adéquate. Nous nous sommes assis dans une sorte de coin-repas. Marta était jeune et très forte ; elle avait une silhouette plantureuse et voluptueuse, un visage rond, un petit nez et une petite bouche. Ses cheveux noirs de jais étaient tressés et enroulés autour de sa tête.
Je pensai qu’elle devait être aussi curieuse de m’examiner que je l’avais été de la voir. Nous nous sommes assis, avons mangé et parlé pendant des heures. J’étais fasciné par elle. C’était une femme sans éducation mais elle me tenait sous son charme avec sa conversation. Elle nous donna des comptes rendus détaillés des choses absurdes que Zoila et Zuleica faisaient quand elles étaient folles.
Alors que nous nous éloignions en voiture, don Juan exprima son admiration pour Marta. Il dit qu’elle était peut-être le plus bel exemple qu’il connaissait de la façon dont la détermination peut affecter un être humain. Sans aucune formation ou préparation, à l’exception de son intention inflexible, Marta avait réussi à s’attaquer à la tâche la plus ardue imaginable, celle de s’occuper de Zoila, Zuleica et Silvio Manuel.
Je demandai à don Juan pourquoi Silvio Manuel avait refusé que je le regarde à la lumière. Il répondit que Silvio Manuel était dans son élément dans l’obscurité, et que j’allais avoir d’innombrables occasions de le voir. Pour notre première rencontre, cependant, il était impératif qu’il se maintienne dans les limites de son pouvoir, l’obscurité de la nuit. Silvio Manuel et les deux femmes vivaient ensemble parce qu’ils formaient une équipe de sorciers redoutables.
Don Juan me conseilla de ne pas porter de jugements hâtifs sur les femmes de l’ouest. Je les avais rencontrées à un moment où elles étaient hors de contrôle, mais leur manque de contrôle ne concernait que le comportement de surface. Elles avaient un noyau intérieur inaltérable ; ainsi, même au moment de leur pire folie, elles étaient capables de rire de leur propre aberration, comme si c’était un spectacle monté par quelqu’un d’autre.
Le cas de Silvio Manuel était différent. Il n’était en aucun cas dérangé ; en fait, c’était sa profonde sobriété qui lui permettait de traiter si efficacement avec ces deux femmes, car lui et elles étaient des extrêmes opposés. Don Juan dit que Silvio Manuel était né ainsi et que tout le monde autour de lui reconnaissait sa différence. Même son bienfaiteur, qui était sévère et impitoyable avec tout le monde, accordait beaucoup d’attention à Silvio Manuel. Il fallut des années à don Juan pour comprendre la raison de cette préférence. En raison de quelque chose d’inexplicable dans sa nature, une fois que Silvio Manuel était entré dans la conscience du côté gauche, il n’en était jamais sorti. Sa propension à rester dans un état de conscience accrue, associée au superbe leadership de son bienfaiteur, lui permit d’arriver avant tout le monde non seulement à la conclusion que la règle est une carte et qu’il existe en fait un autre type de conscience, mais aussi au passage réel vers cet autre monde de conscience. Don Juan dit que Silvio Manuel, de la manière la plus impeccable, équilibra ses gains excessifs en les mettant au service de leur objectif commun. Il devint la force silencieuse derrière don Juan.
Ma dernière rencontre d’introduction avec les guerriers de don Juan fut avec le nord. Don Juan m’emmena dans la ville de Guadalajara pour cette rencontre. Il dit que notre rendez-vous n’était qu’à une courte distance du centre-ville et devait avoir lieu à midi, car le nord était le milieu de la journée. Nous avons quitté l’hôtel vers 11 heures et avons fait une promenade tranquille dans le centre-ville.
Je marchais sans regarder où j’allais, inquiet de la rencontre, et je suis entré en collision frontale avec une dame qui sortait précipitamment d’un magasin. Elle portait des paquets, qui se sont éparpillés sur le sol. Je me suis excusé et j’ai commencé à l’aider à les ramasser. Don Juan m’a pressé de me dépêcher car nous allions être en retard. La dame semblait stupéfaite. Je lui ai tenu le bras. C’était une femme très mince et grande, peut-être dans la soixantaine, très élégamment vêtue. Elle semblait être une dame de la haute société. Elle était d’une politesse exquise et a assumé la responsabilité, disant qu’elle avait été distraite en cherchant son domestique. Elle m’a demandé si je voulais bien l’aider à le localiser dans la foule. Je me suis tourné vers don Juan ; il a dit que le moins que je puisse faire après l’avoir presque tuée était de l’aider.
Je pris ses paquets et nous sommes retournés dans le magasin. Un peu plus loin, j’aperçus un Indien à l’air abandonné qui semblait totalement déplacé là. La dame l’appela et il vint à ses côtés comme un chiot perdu. Il avait l’air sur le point de lui lécher la main.
Don Juan nous attendait devant le magasin. Il expliqua à la dame que nous étions pressés puis lui dit mon nom. La dame sourit gracieusement et initia une poignée de main. Je pensai que dans sa jeunesse, elle avait dû être ravissante, car elle était encore belle et séduisante.
Don Juan se tourna vers moi et dit brusquement que son nom était Nelida, qu’elle était du nord, et qu’elle était une rêveuse. Puis il me fit faire face au domestique et dit que son nom était Genaro Flores, et qu’il était l’homme d’action, le guerrier des actes du groupe. Ma surprise fut totale. Tous les trois eurent un fou rire ; plus mon désarroi était grand, plus ils semblaient s’amuser.
Don Genaro donna les paquets à un groupe d’enfants, leur disant que son employeur, la gentille dame qui parlait, avait acheté ces choses comme cadeau pour eux ; c’était sa bonne action de la journée. Puis nous avons flâné en silence pendant un demi-pâté de maisons. J’étais sans voix. Soudain, Nelida désigna un magasin et nous demanda d’attendre juste un instant car elle devait récupérer une boîte de nylons qu’on lui gardait là. Elle me regarda, souriant, ses yeux brillants, et me dit que, toute plaisanterie mise à part, sorcellerie ou pas, elle devait porter des nylons et des culottes en dentelle. Don Juan et don Genaro rirent comme deux idiots. Je fixai Nelida car je ne pouvais rien faire d’autre. Il y avait quelque chose en elle qui était absolument terrestre et pourtant elle était presque éthérée.
Elle dit en plaisantant à don Juan de me retenir car j’étais sur le point de m’évanouir. Puis elle demanda poliment à don Genaro de courir chercher sa commande auprès d’un vendeur spécifique. Alors qu’il entrait, Nelida sembla changer d’avis et le rappela, mais il n’entendit apparemment pas et disparut à l’intérieur du magasin. Elle s’excusa et courut après lui.
Don Juan me pressa le dos pour me sortir de ma confusion. Il dit que je rencontrerais l’autre femme du nord, dont le nom était Florinda, seule à un autre moment, car elle devait être mon lien vers un autre cycle, une autre humeur. Il décrivit Florinda comme une copie conforme de Nelida, ou vice versa.
Je fis remarquer que Nelida était si sophistiquée et élégante que je pouvais l’imaginer dans un magazine de mode. Le fait qu’elle soit belle et si claire, peut-être d’origine française ou nord-italienne, m’avait surpris. Bien que Vicente ne soit pas non plus un Indien, son apparence rurale le rendait moins anormal. Je demandai à don Juan pourquoi il y avait des non-Indiens dans son monde. Il dit que c’est le pouvoir qui sélectionne les guerriers du groupe d’un Nagual, et qu’il est impossible de connaître ses desseins.
Nous avons attendu devant le magasin pendant peut-être une demi-heure. Don Juan sembla s’impatienter et me demanda d’entrer et de leur dire de se dépêcher. Je suis entré dans le magasin. Ce n’était pas un grand endroit, il n’y avait pas de porte arrière, et pourtant ils n’étaient nulle part en vue. J’ai demandé aux vendeurs, mais ils ne pouvaient pas m’aider.
J’ai confronté don Juan et j’ai exigé de savoir ce qui s’était passé. Il a dit qu’ils avaient soit disparu dans les airs, soit s’étaient faufilés dehors pendant qu’il me tapotait le dos.
Je me suis mis en colère contre lui en disant que la plupart de ses gens étaient des farceurs. Il a ri jusqu’à ce que les larmes coulent sur ses joues. Il a dit que j’étais le dupe idéal. Mon importance personnelle faisait de moi un sujet des plus agréables. Il riait si fort de mon agacement qu’il a dû s’appuyer contre un mur.
La Gorda me fit le récit de sa première rencontre avec les membres du groupe de don Juan. Sa version ne différait que par le contenu ; la forme était la même. Les guerriers furent peut-être un peu plus violents avec elle, mais elle avait compris cela comme leur tentative de la sortir de sa torpeur, et aussi comme une réaction naturelle à ce qu’elle considérait comme sa vilaine personnalité.
En examinant le monde de don Juan, nous avons réalisé qu’il était une réplique du monde de son bienfaiteur. Il pouvait être vu comme étant constitué soit de groupes, soit de maisonnées. Il y avait un groupe de quatre paires indépendantes de sœurs apparentes qui travaillaient et vivaient ensemble ; un autre groupe de trois hommes de l’âge de don Juan et très proches de lui ; une équipe de deux hommes un peu plus jeunes, les courriers Emilito et Juan Tuma ; et enfin une équipe de deux femmes du sud plus jeunes qui semblaient être parentes, Marta et Teresa. À d’autres moments, il pouvait être vu comme étant composé de quatre maisonnées distinctes, situées assez loin les unes des autres dans différentes régions du Mexique. L’une était composée des deux femmes de l’ouest, Zuleica et Zoila, de Silvio Manuel et de la coursière Marta. La suivante était composée des femmes du sud, Cecilia et Delia, du courrier de don Juan, Emilito, et de la coursière Teresa. Une autre maisonnée était formée par les femmes de l’est, Carmela et Hermelinda, Vicente, et le courrier Juan Tuma ; et la dernière, par les femmes du nord, Nelida et Florinda, et don Genaro.
Selon don Juan, son monde n’avait pas l’harmonie et l’équilibre de celui de son bienfaiteur. Les deux seules femmes qui s’équilibraient parfaitement, et qui ressemblaient à des jumelles identiques, étaient les guerrières du nord, Nelida et Florinda. Nelida m’a dit un jour, lors d’une conversation informelle, qu’elles se ressemblaient tellement qu’elles avaient même le même groupe sanguin.
Pour moi, l’une des surprises les plus agréables de notre interaction fut la transformation de Zuleica et Zoila, qui avaient été si odieuses. Elles se révélèrent être, comme don Juan l’avait dit, les guerrières les plus sobres et les plus dévouées imaginables. Je n’en crus pas mes yeux quand je les revis. Leur crise de folie était passée et elles ressemblaient maintenant à deux dames mexicaines bien habillées, grandes, sombres et musclées, avec des yeux noirs brillants comme des morceaux d’obsidienne noire polie. Elles riaient et plaisantaient avec moi sur ce qui s’était passé la nuit de notre première rencontre, comme si quelqu’un d’autre et non elles y avait été impliqué. Je pouvais facilement comprendre le trouble de don Juan avec les guerrières de l’ouest du groupe de son bienfaiteur. Il m’était impossible d’accepter que Zuleica et Zoila puissent jamais se transformer en créatures aussi odieuses et nauséabondes que celles que j’avais rencontrées pour la première fois. Je devais être témoin de leurs métamorphoses de nombreuses fois, mais je ne fus plus jamais capable de les juger aussi sévèrement que lors de notre première rencontre. Plus que toute autre chose, leurs outrages me rendaient triste.
Mais la plus grande surprise pour moi fut Silvio Manuel. Dans l’obscurité de notre première rencontre, je l’avais imaginé comme un homme imposant, un géant écrasant. En fait, il était minuscule, mais pas d’une petitesse osseuse. Son corps était comme celui d’un jockey – petit, mais parfaitement proportionné. Il me semblait qu’il aurait pu être un gymnaste. Son contrôle physique était si remarquable qu’il pouvait se gonfler comme un crapaud, jusqu’à presque deux fois sa taille, en contractant tous les muscles de son corps. Il donnait des démonstrations étonnantes de la façon dont il pouvait disloquer ses articulations et les remettre en place sans aucun signe apparent de douleur. En regardant Silvio Manuel, j’éprouvais toujours un profond sentiment de peur inconnu. Pour moi, il semblait être un visiteur d’un autre temps. Il était d’un teint sombre et pâle, comme une statue de bronze. Ses traits étaient nets ; son nez aquilin, ses lèvres pleines et ses yeux larges et obliques lui donnaient l’apparence d’une figure stylisée sur une fresque maya. Il était amical et chaleureux pendant la journée, mais dès que le crépuscule s’installait, il devenait insondable. Sa voix changeait. Il s’asseyait dans un coin sombre et laissait l’obscurité l’engloutir. Tout ce qui était visible de lui était son œil gauche, qui restait ouvert et acquérait un éclat étrange, rappelant les yeux d’un félin.
Une question secondaire qui a surgi au cours de notre interaction avec les guerriers de don Juan était le sujet de la folie contrôlée. Don Juan m’a donné une explication succincte une fois alors qu’il discutait des deux catégories dans lesquelles toutes les femmes guerrières sont obligatoirement divisées, les rêveuses et les traqueuses. Il a dit que tous les membres de son groupe pratiquaient le rêve et la traque dans leur vie quotidienne, mais que les femmes qui composaient la planète des rêveuses et la planète des traqueuses étaient les plus grandes autorités dans leurs activités respectives.
Les traqueuses sont celles qui subissent le plus durement le monde quotidien. Ce sont les gestionnaires, celles qui traitent avec les gens. Tout ce qui a trait au monde des affaires ordinaires passe par elles. Les traqueuses sont les praticiennes de la folie contrôlée, tout comme les rêveuses sont les praticiennes du rêve. En d’autres termes, la folie contrôlée est la base de la traque, comme les rêves sont la base du rêve. Don Juan a dit que, de manière générale, la plus grande réalisation d’un guerrier dans la seconde attention est le rêve, et dans la première attention, sa plus grande réalisation est la traque.
J’avais mal compris ce que les guerriers de don Juan me faisaient lors de nos premières rencontres. J’ai pris leurs actions comme des exemples de supercherie – et ce serait encore mon impression aujourd’hui sans l’idée de la folie contrôlée. Don Juan a dit que leurs actions avec moi avaient été des leçons magistrales de traque. Il m’a dit que l’art de la traque était ce que son bienfaiteur lui avait enseigné avant toute autre chose. Pour survivre parmi les guerriers de son bienfaiteur, il avait dû apprendre cet art rapidement. Dans mon cas, a-t-il dit, puisque je n’avais pas à lutter seul contre ses guerriers, je devais d’abord apprendre le rêve. Le moment venu, Florinda se manifesterait pour me guider dans les complexités de la traque. Personne d’autre ne pouvait délibérément m’en parler ; ils ne pouvaient que me donner des démonstrations directes, comme ils l’avaient déjà fait lors de nos premières rencontres.
Don Juan m’a expliqué longuement que Florinda était l’une des plus grandes praticiennes de la traque parce qu’elle avait été formée à toutes ses subtilités par son bienfaiteur et ses quatre guerrières qui étaient des traqueuses. Florinda fut la première guerrière à entrer dans le monde de don Juan, et pour cette raison, elle devait être mon guide personnel – non seulement dans l’art de la traque, mais aussi dans le mystère de la troisième attention, si jamais j’y parvenais. Don Juan n’a pas développé ce point. Il a dit que cela devrait attendre que je sois prêt, d’abord à apprendre la traque, puis à entrer dans la troisième attention.
Don Juan a dit que son bienfaiteur avait pris plus de temps et de soin avec lui et ses guerriers dans tout ce qui concernait leur maîtrise de l’art de la traque. Il utilisait des stratagèmes complexes pour créer un contexte approprié pour un contrepoint entre les préceptes de la règle et le comportement des guerriers dans le monde quotidien lorsqu’ils interagissaient avec les gens. Il croyait que c’était la manière de les convaincre que, en l’absence d’importance personnelle, la seule façon pour un guerrier de traiter avec le milieu social est en termes de folie contrôlée.
Au cours de l’élaboration de ses stratagèmes, le bienfaiteur de don Juan opposait les actions des gens et les actions des guerriers aux commandements de la règle, puis il s’asseyait et laissait le drame naturel se dérouler. La folie des gens prenait la tête pendant un certain temps et y entraînait les guerriers, comme semble être le cours naturel des choses, pour être finalement vaincue par les desseins plus vastes de la règle.
Don Juan nous a dit qu’au début, il ressentait du ressentiment envers le contrôle de son bienfaiteur sur les acteurs. Il le lui a même dit en face. Son bienfaiteur n’en fut pas décontenancé. Il a soutenu que son contrôle n’était qu’une illusion créée par l’Aigle. Il n’était qu’un guerrier impeccable, et ses actions étaient une humble tentative de refléter l’Aigle.
Don Juan a dit que la force avec laquelle son bienfaiteur réalisait ses desseins provenait de sa connaissance que l’Aigle est réel et final, et que ce que les gens font est une folie totale. Les deux ensemble ont donné naissance à la folie contrôlée, que le bienfaiteur de don Juan a décrite comme le seul pont entre la folie des gens et la finalité des décrets de l’Aigle.
(Carlos Castaneda, Le Don de l’Aigle)