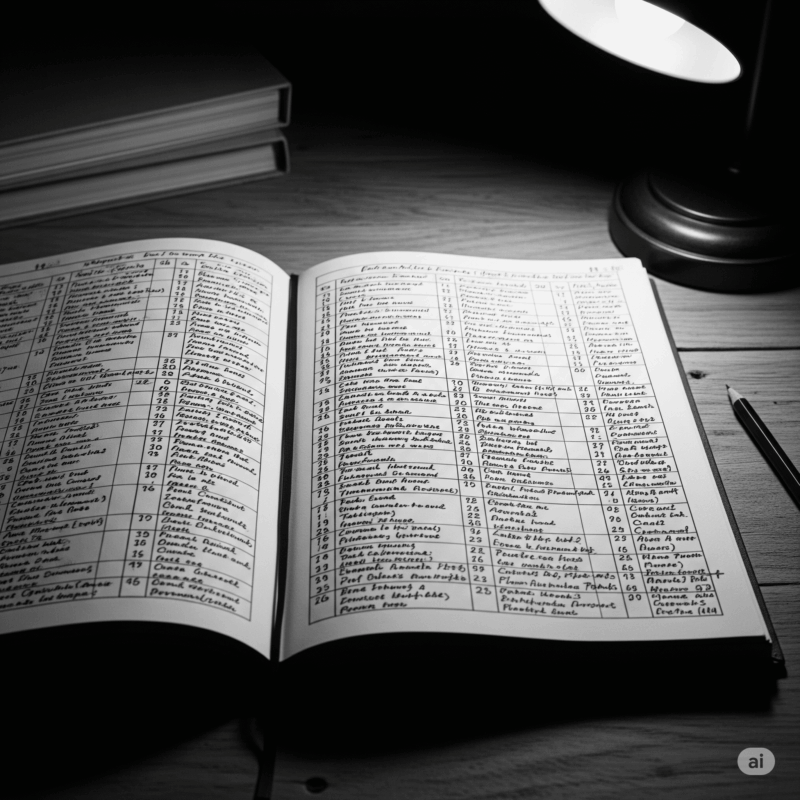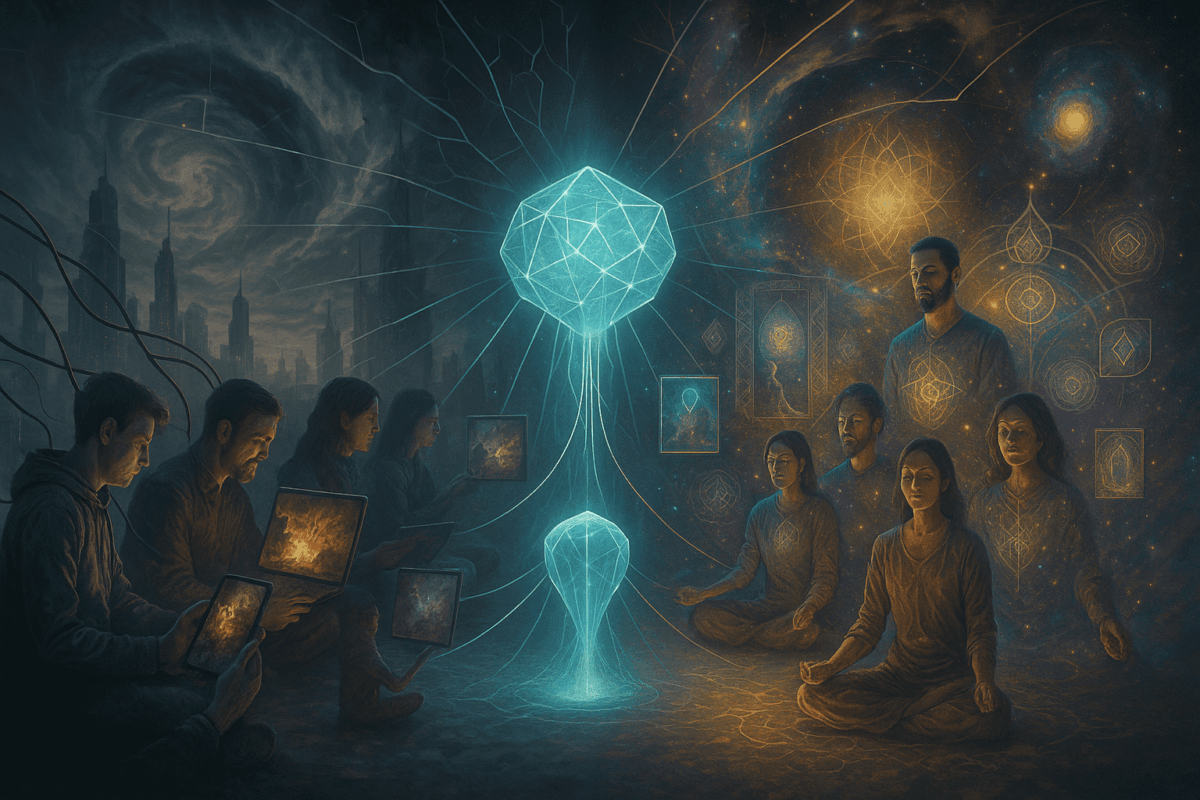Pendant plusieurs semaines après mon retour à Los Angeles, j’ai ressenti un léger malaise que j’ai attribué à des étourdissements ou à une perte soudaine de souffle due à l’effort physique. Cela a atteint son paroxysme une nuit où je me suis réveillé terrifié, incapable de respirer. Le médecin que je suis allé voir a diagnostiqué mon problème comme étant de l’hyperventilation, très probablement causée par la tension. Il m’a prescrit un tranquillisant et a suggéré de respirer dans un sac en papier si la crise se reproduisait.
J’ai décidé de retourner au Mexique pour demander conseil à la Gorda. Après lui avoir communiqué le diagnostic du médecin, elle m’a calmement assuré qu’il ne s’agissait pas d’une maladie, que je perdais enfin mes boucliers, et que ce que je vivais était la « perte de ma forme humaine » et l’entrée dans un nouvel état de séparation des affaires humaines.
« Ne lutte pas contre ça », dit-elle. « Notre réaction naturelle est de lutter contre. En le faisant, nous le dissipons. Laisse tomber ta peur et suis la perte de ta forme humaine pas à pas. »
Elle ajouta que dans son cas, la désintégration de sa forme humaine avait commencé dans son utérus, avec une douleur intense et une pression démesurée qui s’était déplacée lentement dans deux directions, descendant le long de ses jambes et montant jusqu’à sa gorge. Elle a également dit que les effets se font sentir immédiatement.
Je voulais enregistrer chaque nuance de mon entrée dans ce nouvel état. Je me suis préparé à écrire un compte rendu détaillé de tout ce qui se passerait, mais à mon grand dam, rien de plus ne s’est produit. Après quelques jours d’attente infructueuse, j’ai abandonné l’explication de la Gorda et j’ai conclu que le médecin avait correctement diagnostiqué mon état. C’était parfaitement compréhensible pour moi. Je portais une responsabilité qui générait une tension insupportable. J’avais accepté le leadership que les apprentis croyaient m’appartenir, mais je n’avais aucune idée de comment diriger.
La pression dans ma vie se manifestait également d’une manière plus sérieuse. Mon niveau d’énergie habituel baissait constamment. Don Juan aurait dit que je perdais mon pouvoir personnel et que j’allais finir par perdre la vie. Don Juan m’avait préparé à vivre exclusivement au moyen du pouvoir personnel, que je comprenais comme un état d’être, une relation d’ordre entre le sujet et l’univers, une relation qui ne peut être perturbée sans entraîner la mort du sujet. Comme il n’y avait aucun moyen prévisible de changer ma situation, j’avais conclu que ma vie touchait à sa fin. Mon sentiment d’être condamné semblait exaspérer tous les apprentis. J’ai décidé de m’éloigner d’eux pendant quelques jours pour dissiper ma morosité et leur tension.
Quand je suis revenu, je les ai trouvés debout devant la porte d’entrée de la maison des petites sœurs, comme s’ils m’avaient attendu. Nestor a couru vers ma voiture et avant même que j’aie coupé le moteur, il a laissé échapper que Pablito s’était enfui. Il était parti pour mourir, dit Nestor, dans la ville de Tula, le lieu de ses ancêtres. J’étais consterné. Je me sentais coupable.
La Gorda ne partageait pas mon inquiétude. Elle rayonnait, exsudant le contentement.
« Ce petit maquereau est mieux mort », dit-elle. « Nous allons tous vivre ensemble harmonieusement maintenant, comme il se doit. Le Nagual nous a dit que tu allais apporter du changement dans nos vies. Eh bien, tu l’as fait. Pablito ne nous embête plus. Tu t’es débarrassé de lui. Regarde comme nous sommes heureux. Nous sommes mieux sans lui. »
J’étais outré par son insensibilité. J’ai déclaré aussi fermement que possible que don Juan nous avait donné à tous, de la manière la plus minutieuse, le format de la vie d’un guerrier. J’ai souligné que l’impeccabilité du guerrier exigeait que je ne laisse pas Pablito mourir comme ça.
« Et que penses-tu que tu vas faire ? » demanda la Gorda.
« Je vais emmener l’un de vous vivre avec lui », dis-je, « jusqu’au jour où vous tous, y compris Pablito, pourrez déménager d’ici. »
Ils se sont moqués de moi, même Nestor et Benigno, que je pensais être les plus proches de Pablito. La Gorda a ri plus longtemps que quiconque, me défiant manifestement.
Je me suis tourné vers Nestor et Benigno pour un soutien moral. Ils ont détourné le regard.
J’ai fait appel à la compréhension supérieure de la Gorda. Je l’ai suppliée. J’ai utilisé tous les arguments auxquels je pouvais penser. Elle m’a regardé avec un mépris total.
« Allons-y », dit-elle aux autres.
Elle m’a adressé le sourire le plus vide. Elle a haussé les épaules et a fait un vague geste de pincement avec ses lèvres.
« Tu es le bienvenu pour venir avec nous », me dit-elle, « à condition que tu ne poses pas de questions ou que tu ne parles pas de ce petit maquereau. »
« Tu es une guerrière sans forme, Gorda », dis-je. « Tu me l’as dit toi-même. Pourquoi, alors, juges-tu Pablito ? »
La Gorda ne répondit pas. Mais elle accusa le coup. Elle fronça les sourcils et évita mon regard.
« La Gorda est avec nous ! » cria Josefina d’une voix aiguë.
Les trois petites sœurs se sont rassemblées autour de la Gorda et l’ont tirée à l’intérieur de la maison. Je les ai suivies. Nestor et Benigno sont également entrés.
« Qu’est-ce que tu vas faire, prendre l’une de nous par la force ? » me demanda la Gorda.
Je leur ai dit à tous que je considérais comme mon devoir d’aider Pablito et que je ferais de même pour n’importe lequel d’entre eux.
« Tu penses vraiment que tu peux réussir ça ? » me demanda la Gorda, les yeux flamboyants de colère.
Je voulais rugir de rage comme je l’avais fait une fois en leur présence, mais les circonstances étaient différentes. Je ne pouvais pas le faire.
« Je vais emmener Josefina avec moi », dis-je. « Je suis le Nagual. »
La Gorda a rassemblé les trois petites sœurs et les a protégées avec son corps. Elles étaient sur le point de se donner la main. Quelque chose en moi savait que si elles le faisaient, leur force combinée aurait été redoutable et mes efforts pour prendre Josefina auraient été vains. Ma seule chance était de frapper avant qu’elles n’aient eu le temps de se regrouper. J’ai poussé Josefina avec les paumes de mes mains et l’ai envoyée vaciller au centre de la pièce. Avant qu’elles n’aient eu le temps de se regrouper, j’ai frappé Lydia et Rosa. Elles se sont pliées de douleur. La Gorda est venue vers moi avec une fureur que je n’avais jamais vue en elle. C’était comme l’attaque d’une bête sauvage. Toute sa concentration était sur une seule poussée de son corps. Si elle m’avait frappé, j’aurais été tué. Elle a manqué ma poitrine de quelques centimètres. Je l’ai attrapée par derrière dans une étreinte d’ours et nous avons roulé à terre. Nous avons roulé encore et encore jusqu’à ce que nous soyons complètement épuisés. Son corps s’est détendu. Elle a commencé à caresser le dos de mes mains, qui étaient fermement serrées autour de son ventre.
J’ai alors remarqué que Nestor et Benigno se tenaient près de la porte. Ils semblaient tous les deux sur le point de tomber physiquement malades.
La Gorda sourit timidement et me chuchota à l’oreille qu’elle était contente que je l’aie vaincue.
J’ai emmené Josefina à Pablito. Je sentais qu’elle était la seule des apprentis qui avait vraiment besoin que quelqu’un s’occupe d’elle et Pablito était celui qui lui en voulait le moins. J’étais sûr que son sens de la chevalerie le forcerait à lui tendre la main puisqu’elle aurait besoin d’aide.
Un mois plus tard, je suis retourné une fois de plus au Mexique. Pablito et Josefina étaient revenus. Ils vivaient ensemble dans la maison de don Genaro et la partageaient avec Benigno et Rosa. Nestor et Lydia vivaient chez Soledad, et la Gorda vivait seule dans la maison des petites sœurs.
« Est-ce que nos nouveaux arrangements de vie te surprennent ? » demanda la Gorda.
Ma surprise était plus qu’évidente. Je voulais connaître toutes les implications de cette nouvelle organisation.
La Gorda m’a fait savoir d’un ton sec qu’il n’y avait aucune implication qu’elle connaisse. Ils avaient choisi de vivre en couples mais pas comme des couples. Elle ajouta que, contrairement à ce que je pourrais penser, ils étaient des guerriers impeccables.
Le nouveau format était plutôt agréable. Tout le monde semblait complètement détendu. Il n’y avait plus de chamailleries ni d’explosions de comportement compétitif entre eux. Ils avaient également pris l’habitude de s’habiller avec les vêtements indiens typiques de cette région. Les femmes portaient des robes avec des jupes amples et froncées qui touchaient presque le sol. Elles portaient des châles sombres et leurs cheveux en tresses, sauf Josefina, qui portait toujours un chapeau. Les hommes portaient des pantalons et des chemises fins et blancs, semblables à des pyjamas, et des chapeaux de paille. Tous portaient des sandales faites maison.
J’ai demandé à la Gorda la raison de leur nouvelle façon de s’habiller. Elle a dit qu’ils se préparaient à partir. Tôt ou tard, avec mon aide ou par eux-mêmes, ils allaient quitter cette vallée. Ils iraient dans un nouveau monde, une nouvelle vie. Quand ils le feraient, ils reconnaîtraient le changement ; plus longtemps ils porteraient leurs vêtements indiens, plus le changement serait radical quand ils mettraient des vêtements de ville. Elle ajouta qu’on leur avait appris à être fluides, à l’aise dans n’importe quelle situation où ils se trouvaient, et qu’on m’avait appris la même chose. Mon défi était de les traiter avec aisance, peu importe ce qu’ils me faisaient. Leur défi, à leur tour, était de quitter leur vallée et de s’installer ailleurs pour savoir s’ils pouvaient être aussi fluides que des guerriers devraient l’être.
Je lui ai demandé son opinion honnête sur nos chances de réussir. Elle a dit que l’échec était écrit sur tous nos visages.
La Gorda changea brusquement de sujet et me dit que dans son rêve, elle s’était retrouvée à regarder une gigantesque gorge étroite entre deux énormes montagnes rondes ; elle pensait que les deux montagnes lui étaient familières et voulait que je la conduise à une ville voisine. Elle croyait, sans savoir pourquoi, que les deux montagnes se trouvaient là, et que le message de son rêve était que nous devions y aller tous les deux.
Nous sommes partis à l’aube. J’avais déjà traversé cette ville en voiture. Elle était très petite et je n’avais jamais rien remarqué dans ses environs qui se rapproche de près ou de loin de la vision de la Gorda. Il n’y avait que des collines érodées autour. Il s’est avéré que les deux montagnes n’étaient pas là, ou si elles y étaient, nous ne pouvions pas les trouver.
Pendant les deux heures que nous avons passées dans cette ville, cependant, nous avons tous les deux eu le sentiment de savoir quelque chose d’indéfini, un sentiment qui se transformait parfois en certitude puis se retirait à nouveau dans l’obscurité pour ne devenir que de l’agacement et de la frustration. Visiter cette ville nous a troublés de manière mystérieuse ; ou plutôt, pour des raisons inconnues, nous sommes devenus très agités. J’étais en proie à un conflit des plus illogiques. Je ne me souvenais pas m’être jamais arrêté dans cette ville, et pourtant j’aurais pu jurer que non seulement j’y avais été, mais que j’y avais vécu pendant un certain temps. Ce n’était pas un souvenir clair ; je ne me souvenais ni des rues ni des maisons. Ce que je ressentais, c’était une appréhension vague mais forte que quelque chose allait s’éclaircir dans mon esprit. Je n’étais pas sûr de quoi, un souvenir peut-être. Par moments, cette vague appréhension devenait primordiale, surtout quand je voyais une maison particulière. Je me suis garé devant. La Gorda et moi l’avons regardée depuis la voiture pendant peut-être une heure, mais aucun de nous n’a suggéré de quitter la voiture pour y entrer.
Nous étions tous les deux très nerveux. Nous avons commencé à parler de sa vision des deux montagnes ; notre conversation s’est rapidement transformée en dispute. Elle pensait que je n’avais pas pris son rêve au sérieux. Nos humeurs se sont enflammées et nous avons fini par nous crier dessus, moins par colère que par nervosité. Je me suis ressaisi et j’ai arrêté.
Sur le chemin du retour, j’ai garé la voiture sur le bord de la route de terre. Nous sommes sortis pour nous dégourdir les jambes. Nous avons marché un moment ; il y avait trop de vent pour en profiter. La Gorda semblait toujours agitée. Nous sommes retournés à la voiture et nous nous sommes assis à l’intérieur.
« Si seulement tu pouvais rallier ton savoir », dit la Gorda d’un ton suppliant. « Tu saurais que perdre la forme humaine… »
Elle s’arrêta au milieu de sa phrase ; mon froncement de sourcils a dû la couper court. Elle était consciente de ma lutte. S’il y avait un savoir en moi que j’aurais pu consciemment rallier, je l’aurais déjà fait.
« Mais nous sommes des êtres lumineux », dit-elle du même ton suppliant. « Il y a tellement plus en nous. Tu es le Nagual. Il y a encore plus en toi. »
« Que penses-tu que je devrais faire ? » demandai-je.
« Tu dois lâcher ton désir de t’accrocher », dit-elle. « La même chose m’est arrivée. Je m’accrochais à des choses, comme la nourriture que j’aimais, les montagnes où je vivais, les gens avec qui j’aimais parler. Mais surtout, je m’accrochais au désir d’être aimée. »
Je lui ai dit que son conseil n’avait aucun sens pour moi, car je n’avais pas conscience de m’accrocher à quoi que ce soit. Elle a insisté sur le fait que, d’une manière ou d’une autre, je savais que je mettais des barrières à la perte de ma forme humaine.
« Notre attention est entraînée à se concentrer obstinément », poursuivit-elle. « C’est ainsi que nous maintenons le monde. Ta première attention a été enseignée à se concentrer sur quelque chose qui m’est assez étrange, mais très familier pour toi. »
Je lui ai dit que mon esprit s’attarde sur des abstractions – pas des abstractions comme les mathématiques, par exemple, mais plutôt des propositions de raisonnabilité.
« Il est temps de lâcher tout ça maintenant », dit-elle. « Pour perdre ta forme humaine, tu devrais lâcher tout ce lest. Tu contrebalances si fort que tu te paralyses. »
Je n’étais pas d’humeur à discuter. Ce qu’elle appelait perdre la forme humaine était un concept trop vague pour une considération immédiate. J’étais préoccupé par ce que nous avions vécu dans cette ville. La Gorda ne voulait pas en parler.
« La seule chose qui compte, c’est que tu rallies ton savoir », dit-elle. « Tu peux le faire si tu en as besoin, comme ce jour où Pablito s’est enfui et où toi et moi en sommes venus aux mains. »
La Gorda a dit que ce qui s’était passé ce jour-là était un exemple de « ralliement de son savoir ». Sans être pleinement conscient de ce que je faisais, j’avais effectué des manœuvres complexes qui exigeaient de voir.
« Tu ne nous as pas seulement attaqués », dit-elle. « Tu as vu. »
Elle avait raison, d’une certaine manière. Quelque chose de tout à fait extraordinaire s’était produit à cette occasion. Je l’avais considéré en grand détail, le confinant cependant à une spéculation purement personnelle. Je n’avais aucune explication adéquate, si ce n’est de dire que la charge émotionnelle du moment m’avait affecté de manière inconcevable.
Quand je suis entré dans leur maison et que j’ai fait face aux quatre femmes, j’ai pris conscience en une fraction de seconde que j’étais capable de changer ma manière ordinaire de percevoir. J’ai vu quatre masses amorphes de lumière ambrée très intense devant moi. L’une d’elles était plus douce, plus agréable. Les trois autres étaient des lueurs hostiles, vives, d’un ambre blanchâtre. La lueur douce était la Gorda. Et à ce moment-là, les trois lueurs hostiles planaient menaçantes au-dessus d’elle.
La masse de luminosité blanchâtre la plus proche de moi, qui était Josefina, était un peu déséquilibrée. Elle penchait, alors je lui ai donné une poussée. J’ai donné un coup de pied aux deux autres dans une dépression qu’elles avaient chacune sur leur côté droit. Je n’avais aucune idée consciente que je devais leur donner un coup de pied là. J’ai simplement trouvé l’indentation pratique – d’une certaine manière, elle m’invitait à y mettre mon pied. Le résultat a été dévastateur. Lydia et Rosa se sont évanouies sur-le-champ. Je leur avais donné un coup de pied à chacune sur la cuisse droite. Ce n’était pas un coup de pied qui aurait pu casser des os, j’ai seulement poussé les masses de lumière devant moi avec mon pied. Néanmoins, c’était comme si je leur avais donné un coup féroce dans la partie la plus vulnérable de leur corps.
La Gorda avait raison, j’avais rallié un savoir dont je n’étais pas conscient. Si cela s’appelait voir, la conclusion logique pour mon intellect serait de dire que voir est une connaissance corporelle. La prédominance du sens visuel en nous influence cette connaissance corporelle et la fait paraître liée aux yeux. Ce que j’ai vécu n’était pas entièrement visuel. J’ai vu les masses de lumière avec autre chose que mes yeux, puisque j’étais conscient que les quatre femmes étaient dans mon champ de vision pendant tout le temps que je les ai traitées. Les masses de lumière n’étaient même pas superposées à elles. Les deux ensembles d’images étaient séparés. Ce qui compliquait le problème pour moi, c’était la question du temps. Tout était comprimé en quelques secondes. Si j’ai bien changé d’une scène à l’autre, le changement a dû être si rapide qu’il est devenu insignifiant, donc je ne peux me souvenir que d’avoir perçu deux scènes distinctes simultanément.
Après avoir donné un coup de pied aux deux masses de lumière, la douce – la Gorda – est venue vers moi. Elle n’est pas venue droit sur moi, mais a oblique vers ma gauche dès qu’elle a commencé à bouger ; elle avait manifestement l’intention de me manquer, alors quand la lueur est passée, je l’ai attrapée. En roulant encore et encore sur le sol avec elle, j’ai senti que je me fondais en elle. C’est la seule fois où j’ai vraiment perdu le sens de la continuité. J’ai de nouveau pris conscience de moi-même pendant que la Gorda caressait le dos de mes mains.
« Dans notre rêve, les petites sœurs et moi avons appris à nous donner la main », dit la Gorda. « Nous savons comment faire une ligne. Notre problème ce jour-là était que nous n’avions jamais fait cette ligne en dehors de notre chambre. C’est pourquoi elles m’ont traînée à l’intérieur. Ton corps savait ce que cela signifiait pour nous de nous donner la main. Si nous l’avions fait, j’aurais été sous leur contrôle. Elles sont plus féroces que moi. Leurs corps sont hermétiquement scellés ; elles ne se soucient pas du sexe. Moi si. Cela me rend plus faible. Je suis sûre que ton souci du sexe est ce qui te rend très difficile de rallier ton savoir. »
Elle a continué à parler des effets débilitants des relations sexuelles. Je me sentais mal à l’aise. J’ai essayé de détourner la conversation de ce sujet, mais elle semblait déterminée à y revenir malgré mon inconfort.
« Et si toi et moi allions en voiture à Mexico ? » dis-je en désespoir de cause.
Je pensais que je la choquerais. Elle ne répondit pas. Elle pinça les lèvres, plissant les yeux. Elle contracta les muscles de son menton, poussant sa lèvre supérieure jusqu’à ce qu’elle bombe sous son nez. Son visage devint si déformé que j’en fus déconcerté. Elle réagit à ma surprise et détendit ses muscles faciaux.
« Allez, Gorda », dis-je. « Allons à Mexico. »
« Bien sûr. Pourquoi pas ? » dit-elle. « De quoi ai-je besoin ? »
Je ne m’attendais pas à cette réaction et j’ai fini par être choqué moi-même.
« De rien », dis-je. « Nous irons comme nous sommes. »
Sans dire un autre mot, elle s’affaissa sur le siège et nous sommes partis en direction de Mexico. Il était encore tôt, pas même midi. Je lui ai demandé si elle oserait aller à Los Angeles avec moi. Elle fut pensive un instant.
« Je viens de poser cette question à mon corps lumineux », dit-elle.
« Qu’a-t-il dit ? »
« Il a dit seulement si le pouvoir le permet. »
Il y avait une telle richesse de sentiment dans sa voix que j’ai arrêté la voiture et l’ai serrée dans mes bras. Mon affection pour elle à ce moment-là était si profonde que j’en ai eu peur. Cela n’avait rien à voir avec le sexe ou le besoin de renforcement psychologique ; c’était un sentiment qui transcendait tout ce que je connaissais. Étreindre la Gorda a ramené le sentiment que j’avais eu plus tôt, que quelque chose en moi qui était embouteillé, poussé dans des recoins que je ne pouvais pas atteindre consciemment, était sur le point de sortir. J’ai presque su alors ce que c’était, mais je l’ai perdu quand j’ai tendu la main pour l’attraper.
La Gorda et moi sommes arrivés dans la ville d’Oaxaca en début de soirée. J’ai garé ma voiture dans une rue latérale, puis nous avons marché jusqu’au centre-ville, jusqu’à la place. Nous avons cherché le banc où don Juan et don Genaro avaient l’habitude de s’asseoir. Il était inoccupé. Nous nous y sommes assis dans un silence respectueux. Finalement, la Gorda a dit qu’elle y avait été avec don Juan de nombreuses fois ainsi qu’avec quelqu’un d’autre dont elle ne se souvenait pas. Elle n’était pas sûre si c’était quelque chose qu’elle avait simplement rêvé.
« Que faisais-tu avec don Juan sur ce banc ? » lui demandai-je.
« Rien. Nous étions juste assis à attendre le bus, ou le camion de bois qui nous ramènerait dans les montagnes », répondit-elle.
Je lui ai dit que lorsque je m’asseyais sur ce banc avec don Juan, nous parlions pendant des heures.
Je lui ai raconté la grande prédilection qu’il avait pour la poésie, et comment je lui en lisais quand nous n’avions rien d’autre à faire. Il écoutait des poèmes en partant du principe que seule la première ou parfois la deuxième strophe valait la peine d’être lue ; le reste, il le trouvait être de la complaisance de la part du poète. Il y avait très peu de poèmes, parmi les centaines que j’ai dû lui lire, qu’il a écoutés jusqu’au bout. Au début, je lui lisais ce que j’aimais ; ma préférence allait à la poésie abstraite, alambiquée, cérébrale. Plus tard, il m’a fait lire et relire ce qu’il aimait. À son avis, un poème devait être compact, de préférence court. Et il devait être composé d’images précises et poignantes d’une grande simplicité.
En fin d’après-midi, assis sur ce banc à Oaxaca, un poème de César Vallejo semblait toujours résumer pour lui un sentiment particulier de désir. Je l’ai récité à la Gorda de mémoire, moins pour son bénéfice que pour le mien.
Je me demande ce qu’elle fait à cette heure
ma Rita andine et douce
de roseaux et de cerisiers sauvages.
Maintenant que cette lassitude m’étouffe, et que le sang s’endort,
comme de l’eau-de-vie paresseuse en moi.
Je me demande ce qu’elle fait de ces mains
qui, dans une attitude de pénitence,
repassaient une blancheur amidonnée,
les après-midi.
Maintenant que cette pluie m’enlève l’envie de continuer.
Je me demande ce qu’est devenue sa jupe à dentelle ;
de ses labeurs ; de sa démarche ;
de son parfum de canne à sucre printanière de là-bas.
Elle doit être à la porte,
regardant un nuage qui passe vite.
Un oiseau sauvage sur le toit de tuiles poussera un cri ;
et frissonnant, elle dira enfin : « Jésus, qu’il fait froid ! »
Le souvenir de don Juan était incroyablement vif. Ce n’était pas un souvenir au niveau de ma pensée, ni au niveau de mes sentiments conscients. C’était un genre de souvenir inconnu qui me faisait pleurer. Les larmes coulaient de mes yeux, mais elles n’étaient pas du tout apaisantes.
La dernière heure de l’après-midi avait toujours eu une signification particulière pour don Juan. J’avais accepté son respect pour cette heure, et sa conviction que si quelque chose d’important devait m’arriver, ce devrait être à ce moment-là.
La Gorda a posé sa tête sur mon épaule. J’ai reposé ma tête sur la sienne. Nous sommes restés dans cette position pendant un certain temps. Je me sentais détendu ; l’agitation avait été chassée de moi. C’était étrange que le simple fait de reposer ma tête sur celle de la Gorda apporte une telle paix. J’ai voulu faire une blague et lui dire que nous devrions nous attacher la tête ensemble. Puis j’ai su qu’elle me prendrait réellement au mot. Mon corps a été secoué d’un rire et j’ai réalisé que j’étais endormi, mais mes yeux étaient ouverts ; si j’avais vraiment voulu, j’aurais pu me lever. Je ne voulais pas bouger, alors je suis resté là, pleinement éveillé et pourtant endormi. J’ai vu des gens passer et nous regarder fixement. Cela ne me dérangeait pas le moins du monde. D’habitude, j’aurais objecté à être remarqué. Puis, tout à coup, les gens devant moi se sont transformés en très grosses masses de lumière blanche. Je faisais face aux œufs lumineux de manière soutenue pour la première fois de ma vie ! Don Juan m’avait dit que les êtres humains apparaissent au voyant comme des œufs lumineux. J’avais eu des éclairs de cette perception, mais jamais auparavant je n’avais focalisé ma vision sur eux comme je le faisais ce jour-là.
Les masses de lumière étaient assez amorphes au début. C’était comme si mes yeux n’étaient pas correctement focalisés. Mais ensuite, à un moment donné, c’était comme si j’avais enfin arrangé ma vision et les masses de lumière blanche sont devenues des œufs lumineux oblongs. Ils étaient grands, en fait, ils étaient énormes, peut-être sept pieds de haut sur quatre pieds de large ou même plus.
À un moment donné, j’ai remarqué que les œufs ne bougeaient plus. J’ai vu une masse solide de luminosité devant moi. Les œufs me regardaient ; planant dangereusement au-dessus de moi. Je me suis déplacé délibérément et me suis assis droit. La Gorda dormait profondément sur mon épaule. Il y avait un groupe d’adolescents autour de nous. Ils ont dû penser que nous étions ivres. Ils nous imitaient. L’adolescent le plus audacieux touchait les seins de la Gorda. Je l’ai secouée et réveillée. Nous nous sommes levés précipitamment et sommes partis. Ils nous ont suivis, nous narguant et criant des obscénités. La présence d’un policier au coin de la rue les a dissuadés de continuer leur harcèlement. Nous avons marché en silence complet de la place jusqu’à l’endroit où j’avais laissé ma voiture. C’était presque le soir. Soudain, la Gorda m’a attrapé le bras. Ses yeux étaient fous, sa bouche ouverte. Elle a pointé du doigt.
« Regarde ! Regarde ! » cria-t-elle. « Voilà le Nagual et Genaro ! »
J’ai vu deux hommes tourner au coin d’une longue rue devant nous. La Gorda est partie en courant. En courant après elle, je lui ai demandé si elle était sûre. Elle était hors d’elle. Elle a dit que lorsqu’elle avait levé les yeux, don Juan et don Genaro la regardaient fixement. Au moment où ses yeux ont rencontré les leurs, ils se sont éloignés.
Quand nous sommes arrivés nous-mêmes au coin de la rue, les deux hommes étaient toujours à la même distance de nous. Je ne pouvais pas distinguer leurs traits. Ils étaient habillés comme des hommes ruraux mexicains. Ils portaient des chapeaux de paille. L’un était costaud, comme don Juan, l’autre était mince, comme don Genaro. Les deux hommes ont tourné à un autre coin et nous avons de nouveau couru bruyamment après eux. La rue dans laquelle ils avaient tourné était déserte et menait à la périphérie de la ville. Elle courbait légèrement vers la gauche. Les deux hommes étaient juste à l’endroit où la rue courbait. C’est alors que quelque chose s’est produit qui m’a fait sentir qu’il était possible qu’ils soient vraiment don Juan et don Genaro. C’était un mouvement que l’homme le plus petit a fait. Il s’est tourné de trois quarts de profil vers nous et a incliné la tête comme pour nous dire de le suivre, quelque chose que don Genaro avait l’habitude de me faire chaque fois que nous étions dans les bois. Il marchait toujours devant moi, me défiant, m’incitant d’un mouvement de la tête à le rattraper.
La Gorda a commencé à crier à pleins poumons. « Nagual ! Genaro ! Attendez ! »
Elle a couru devant moi. Ils marchaient très vite vers des cabanes à moitié visibles dans la pénombre. Ils ont dû entrer dans l’une d’elles ou tourner dans l’un des nombreux sentiers ; soudain, ils ont disparu de notre vue.
La Gorda est restée là et a hurlé leurs noms sans aucune timidité. Des gens sont sortis pour voir qui criait. Je l’ai tenue jusqu’à ce qu’elle se calme.
« Ils étaient juste devant moi », dit-elle en pleurant. « Même pas à dix pieds. Quand j’ai crié et attiré ton attention sur eux, ils étaient à une rue de distance en un instant. »
J’ai essayé de l’apaiser. Elle était dans un état de grande nervosité. Elle s’est accrochée à moi en tremblant. Pour une raison indiscernable, j’étais absolument sûr que les deux hommes n’étaient pas don Juan et don Genaro ; par conséquent, je ne pouvais pas partager l’agitation de la Gorda. Elle a dit que nous devions rentrer chez nous, que le pouvoir ne lui permettrait pas d’aller à Los Angeles ou même à Mexico avec moi. Ce n’était pas encore le moment pour son voyage. Elle était convaincue que les avoir vus avait été un présage. Ils avaient disparu en pointant vers l’est, vers sa ville natale.
Je n’avais aucune objection à repartir à ce moment même. Après tout ce qui nous était arrivé ce jour-là, j’aurais dû être mort de fatigue. Au lieu de cela, je vibrais d’une vigueur des plus extravagantes, réminiscente des moments avec don Juan où j’avais eu envie de défoncer les murs avec mes épaules.
Sur le chemin du retour vers ma voiture, j’ai de nouveau été rempli de l’affection la plus passionnée pour la Gorda. Je ne pourrais jamais la remercier assez pour son aide. Je pensais que tout ce qu’elle avait fait pour m’aider à voir les œufs lumineux avait fonctionné. Elle avait été si courageuse, risquant le ridicule et même des blessures corporelles en s’asseyant sur ce banc. Je lui ai exprimé mes remerciements. Elle m’a regardé comme si j’étais fou, puis a éclaté d’un rire gras.
« Je pensais la même chose de toi », dit-elle. « Je pensais que tu l’avais fait juste pour moi. Moi aussi, j’ai vu des œufs lumineux. C’était la première fois pour moi aussi. Nous avons vu ensemble ! Comme le Nagual et Genaro avaient l’habitude de le faire. »
Alors que j’ouvrais la portière de la voiture pour la Gorda, l’impact total de ce que nous avions fait m’a frappé. Jusqu’à ce moment, j’avais été engourdi, quelque chose en moi avait ralenti. Maintenant, mon euphorie était aussi intense que l’agitation de la Gorda l’avait été peu de temps auparavant. Je voulais courir dans la rue et crier. C’était au tour de la Gorda de me contenir. Elle s’est accroupie et m’a frotté les mollets. Assez étrangement, je me suis calmé immédiatement. J’ai trouvé qu’il m’était difficile de parler. Mes pensées couraient plus vite que ma capacité à les verbaliser. Je ne voulais pas rentrer tout de suite dans sa ville natale. Il semblait y avoir encore tant de choses à faire. Comme je ne pouvais pas expliquer clairement ce que je voulais, j’ai pratiquement traîné une Gorda réticente jusqu’à la place, mais il n’y avait pas de bancs vides à cette heure-là. J’étais affamé, alors je l’ai entraînée dans un restaurant. Elle pensait qu’elle ne pourrait pas manger, mais quand on a apporté la nourriture, elle s’est avérée être aussi affamée que moi. Manger nous a complètement détendus.
Nous nous sommes assis sur le banc plus tard dans la nuit. Je m’étais abstenu de parler de ce qui nous était arrivé jusqu’à ce que nous ayons eu la chance de nous asseoir là. La Gorda était d’abord réticente à dire quoi que ce soit. Mon esprit était dans un état d’exaltation particulier. J’avais eu des moments similaires avec don Juan, mais associés, en règle générale, aux séquelles des plantes hallucinogènes.
J’ai commencé par décrire à la Gorda ce que j’avais vu. La caractéristique de ces œufs lumineux qui m’avait le plus impressionné était leurs mouvements. Ils ne marchaient pas. Ils se déplaçaient d’une manière flottante, mais ils étaient ancrés au sol. La façon dont ils se déplaçaient n’était pas agréable. Leurs mouvements étaient guindés, raides et saccadés. Quand ils étaient en mouvement, la forme entière de l’œuf devenait plus petite et plus ronde ; ils semblaient sauter ou tressauter, ou trembler de haut en bas avec une grande vitesse. Le résultat était un frisson nerveux des plus agaçants. Peut-être que le plus proche que je puisse arriver à décrire l’inconfort physique causé par leur mouvement serait de dire que je me sentais comme si les images sur un écran de cinéma avaient été accélérées.
Une autre chose qui m’avait intrigué était que je ne pouvais détecter aucune jambe. J’avais vu une fois une production de ballet dans laquelle les danseurs imitaient le mouvement de soldats sur des patins à glace ; pour cet effet, ils portaient des tuniques amples qui pendaient jusqu’au sol. Il n’y avait aucun moyen de voir leurs pieds : d’où l’illusion qu’ils glissaient sur la glace. Les œufs lumineux qui défilaient devant moi donnaient l’impression qu’ils glissaient sur une surface rugueuse. Leur luminosité tremblait de haut en bas de manière presque imperceptible, mais suffisamment pour me rendre presque malade. Quand les œufs étaient au repos, ils devenaient allongés. Certains d’entre eux étaient si longs et rigides qu’ils me faisaient penser à une icône en bois.
Une autre caractéristique encore plus troublante des œufs lumineux était l’absence d’yeux. Je n’avais jamais réalisé aussi intensément à quel point nous sommes attirés par les yeux des êtres vivants. Les œufs lumineux étaient tout à fait vivants ; ils m’observaient avec une grande curiosité. Je pouvais les voir tressauter de haut en bas, se pencher pour me regarder, mais sans aucun œil.
Beaucoup de ces œufs lumineux avaient des taches noires, d’énormes taches en dessous de la section médiane. D’autres non. La Gorda m’avait dit que la reproduction affecte les corps des hommes et des femmes en provoquant l’apparition d’un trou sous l’estomac, mais les taches sur ces œufs lumineux ne me semblaient pas être des trous. C’étaient des zones sans luminosité, mais elles n’avaient aucune profondeur. Ceux qui avaient les taches noires semblaient être doux, fatigués ; la crête de leur forme d’œuf était flétrie, elle paraissait opaque par rapport au reste de leur lueur. Ceux sans taches, en revanche, étaient d’une luminosité éblouissante. Je les imaginais dangereux. Ils étaient vibrants, remplis d’énergie et de blancheur.
La Gorda a dit qu’à l’instant où j’ai posé ma tête sur elle, elle est également entrée dans un état qui ressemblait au rêve. Elle était éveillée, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle était consciente que des gens grouillaient autour de nous. Puis elle les a vus se transformer en masses lumineuses et finalement en créatures en forme d’œuf. Elle ne savait pas que je voyais aussi. Elle avait d’abord pensé que je veillais sur elle, mais à un moment donné, la pression de ma tête était si lourde qu’elle a conclu très consciemment que je devais aussi être en train de voir. Ce n’est qu’après que je me suis redressé et que j’ai surpris le jeune homme en train de la caresser alors qu’elle semblait dormir qu’elle a eu une idée de ce qui pouvait lui arriver.
Nos visions différaient en ce qu’elle pouvait distinguer les hommes des femmes par la forme de certains filaments qu’elle appelait des « racines ». Les femmes, dit-elle, avaient d’épais faisceaux de filaments qui ressemblaient à la queue d’un lion ; ils poussaient vers l’intérieur depuis l’endroit des organes génitaux. Elle a expliqué que ces racines étaient les donneuses de vie. L’embryon, pour accomplir sa croissance, s’attache à l’une de ces racines nourricières et la consomme entièrement, ne laissant qu’un trou. Les hommes, en revanche, avaient de courts filaments qui étaient vivants et flottaient presque séparément de la masse lumineuse de leur corps.
Je lui ai demandé quelle était, à son avis, la raison pour laquelle nous avions vu ensemble. Elle a refusé de faire tout commentaire, mais elle m’a incité à poursuivre mes spéculations. Je lui ai dit que la seule chose qui m’était venue à l’esprit était l’évidence : les émotions devaient avoir été un facteur.
Après que la Gorda et moi nous soyons assis sur le banc préféré de don Juan en fin d’après-midi ce jour-là, et que j’aie récité le poème qu’il aimait, j’étais très chargé d’émotion. Mes émotions ont dû préparer mon corps. Mais je devais aussi considérer le fait qu’en pratiquant le rêve, j’avais appris à entrer dans un état de quiétude totale. J’étais capable d’éteindre mon dialogue interne et de rester comme si j’étais à l’intérieur d’un cocon, jetant un coup d’œil par un trou. Dans cet état, je pouvais soit lâcher un certain contrôle que j’avais et entrer dans le rêve, soit m’accrocher à ce contrôle et rester passif, sans pensée et sans désirs. Je ne pensais pas, cependant, que c’étaient là les facteurs significatifs. Je croyais que le catalyseur était la Gorda. Je pensais que c’était ce que je ressentais pour elle qui avait créé les conditions pour voir.
La Gorda a ri timidement quand je lui ai dit ce que je croyais.
« Je ne suis pas d’accord avec toi », dit-elle. « Je pense que ce qui s’est passé, c’est que ton corps a commencé à se souvenir. »
« Que veux-tu dire par là, Gorda ? » demandai-je.
Il y eut une longue pause. Elle semblait soit se battre pour dire quelque chose qu’elle ne voulait pas dire, soit elle essayait désespérément de trouver le mot approprié.
« Il y a tellement de choses que je sais », dit-elle, « et pourtant je ne sais pas ce que je sais. Je me souviens de tellement de choses que je finis par ne me souvenir de rien. Je pense que tu es dans la même situation toi-même. »
Je l’ai assurée que je n’en avais pas conscience. Elle a refusé de me croire.
« Parfois, je crois vraiment que tu ne sais pas », dit-elle. « D’autres fois, je crois que tu joues avec nous. Le Nagual m’a dit que lui-même ne savait pas. Beaucoup de choses qu’il m’a dites sur toi me reviennent maintenant. »
« Qu’est-ce que cela signifie que mon corps a commencé à se souvenir ? » insistai-je.
« Ne me demande pas ça », dit-elle avec un sourire. « Je ne sais pas ce que tu es censé te souvenir, ni à quoi ressemble ce souvenir. Je ne l’ai jamais fait moi-même. Ça, je le sais. »
« Y a-t-il quelqu’un parmi les apprentis qui pourrait me le dire ? » demandai-je.
« Personne », dit-elle. « Je pense que je suis un messager pour toi, un messager qui ne peut t’apporter que la moitié d’un message cette fois. »
Elle se leva et me supplia de la ramener dans sa ville natale. J’étais trop exalté pour partir alors. Nous avons fait le tour de la place à ma suggestion. Finalement, nous nous sommes assis sur un autre banc.
« N’est-ce pas étrange pour toi que nous ayons pu voir ensemble avec une telle facilité ? » demanda la Gorda.
Je ne savais pas ce qu’elle avait en tête. J’hésitais à répondre.
« Que dirais-tu si je te disais que je pense que nous avons déjà vu ensemble ? » demanda la Gorda, articulant soigneusement ses mots.
Je ne pouvais pas comprendre ce qu’elle voulait dire. Elle répéta la question une fois de plus et je ne pouvais toujours pas saisir son sens.
« Quand aurions-nous pu voir ensemble avant ? » demandai-je. « Ta question n’a pas de sens. »
« C’est là le point », répondit-elle. « Ça n’a pas de sens, et pourtant j’ai le sentiment que nous avons déjà vu ensemble. »
J’ai eu un frisson et je me suis levé. Je me suis souvenu à nouveau de la sensation que j’avais eue dans cette ville. La Gorda a ouvert la bouche pour dire quelque chose mais s’est arrêtée au milieu de sa phrase. Elle m’a regardé, perplexe, a mis sa main sur mes lèvres, puis m’a pratiquement traîné jusqu’à la voiture.
J’ai conduit toute la nuit. Je voulais parler, analyser, mais elle s’est endormie comme pour éviter délibérément toute discussion. Elle avait raison, bien sûr. De nous deux, c’était elle qui était consciente du danger de dissiper une humeur en l’analysant à l’excès.
Alors qu’elle sortait de la voiture, quand nous sommes arrivés chez elle, elle a dit que nous ne pouvions pas du tout parler de ce qui nous était arrivé à Oaxaca.
« Pourquoi donc, Gorda ? » demandai-je.
« Je ne veux pas gaspiller notre pouvoir », dit-elle. « C’est la voie du sorcier. Ne gaspille jamais tes gains. »
« Mais si nous n’en parlons pas, nous ne saurons jamais ce qui nous est vraiment arrivé », protestai-je.
« Nous devons nous taire pendant au moins neuf jours », dit-elle.
« Pouvons-nous en parler, juste entre nous deux ? » demandai-je.
« Une conversation entre nous deux est précisément ce que nous devons éviter », dit-elle. « Nous sommes vulnérables. Nous devons nous laisser le temps de guérir. »
(Carlos Castaneda, Le Don de l’Aigle)