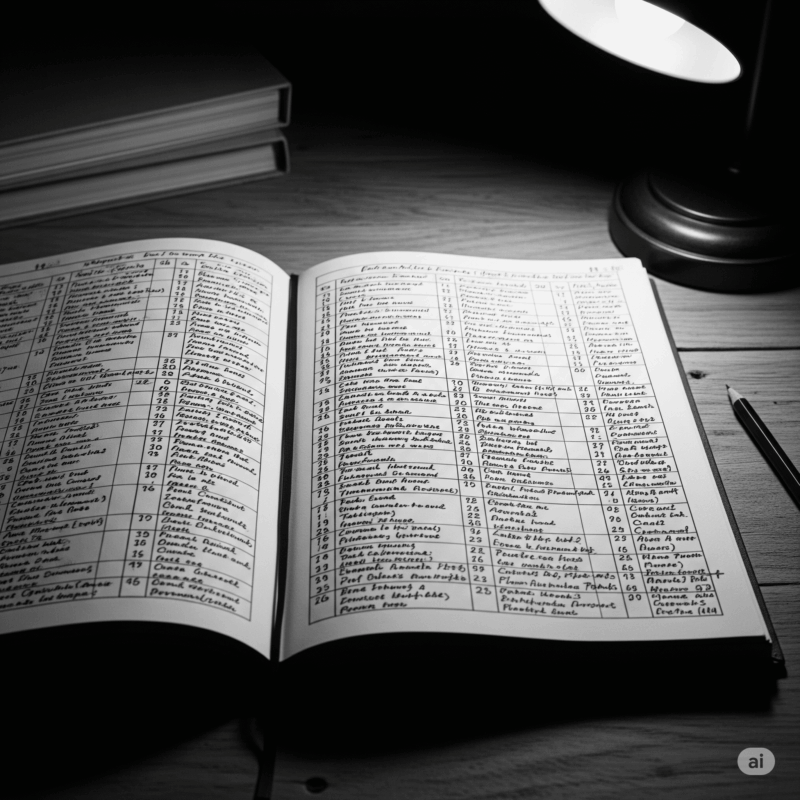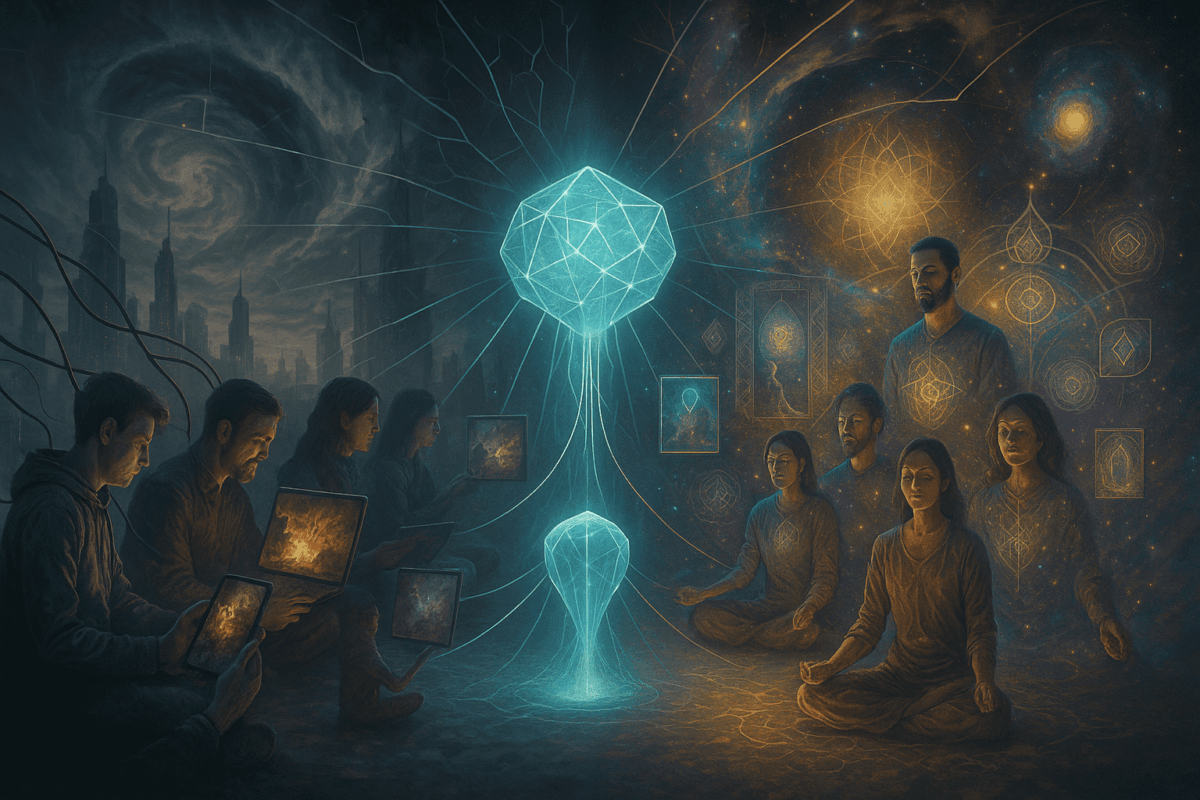« Peux-tu nous dire ce qui se passe ? » me demanda Nestor lorsque nous fûmes tous réunis ce soir-là. « Où êtes-vous allés hier, vous deux ? »
J’avais oublié la recommandation de la Gorda de ne pas parler de ce qui nous était arrivé. Je commençai à leur raconter que nous étions d’abord allés dans la ville voisine et que nous y avions trouvé une maison des plus intrigantes.
Tous semblèrent avoir été touchés par un tremblement soudain. Ils se redressèrent, se regardèrent les uns les autres, puis fixèrent la Gorda comme s’ils attendaient qu’elle leur en parle.
« Quel genre de maison était-ce ? » demanda Nestor.
Avant que j’aie eu le temps de répondre, la Gorda m’interrompit. Elle se mit à parler d’une manière précipitée, presque incohérente. Il était évident pour moi qu’elle improvisait. Elle utilisa même des mots et des phrases en langue mazatèque. Elle me lança des regards furtifs qui signifiaient une prière silencieuse de ne rien dire à ce sujet.
« Et ton rêve, Nagual ? » me demanda-t-elle avec le soulagement de quelqu’un qui a trouvé une issue. « Nous aimerions savoir tout ce que tu fais. Je pense qu’il est très important que tu nous le dises. »
Elle se pencha et, aussi nonchalamment que possible, elle me chuchota à l’oreille qu’en raison de ce qui nous était arrivé à Oaxaca, je devais leur parler de mon rêve.
« Pourquoi serait-ce important pour vous ? » dis-je à voix haute.
« Je pense que nous sommes très proches de la fin », dit la Gorda solennellement. « Tout ce que tu nous dis ou nous fais est d’une importance capitale maintenant. »
Je leur ai relaté les événements de ce que je considérais comme mon véritable rêve. Don Juan m’avait dit qu’il ne servait à rien de mettre l’accent sur les épreuves. Il m’a donné une règle empirique ; si je devais avoir la même vision trois fois, dit-il, je devais y prêter une attention extraordinaire ; sinon, les tentatives d’un néophyte n’étaient qu’un tremplin pour construire la seconde attention.
J’ai rêvé une fois que je me réveillais et que je sautais du lit pour me retrouver face à moi-même, encore endormi dans le lit. Je me suis regardé dormir et j’ai eu la maîtrise de moi pour me souvenir que je rêvais. J’ai alors suivi les instructions que don Juan m’avait données, qui étaient d’éviter les secousses soudaines ou les surprises, et de tout prendre avec un grain de sel. Le rêveur doit s’engager, disait don Juan, dans des expérimentations impartiales. Plutôt que d’examiner son corps endormi, le rêveur sort de la pièce. Je me suis soudain retrouvé, sans savoir comment, à l’extérieur de ma chambre. J’ai eu la sensation absolument claire d’y avoir été placé instantanément. Quand je me suis tenu pour la première fois devant ma porte, le couloir et l’escalier étaient monumentaux. Si quelque chose m’a vraiment fait peur cette nuit-là, c’est la taille de ces structures, qui dans la vie réelle étaient tout à fait banales ; le couloir mesurait environ cinquante pieds de long et l’escalier avait seize marches.
Je ne pouvais concevoir comment parcourir les distances énormes que je percevais. J’ai hésité, puis quelque chose m’a fait bouger. Je n’ai pas marché, cependant. Je n’ai pas senti mes pas. Soudain, je me tenais à la rampe. Je pouvais voir mes mains et mes avant-bras mais je ne les sentais pas. Je me tenais par la force de quelque chose qui n’avait rien à voir avec ma musculature telle que je la connais. La même chose s’est produite lorsque j’ai essayé de descendre les escaliers. Je ne savais pas comment marcher. Je ne pouvais tout simplement pas faire un pas. C’était comme si mes jambes étaient soudées. Je pouvais voir mes jambes en me penchant, mais je ne pouvais pas les avancer ou les déplacer latéralement, ni les lever vers ma poitrine. Je semblais être coincé sur la première marche. J’avais l’impression d’être comme ces poupées en plastique gonflables qui peuvent se pencher dans n’importe quelle direction jusqu’à l’horizontale, pour ensuite être redressées par le poids de leurs lourdes bases arrondies.
J’ai fait un effort suprême pour marcher et j’ai rebondi de marche en marche comme une balle maladroite. Il a fallu un degré d’attention incroyable pour arriver au rez-de-chaussée. Je ne pourrais pas le décrire autrement. Une certaine forme d’attention était requise pour maintenir les limites de ma vision, pour l’empêcher de se désintégrer en images fugaces d’un rêve ordinaire.
Quand je suis finalement arrivé à la porte de la rue, je n’ai pas pu l’ouvrir. J’ai essayé désespérément, mais en vain ; puis je me suis souvenu que j’étais sorti de ma chambre en glissant hors d’elle comme si la porte avait été ouverte. Il suffisait que je me souvienne de cette sensation de glissement et soudain j’étais dans la rue. Il faisait sombre – une obscurité d’un gris de plomb particulier qui ne me permettait de percevoir aucune couleur. Mon intérêt fut immédiatement attiré par une énorme lagune de luminosité juste devant moi, à hauteur de mes yeux. J’ai déduit plutôt que perçu que c’était le lampadaire, puisque je savais qu’il y en avait un juste au coin, à vingt pieds au-dessus du sol. J’ai su alors que je ne pouvais pas faire les arrangements perceptifs nécessaires pour juger du haut, du bas, d’ici ou de là. Tout semblait être extraordinairement présent. Je n’avais aucun mécanisme, comme dans la vie ordinaire, pour organiser ma perception. Tout était au premier plan et je n’avais aucune volonté pour construire une procédure de filtrage adéquate.
Je suis resté dans la rue, déconcerté, jusqu’à ce que je commence à avoir la sensation que je lévitais. Je me suis accroché au poteau métallique qui soutenait la lumière et le panneau de la rue au coin. Une forte brise me soulevait. Je glissais le long du poteau jusqu’à ce que je puisse clairement voir le nom de la rue : Ashton.
Quelques mois plus tard, lorsque je me suis retrouvé de nouveau dans un rêve à regarder mon corps endormi, j’avais déjà un répertoire de choses à faire. Au cours de mon rêve ordinaire, j’avais appris que ce qui compte dans cet état, c’est la volition, la corporalité du corps n’a aucune importance. C’est simplement un souvenir qui ralentit le rêveur. J’ai glissé hors de la pièce sans hésitation, puisque je n’avais pas à simuler les mouvements d’ouverture d’une porte ou de marche pour me déplacer. Le couloir et l’escalier n’étaient pas aussi énormes qu’ils semblaient l’être la première fois. J’ai glissé à travers avec une grande facilité et je me suis retrouvé dans la rue où j’ai voulu me déplacer de trois pâtés de maisons. J’ai alors pris conscience que les lumières étaient toujours des spectacles très perturbants. Si je concentrais mon attention sur elles, elles devenaient des bassins d’une taille incommensurable. Les autres éléments de ce rêve étaient faciles à contrôler. Les bâtiments étaient extraordinairement grands, mais leurs caractéristiques étaient familières. J’ai réfléchi à ce qu’il fallait faire. Et puis, tout à fait nonchalamment, j’ai réalisé que si je ne fixais pas les choses mais que je les regardais simplement, comme nous le faisons dans notre monde quotidien, je pouvais arranger ma perception. En d’autres termes, si je suivais les suggestions de don Juan à la lettre et que je prenais mon rêve pour acquis, je pouvais utiliser les biais perceptifs de ma vie de tous les jours. Après quelques instants, le décor est devenu, sinon complètement familier, du moins contrôlable.
La fois suivante où j’ai eu un rêve similaire, je suis allé à mon café préféré au coin de la rue. La raison pour laquelle je l’ai choisi était que j’avais l’habitude d’y aller tout le temps aux petites heures du matin. Dans mon rêve, j’ai vu les serveuses habituelles qui travaillaient de nuit ; j’ai vu une rangée de personnes mangeant au comptoir, et tout au bout du comptoir, j’ai vu un personnage particulier, un homme que je voyais presque tous les jours se promener sans but sur le campus de l’UCLA. C’était la seule personne qui m’a réellement regardé. Dès que je suis entré, il a semblé me sentir. Il s’est retourné et m’a fixé.
J’ai retrouvé le même homme dans mes heures de veille quelques jours plus tard dans le même café aux petites heures du matin. Il m’a jeté un regard et a semblé me reconnaître. Il a eu l’air horrifié et s’est enfui sans me donner la chance de lui parler.
Je suis revenu une fois de plus au même café et c’est là que le cours de mon rêve a changé. Alors que je regardais le restaurant de l’autre côté de la rue, la scène a changé. Je ne pouvais plus voir les bâtiments familiers. À la place, j’ai vu un paysage primitif. Ce n’était plus la nuit. C’était le plein jour et je regardais une vallée luxuriante. Des plantes marécageuses, d’un vert profond, semblables à des roseaux, poussaient partout. À côté de moi, il y avait un rebord rocheux de huit à dix pieds de haut. Un énorme tigre à dents de sabre était assis là. J’étais pétrifié. Nous nous sommes regardés fixement pendant un long moment. La taille de cette bête était frappante, mais elle n’était pas grotesque ou disproportionnée. Elle avait une tête splendide, de grands yeux de la couleur du miel foncé, des pattes massives, une cage thoracique énorme. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la couleur de sa fourrure. Elle était uniformément d’un brun foncé, presque chocolat. Sa couleur me rappelait des grains de café torréfiés, mais lustrés ; elle avait une fourrure étrangement longue, ni emmêlée ni miteuse. Elle ne ressemblait ni à la fourrure d’un puma, ni à celle d’un loup ou d’un ours polaire. Elle ressemblait à quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant.
À partir de ce moment-là, il est devenu routinier pour moi de voir le tigre. Parfois, le paysage était nuageux et frais. Je pouvais voir la pluie dans la vallée, une pluie épaisse et abondante. D’autres fois, la vallée était baignée de soleil. Très souvent, je voyais d’autres tigres à dents de sabre dans la vallée. Je pouvais entendre leur rugissement grinçant unique – un son des plus nauséabonds pour moi.
Le tigre ne m’a jamais touché. Nous nous regardions fixement à une distance de dix à douze pieds. Pourtant, je pouvais dire ce qu’il voulait. Il me montrait comment respirer d’une manière spécifique. J’en suis arrivé au point dans mon rêve où je pouvais imiter si bien la respiration du tigre que j’avais l’impression de me transformer en l’un d’eux. J’ai dit aux apprentis qu’un résultat tangible de mon rêve était que mon corps devenait plus musclé.
Après avoir écouté mon récit, Nestor s’est émerveillé de la différence entre leur rêve et le mien. Ils avaient des tâches de rêve particulières. La sienne était de trouver des remèdes pour tout ce qui affligeait le corps humain. La tâche de Benigno était de prédire, de prévoir, de trouver une solution à tout ce qui concernait l’homme. La tâche de Pablito était de trouver des moyens de construire. Nestor a dit que ces tâches étaient la raison pour laquelle il s’occupait de plantes médicinales, Benigno avait un oracle et Pablito était charpentier. Il a ajouté que, jusqu’à présent, ils n’avaient fait qu’effleurer la surface de leur rêve et qu’ils n’avaient rien de substantiel à rapporter.
« Vous pouvez penser que nous avons fait beaucoup », a-t-il poursuivi, « mais ce n’est pas le cas. Genaro et le Nagual ont tout fait pour nous et pour ces quatre femmes. Nous n’avons encore rien fait par nous-mêmes. »
« Il me semble que le Nagual t’a préparé différemment », a dit Benigno, parlant très lentement et délibérément. « Tu as dû être un tigre et tu vas certainement en redevenir un. C’est ce qui est arrivé au Nagual, il avait déjà été un corbeau et pendant cette vie, il en est redevenu un. »
« Le problème est que ce genre de tigre n’existe plus », a dit Nestor. « Nous n’avons jamais entendu ce qui se passe dans ce cas. »
Il a balayé la tête pour les inclure tous dans son geste.
« Je sais ce qui se passe », a dit la Gorda. « Je me souviens que le Nagual Juan Matus appelait cela le rêve fantôme. Il a dit qu’aucun de nous n’a jamais fait de rêve fantôme parce que nous ne sommes pas violents ou destructeurs. Il ne l’a jamais fait lui-même. Et il a dit que celui qui le fait est marqué par le destin pour avoir des aides et des alliés fantômes. »
« Qu’est-ce que cela signifie, Gorda ? » ai-je demandé.
« Cela signifie que tu n’es pas comme nous », répondit-elle sombrement.
La Gorda semblait très agitée. Elle se leva et fit les cent pas dans la pièce quatre ou cinq fois avant de se rasseoir à côté de moi.
Il y eut un silence dans la conversation. Josefina marmonna quelque chose d’inintelligible. Elle semblait aussi très nerveuse. La Gorda essaya de la calmer, la serrant dans ses bras et lui tapotant le dos.
« Josefina a quelque chose à te dire sur Eligio », me dit la Gorda.
Tout le monde regarda Josefina sans dire un mot, une question dans les yeux.
« Malgré le fait qu’Eligio ait disparu de la surface de la terre », poursuivit la Gorda, « il est toujours l’un des nôtres. Et Josefina lui parle tout le temps. »
Les autres devinrent soudain attentifs. Ils se regardèrent les uns les autres, puis ils me regardèrent.
« Ils se rencontrent en rêve », dit la Gorda d’un ton dramatique.
Josefina prit une profonde inspiration, elle semblait être l’incarnation de la nervosité. Son corps tremblait convulsivement. Pablito s’allongea sur elle par terre et commença à respirer fort avec son diaphragme, le poussant à l’intérieur et à l’extérieur, la forçant à respirer à l’unisson avec lui.
« Qu’est-ce qu’il fait ? » demandai-je à la Gorda.
« Qu’est-ce qu’il fait ! Tu ne vois pas ? » répondit-elle sèchement.
Je lui ai chuchoté que j’étais conscient qu’il essayait de la détendre, mais que sa procédure était nouvelle pour moi. Elle a dit que Pablito donnait de l’énergie à Josefina en plaçant son abdomen, où les hommes en ont un surplus, sur l’utérus de Josefina, où les femmes stockent leur énergie.
Josefina s’assit et me sourit. Elle semblait parfaitement détendue.
« Je rencontre Eligio tout le temps », dit-elle. « Il m’attend tous les jours. »
« Comment se fait-il que tu ne nous aies jamais dit ça ? » demanda Pablito d’un ton sec.
« Elle me l’a dit », interrompit la Gorda, puis elle se lança dans une longue explication de ce que signifiait pour nous tous qu’Eligio soit disponible. Elle ajouta qu’elle avait attendu un signe de ma part pour divulguer les paroles d’Eligio.
« Ne tourne pas autour du pot, femme ! » cria Pablito. « Dis-nous ses paroles. »
« Elles ne sont pas pour toi ! » cria la Gorda en retour.
« Pour qui sont-elles, alors ? » demanda Pablito.
« Elles sont pour le Nagual », cria la Gorda en me montrant du doigt.
La Gorda s’est excusée d’avoir élevé la voix. Elle a dit que tout ce qu’Eligio avait dit était complexe et mystérieux et qu’elle n’y comprenait rien.
« Je l’ai juste écouté. C’est tout ce que j’ai pu faire, l’écouter », a-t-elle poursuivi.
« Tu veux dire que tu rencontres aussi Eligio ? » demanda Pablito d’un ton qui était un mélange de colère et d’attente.
« Oui », répondit la Gorda dans un murmure à peine audible. « Je ne pouvais pas en parler parce que je devais l’attendre. »
Elle m’a montré du doigt, puis m’a poussé des deux mains. J’ai momentanément perdu l’équilibre et je suis tombé sur le côté.
« Qu’est-ce que c’est ? Que lui fais-tu ? » demanda Pablito d’une voix très en colère. « Était-ce une démonstration d’amour indien ? »
Je me suis tourné vers la Gorda. Elle a fait un geste avec ses lèvres pour me dire de me taire.
« Eligio dit que tu es le Nagual, mais que tu n’es pas pour nous », me dit Josefina.
Il y eut un silence de mort dans la pièce. Je ne savais pas quoi penser de la déclaration de Josefina. Je devais attendre que quelqu’un d’autre parle.
« Te sens-tu soulagé ? » me poussa la Gorda.
Je leur ai dit à tous que je n’avais aucune opinion dans un sens ou dans l’autre. Ils ressemblaient à des enfants, des enfants déconcertés. La Gorda avait l’air d’une maîtresse de cérémonie complètement embarrassée.
Nestor se leva et fit face à la Gorda. Il lui adressa une phrase en mazatèque. Cela avait le son d’un ordre ou d’un reproche.
« Dis-nous tout ce que tu sais, Gorda », a-t-il poursuivi en espagnol. « Tu n’as pas le droit de jouer avec nous, de retenir quelque chose d’aussi important, juste pour toi. »
La Gorda a protesté avec véhémence. Elle a expliqué qu’elle gardait ce qu’elle savait parce qu’Eligio le lui avait demandé. Josefina a acquiescé d’un signe de tête.
« A-t-il dit tout cela à toi ou à Josefina ? » demanda Pablito.
« Nous étions ensemble », dit la Gorda dans un murmure à peine audible.
« Tu veux dire que toi et Josefina rêvez ensemble ! » s’exclama Pablito, à bout de souffle.
La surprise dans sa voix correspondait à l’onde de choc qui sembla traverser les autres.
« Qu’est-ce qu’Eligio vous a dit exactement à vous deux ? » demanda Nestor lorsque le choc se fut dissipé.
« Il a dit que je devrais essayer d’aider le Nagual à se souvenir de son côté gauche », dit la Gorda.
« Sais-tu de quoi elle parle ? » me demanda Nestor.
Il n’y avait aucune possibilité que je le sache. Je leur ai dit qu’ils devraient se tourner vers eux-mêmes pour trouver des réponses. Mais aucun d’eux n’a exprimé de suggestions.
« Il a dit à Josefina d’autres choses dont elle ne se souvient pas », a dit la Gorda. « Donc, nous sommes dans une sacrée situation. Eligio a dit que tu es définitivement le Nagual et que tu dois nous aider, mais que tu n’es pas pour nous. Ce n’est qu’en te souvenant de ton côté gauche que tu pourras nous emmener là où nous devons aller. »
Nestor a parlé à Josefina d’une manière paternelle et l’a exhortée à se souvenir de ce qu’Eligio avait dit, plutôt que d’insister pour que je me souvienne de quelque chose qui devait être une sorte de code, puisque aucun de nous ne pouvait y trouver un sens.
Josefina grimaça et fronça les sourcils comme si elle était sous un poids lourd qui la poussait vers le bas. Elle ressemblait en fait à une poupée de chiffon en train d’être comprimée. J’ai regardé avec une véritable fascination.
« Je ne peux pas », dit-elle finalement. « Je sais de quoi il parle quand il me parle, mais je ne peux pas dire maintenant ce que c’est. Ça ne sort pas. »
« Te souviens-tu de quelques mots ? » demanda Nestor. « De quelques mots isolés ? »
Elle tira la langue, secoua la tête d’un côté à l’autre et cria en même temps.
« Non. Je ne peux pas », dit-elle après un moment.
« Quel genre de rêve fais-tu, Josefina ? » lui demandai-je.
« Le seul que je connaisse », répondit-elle sèchement.
« Je t’ai dit comment je fais le mien », dis-je. « Maintenant, dis-moi comment tu fais le tien. »
« Je ferme les yeux et je vois ce mur », dit-elle. « C’est comme un mur de brouillard. Eligio m’attend là. Il me fait passer à travers et me montre des choses, je suppose. Je ne sais pas ce que nous faisons, mais nous faisons des choses ensemble. Puis il me ramène au mur et me laisse partir. Et je reviens et j’oublie ce que j’ai vu. »
« Comment es-tu arrivée à y aller avec la Gorda ? » demandai-je.
« Eligio m’a dit de l’aller chercher », dit-elle. « Nous avons attendu la Gorda tous les deux, et quand elle est entrée dans son rêve, nous l’avons attrapée et tirée derrière ce mur. Nous l’avons fait deux fois. »
« Comment l’as-tu attrapée ? » demandai-je.
« Je ne sais pas ! » répondit Josefina. « Mais je t’attendrai et quand tu feras ton rêve, je t’attraperai et alors tu sauras. »
« Peux-tu attraper n’importe qui ? » demandai-je.
« Bien sûr », dit-elle en souriant. « Mais je ne le fais pas parce que c’est un gaspillage. J’ai attrapé la Gorda parce qu’Eligio m’a dit qu’il voulait lui dire quelque chose parce qu’elle est plus sensée que moi. »
« Alors Eligio a dû te dire les mêmes choses, Gorda », dit Nestor avec une fermeté qui ne m’était pas familière.
La Gorda fit un geste inhabituel en baissant la tête, en ouvrant la bouche sur les côtés, en haussant les épaules et en levant les bras au-dessus de sa tête.
« Josefina vient de te dire ce qui s’est passé », dit-elle. « Il n’y a aucun moyen pour moi de me souvenir. Eligio parle à une vitesse différente. Il parle mais mon corps ne peut pas le comprendre. Non. Non. Mon corps ne peut pas se souvenir, c’est ça. Je sais qu’il a dit que le Nagual ici se souviendra et nous emmènera là où nous devons aller. Il ne pouvait pas m’en dire plus parce qu’il y avait tant à dire et si peu de temps. Il a dit que quelqu’un, et je ne me souviens pas qui, m’attend en particulier. »
« C’est tout ce qu’il a dit ? » insista Nestor.
« La deuxième fois que je l’ai vu, il m’a dit que nous devrons tous nous souvenir de notre côté gauche, tôt ou tard, si nous voulons arriver là où nous devons aller. Mais c’est lui qui doit se souvenir en premier. »
Elle me montra du doigt et me poussa de nouveau comme elle l’avait fait plus tôt. La force de sa poussée me fit culbuter comme une balle.
« Pourquoi fais-tu ça, Gorda ? » lui demandai-je, un peu agacé par elle.
« J’essaie de t’aider à te souvenir », dit-elle. « Le Nagual Juan Matus m’a dit que je devais te donner une poussée de temps en temps pour te secouer. »
La Gorda me serra dans ses bras dans un mouvement très brusque.
« Aide-nous, Nagual », plaida-t-elle. « Nous sommes pires que morts si tu ne le fais pas. »
J’étais au bord des larmes. Non pas à cause de leur dilemme, mais parce que je sentais quelque chose s’agiter en moi. C’était quelque chose qui cherchait à sortir depuis que nous avions visité cette ville.
La plaidoirie de la Gorda était déchirante. J’ai alors eu une autre crise de ce qui semblait être de l’hyperventilation. Une sueur froide m’a enveloppé, puis j’ai eu mal au ventre. La Gorda s’est occupée de moi avec une gentillesse absolue.
Fidèle à sa pratique d’attendre avant de révéler une découverte, la Gorda n’a pas voulu discuter de notre vision commune à Oaxaca. Pendant des jours, elle est restée distante et résolument désintéressée. Elle ne voulait même pas discuter de ma maladie. Les autres femmes non plus. Don Juan avait l’habitude d’insister sur la nécessité d’attendre le moment le plus approprié pour lâcher quelque chose que nous tenons. Je comprenais la mécanique des actions de la Gorda, bien que je trouve son insistance à attendre plutôt agaçante et non conforme à nos besoins. Je ne pouvais pas rester trop longtemps avec eux, alors j’ai exigé que nous nous réunissions tous et partagions tout ce que nous savions. Elle était inflexible.
« Nous devons attendre », dit-elle. « Nous devons donner à nos corps une chance de trouver une solution. Notre tâche est la tâche de se souvenir, non pas avec nos esprits mais avec nos corps. Tout le monde le comprend ainsi. »
Elle me regarda d’un air interrogateur. Elle semblait chercher un indice qui lui dirait que moi aussi j’avais compris la tâche. J’ai admis être complètement mystifié, puisque j’étais l’étranger. J’étais seul, alors qu’ils s’avaient les uns les autres pour se soutenir.
« C’est le silence des guerriers », dit-elle en riant, puis elle ajouta d’un ton conciliant : « Ce silence ne signifie pas que nous ne pouvons pas parler d’autre chose. »
« Peut-être devrions-nous revenir à notre ancienne discussion sur la perte de la forme humaine », dis-je.
Il y eut un air d’agacement dans ses yeux. J’ai expliqué longuement que, surtout lorsque des concepts étrangers étaient impliqués, le sens devait être continuellement clarifié pour moi.
« Que veux-tu savoir exactement ? » demanda-t-elle.
« Tout ce que tu voudras bien me dire », dis-je.
« Le Nagual m’a dit que perdre la forme humaine apporte la liberté », dit-elle. « Je le crois. Mais je n’ai pas ressenti cette liberté, pas encore. »
Il y eut un moment de silence. Elle évaluait manifestement ma réaction.
« De quel genre de liberté s’agit-il, Gorda ? » lui demandai-je.
« La liberté de te souvenir de ton soi », dit-elle. « Le Nagual a dit que perdre la forme humaine est comme une spirale. Cela te donne la liberté de te souvenir et cela à son tour te rend encore plus libre. »
« Pourquoi n’as-tu pas encore ressenti cette liberté ? » lui demandai-je.
Elle fit claquer sa langue, haussa les épaules. Elle semblait confuse ou réticente à poursuivre notre conversation.
« Je suis liée à toi », dit-elle. « Tant que tu ne perdras pas ta forme humaine pour te souvenir, je ne pourrai pas savoir ce qu’est cette liberté. Mais peut-être que tu ne pourras pas perdre ta forme humaine si tu ne te souviens pas d’abord. Nous ne devrions pas parler de ça de toute façon. Pourquoi n’irais-tu pas parler aux Genaros ? »
Elle avait l’air d’une mère envoyant son enfant jouer dehors. Cela ne me dérangeait pas le moins du monde. De la part de quelqu’un d’autre, j’aurais facilement pu prendre la même attitude pour de l’arrogance ou du mépris. J’aimais être avec elle, c’était la différence.
J’ai trouvé Pablito, Nestor et Benigno dans la maison de Genaro en train de jouer à un jeu étrange. Pablito se balançait à environ quatre pieds au-dessus du sol à l’intérieur de quelque chose qui semblait être un harnais en cuir foncé attaché à sa poitrine sous ses aisselles. Le harnais ressemblait à un épais gilet en cuir. En concentrant mon attention dessus, j’ai remarqué que Pablito se tenait en fait sur des sangles épaisses qui descendaient du harnais comme des étriers. Il était suspendu au centre de la pièce par deux cordes passées sur une épaisse poutre transversale ronde qui soutenait le toit. Chaque corde était attachée au harnais lui-même, au-dessus des épaules de Pablito, par un anneau métallique.
Nestor et Benigno tenaient chacun une corde. Ils se tenaient debout, face à face, maintenant Pablito en l’air par la force de leur traction. Pablito s’accrochait de toutes ses forces à deux longs poteaux minces qui étaient plantés dans le sol et s’ajustaient confortablement dans ses mains serrées. Nestor était à la gauche de Pablito et Benigno à sa droite.
Le jeu semblait être une lutte à la corde à trois, une bataille féroce entre ceux qui tiraient et celui qui était suspendu.
Quand je suis entré dans la pièce, tout ce que je pouvais entendre était la respiration lourde de Nestor et Benigno. Les muscles de leurs bras et de leur cou étaient saillants sous l’effort de la traction.
Pablito gardait un œil sur les deux, se concentrant sur chacun, un à la fois, d’un coup d’œil d’une fraction de seconde. Tous les trois étaient si absorbés par leur jeu qu’ils n’ont même pas remarqué ma présence, ou s’ils l’ont fait, ils ne pouvaient pas se permettre de rompre leur concentration pour me saluer.
Nestor et Benigno se sont fixés pendant dix à quinze minutes dans un silence total. Puis Nestor a fait semblant de lâcher sa corde. Benigno n’est pas tombé dans le panneau, mais Pablito si. Il a resserré la prise de sa main gauche et a calé ses pieds sur les poteaux afin de renforcer sa prise. Benigno a profité de ce moment pour frapper et a donné une puissante traction à l’instant précis où Pablito relâchait sa prise.
La traction de Benigno a pris Pablito et Nestor par surprise. Benigno s’est suspendu à la corde de tout son poids. Nestor était déjoué. Pablito a lutté désespérément pour s’équilibrer. C’était inutile. Benigno a remporté la manche.
Pablito est sorti du harnais et est venu là où j’étais. Je l’ai interrogé sur leur jeu extraordinaire. Il semblait quelque peu réticent à parler. Nestor et Benigno nous ont rejoints après avoir rangé leur équipement. Nestor a dit que leur jeu avait été conçu par Pablito, qui avait trouvé la structure en rêve et l’avait ensuite construite comme un jeu. Au début, c’était un dispositif pour tendre les muscles de deux d’entre eux en même temps. Ils se hissaient à tour de rôle. Mais ensuite, le rêve de Benigno leur a donné l’entrée dans un jeu où tous les trois tendaient leurs muscles, et ils aiguisaient leur prouesse visuelle en restant dans un état d’alerte, parfois pendant des heures.
« Benigno pense maintenant que cela aide nos corps à se souvenir », a poursuivi Nestor. « La Gorda, par exemple, y joue d’une manière étrange. Elle gagne à chaque fois, quelle que soit la position qu’elle joue. Benigno pense que c’est parce que son corps se souvient. »
Je leur ai demandé s’ils avaient aussi la règle du silence. Ils ont ri. Pablito a dit que la Gorda voulait plus que tout être comme le Nagual Juan Matus. Elle l’imitait délibérément, jusqu’au détail le plus absurde.
« Tu veux dire que nous pouvons parler de ce qui s’est passé l’autre soir ? » ai-je demandé, presque déconcerté, puisque la Gorda y avait été si fermement opposée.
« On s’en fiche », a dit Pablito. « Tu es le Nagual ! »
« Benigno ici s’est souvenu de quelque chose de vraiment, vraiment bizarre », a dit Nestor sans me regarder. « Je pense que c’était un rêve confus, moi », a dit Benigno. « Mais Nestor pense que non. »
J’ai attendu avec impatience. D’un mouvement de la tête, je les ai exhortés à continuer.
« L’autre jour, il s’est souvenu que tu lui apprenais à chercher des traces dans la terre molle », a dit Nestor.
« Ça a dû être un rêve », dis-je.
Je voulais rire de l’absurdité, mais tous les trois me regardèrent avec des yeux suppliants.
« C’est absurde », dis-je.
« Quoi qu’il en soit, je ferais mieux de te dire maintenant que j’ai un souvenir similaire », a dit Nestor. « Tu m’as emmené sur des rochers et tu m’as montré comment me cacher. Le mien n’était pas un rêve confus. J’étais éveillé. Je me promenais avec Benigno un jour, cherchant des plantes, et soudain je me suis souvenu que tu m’enseignais, alors je me suis caché comme tu m’as appris et j’ai fait une peur bleue à Benigno. »
« Je vous ai enseigné ! Comment est-ce possible ? Quand ? » ai-je demandé.
Je commençais à devenir nerveux. Ils ne semblaient pas plaisanter.
« Quand ? C’est là la question », a dit Nestor. « Nous n’arrivons pas à savoir quand. Mais Benigno et moi savons que c’était toi. »
Je me sentis lourd, oppressé. Ma respiration devint difficile. Je craignis de tomber à nouveau malade. J’ai décidé sur-le-champ de leur raconter ce que la Gorda et moi avions vu ensemble. En parler m’a détendu. À la fin de mon récit, j’étais de nouveau maître de moi-même.
« Le Nagual Juan Matus nous a laissés un peu ouverts », a dit Nestor. « Nous pouvons tous voir un peu. Nous voyons des trous chez les personnes qui ont eu des enfants et aussi, de temps en temps, nous voyons une petite lueur chez les gens. Comme tu ne vois pas du tout, on dirait que le Nagual t’a laissé complètement fermé pour que tu t’ouvres de l’intérieur. Maintenant, tu as aidé la Gorda et soit elle voit de l’intérieur, soit elle se contente de monter sur ton dos. »
Je leur ai dit que ce qui s’était passé à Oaxaca était peut-être un coup de chance.
Pablito pensait que nous devrions aller sur le rocher préféré de Genaro et nous asseoir là, la tête contre la tête. Les deux autres ont trouvé son idée brillante. Je n’avais aucune objection. Bien que nous soyons restés assis là longtemps, rien ne s’est passé. Nous nous sommes cependant beaucoup détendus.
Alors que nous étions encore assis sur le rocher, je leur ai parlé des deux hommes que la Gorda avait cru être don Juan et don Genaro. Ils ont glissé vers le bas et m’ont pratiquement traîné jusqu’à la maison de la Gorda. Nestor était le plus agité. Il était presque incohérent. Tout ce que j’ai pu tirer d’eux, c’est qu’ils attendaient un signe de cette nature.
La Gorda nous attendait à la porte. Elle savait ce que je leur avais dit.
« Je voulais juste donner du temps à mon corps », dit-elle avant que nous ayons dit quoi que ce soit. « Je dois en être absolument sûre, et je le suis. C’était le Nagual et Genaro. »
« Qu’y a-t-il dans ces cabanes ? » demanda Nestor.
« Ils ne sont pas entrés dedans », dit la Gorda. « Ils se sont éloignés vers les champs ouverts, vers l’est. En direction de cette ville. »
Elle semblait déterminée à les apaiser. Elle leur a demandé de rester ; ils ne voulaient pas. Ils se sont excusés et sont partis. J’étais sûr qu’ils se sentaient mal à l’aise en sa présence. Elle semblait très en colère. J’appréciais plutôt ses explosions de colère, ce qui était tout à fait contraire à mes réactions normales. Je m’étais toujours senti nerveux en présence de quelqu’un qui était contrarié, à l’exception mystérieuse de la Gorda.
Aux premières heures de la soirée, nous nous sommes tous réunis dans la chambre de la Gorda. Ils semblaient tous préoccupés. Ils étaient assis en silence, fixant le sol. La Gorda a essayé d’engager la conversation. Elle a dit qu’elle n’était pas restée inactive, qu’elle avait fait le rapprochement entre plusieurs choses et qu’elle avait trouvé des solutions.
« Ce n’est pas une question de faire des rapprochements », a dit Nestor. « C’est une tâche de se souvenir avec le corps. »
Il semblait qu’ils en avaient parlé entre eux, à en juger par les hochements de tête d’approbation que Nestor a reçus des autres. Cela nous laissait, la Gorda et moi, comme les étrangers.
« Lydia aussi se souvient de quelque chose », a poursuivi Nestor. « Elle pensait que c’était sa stupidité, mais en entendant ce que je me suis souvenu, elle nous a dit que ce Nagual ici l’avait emmenée chez un guérisseur et l’y avait laissée pour qu’on lui soigne les yeux. »
La Gorda et moi nous sommes tournés vers Lydia. Elle a baissé la tête comme si elle était embarrassée. Elle a marmonné. Le souvenir semblait trop douloureux pour elle. Elle a dit que lorsque don Juan l’a trouvée pour la première fois, ses yeux étaient infectés et qu’elle ne pouvait pas voir. Quelqu’un l’a conduite en voiture sur une grande distance jusqu’au guérisseur qui l’a guérie. Elle avait toujours été convaincue que don Juan avait fait cela, mais en entendant ma voix, elle a réalisé que c’était moi qui l’y avais emmenée. L’incongruité d’un tel souvenir l’a plongée dans l’agonie dès le premier jour où elle m’a rencontré.
« Mes oreilles ne me mentent pas », a ajouté Lydia après un long silence. « C’est toi qui m’y as emmenée. »
« Impossible ! Impossible ! » ai-je crié.
Mon corps a commencé à trembler, de manière incontrôlable. J’ai eu un sentiment de dualité. Peut-être que ce que j’appelle mon moi rationnel, incapable de contrôler le reste de moi, a pris la place d’un spectateur. Une partie de moi regardait tandis qu’une autre partie de moi tremblait.
(Carlos Castaneda, Le Don de l’Aigle)