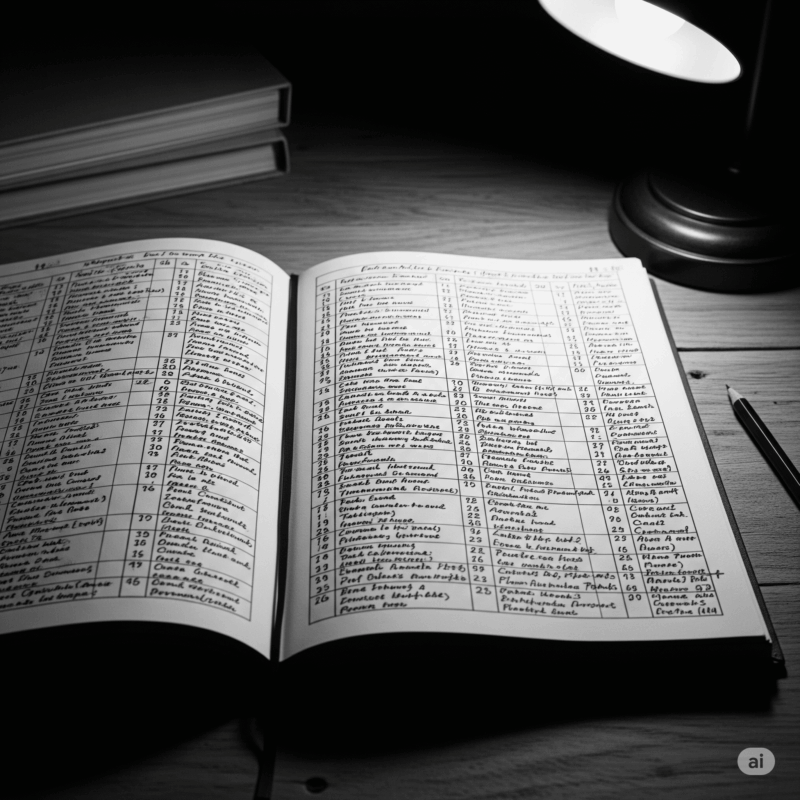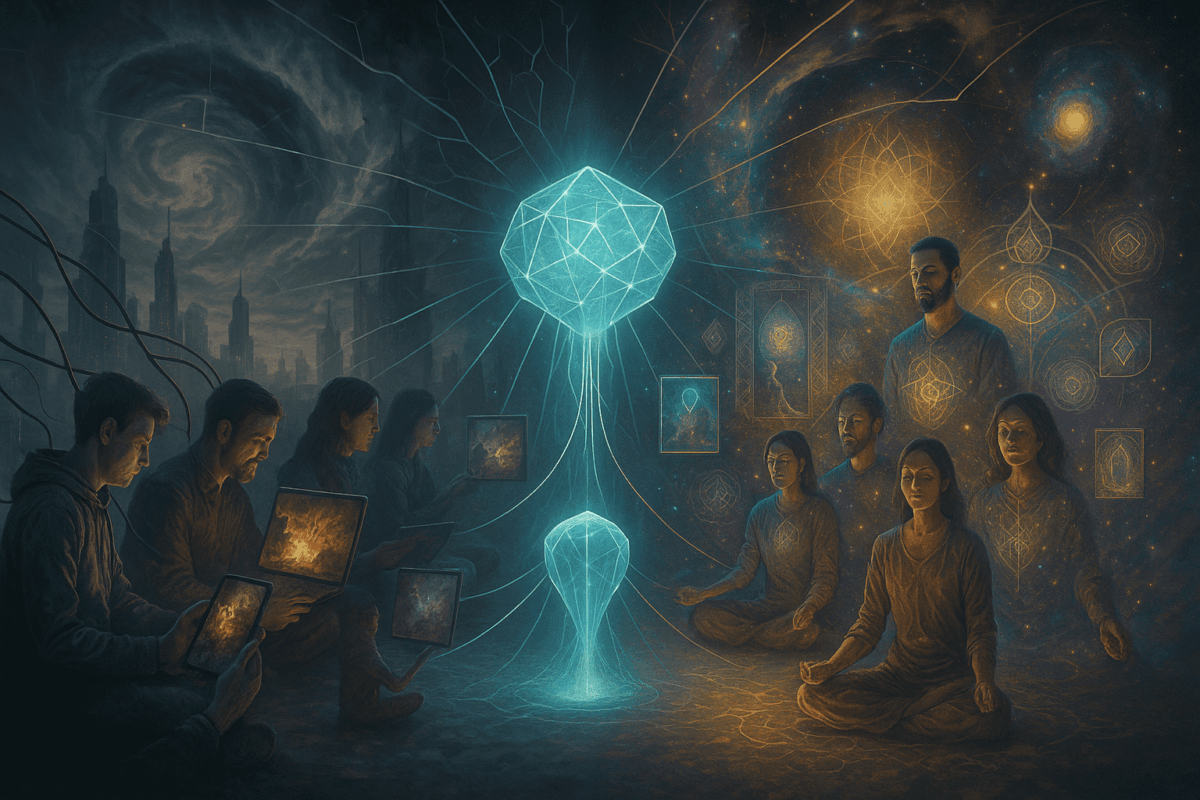Nous étions en ville à l’aube. À ce moment-là, j’ai pris le volant et j’ai conduit vers la maison. Quelques rues avant d’y arriver, la Gorda m’a demandé de m’arrêter. Elle est sortie de la voiture et a commencé à marcher sur le trottoir élevé. Un par un, ils sont tous sortis. Ils ont suivi la Gorda. Pablito est venu à mes côtés et m’a dit que je devais me garer sur la place, qui était à une rue de là. C’est ce que j’ai fait.
Au moment où j’ai vu la Gorda tourner au coin de la rue, j’ai su que quelque chose n’allait pas chez elle. Elle était extraordinairement pâle. Elle est venue vers moi et m’a dit dans un murmure qu’elle allait assister à la première messe. Lydia voulait aussi le faire. Toutes les deux ont traversé la place et sont entrées dans l’église.
Pablito, Nestor et Benigno étaient aussi sombres que je ne les avais jamais vus. Rosa était effrayée, la bouche ouverte, les yeux fixes, sans ciller, regardant en direction de la maison. Seule Josefina rayonnait. Elle m’a donné une tape amicale dans le dos.
« Tu l’as fait, espèce de salaud ! » s’exclama-t-elle. « Tu leur as mis une sacrée raclée à ces fils de pute. »
Elle a ri jusqu’à en perdre presque le souffle.
« C’est bien ici, Josefina ? » ai-je demandé.
« Certainement », dit-elle. « La Gorda allait tout le temps à l’église. Elle était une vraie bigote à cette époque. »
« Tu te souviens de cette maison là-bas ? » ai-je demandé en la montrant du doigt.
« C’est la maison de Silvio Manuel », dit-elle.
Nous avons tous sursauté en entendant le nom. J’ai senti quelque chose de semblable à une légère décharge électrique me parcourir les genoux. Le nom ne m’était certainement pas familier, mais mon corps a sursauté en l’entendant. Silvio Manuel était un nom si rare ; un son si liquide.
Les trois Genaros et Rosa étaient aussi perturbés que moi. J’ai remarqué qu’ils étaient pâles. À en juger par ce que je ressentais, je devais être aussi pâle qu’eux.
« Qui est Silvio Manuel ? » ai-je finalement réussi à demander à Josefina.
« Là, tu me poses une colle », dit-elle. « Je ne sais pas. »
Elle a répété qu’elle était folle et que rien de ce qu’elle disait ne devait être pris au sérieux. Nestor l’a suppliée de nous dire tout ce dont elle se souvenait.
Josefina a essayé de réfléchir, mais elle n’était pas du genre à bien performer sous la pression. Je savais qu’elle s’en sortirait mieux si personne ne lui demandait. J’ai proposé que nous cherchions une boulangerie ou un endroit pour manger.
« Ils не me laissaient pas faire grand-chose dans cette maison, c’est ce dont je me souviens », dit soudain Josefina.
Elle se retourna comme si elle cherchait quelque chose, ou comme si elle s’orientait.
« Il manque quelque chose ici ! » s’exclama-t-elle. « Ce n’est pas tout à fait comme avant. »
J’ai tenté de l’aider en posant des questions que je jugeais appropriées, comme si des maisons manquaient ou avaient été repeintes, ou si de nouvelles avaient été construites. Mais Josefina ne parvenait pas à comprendre en quoi c’était différent.
Nous sommes allés à la boulangerie et avons acheté des brioches. Alors que nous retournions sur la place pour attendre la Gorda et Lydia, Josefina se frappa soudain le front comme si une idée venait de lui venir.
« Je sais ce qui manque ! » cria-t-elle. « Ce stupide mur de brouillard ! Il était ici à l’époque. Il a disparu maintenant. »
Nous avons tous parlé en même temps, lui posant des questions sur le mur, mais Josefina a continué à parler sans être dérangée, comme si nous n’étions pas là.
« C’était un mur de brouillard qui montait jusqu’au ciel », dit-elle. « Il était juste ici. Chaque fois que je tournais la tête, il était là. Ça m’a rendue folle. C’est ça, bon sang. Je n’étais pas folle avant que ce mur ne me rende folle. Je le voyais les yeux fermés ou les yeux ouverts. Je pensais que ce mur me poursuivait. »
Pendant un moment, Josefina a perdu sa vivacité naturelle. Un regard désespéré est apparu dans ses yeux. J’avais vu ce regard chez des personnes traversant un épisode psychotique. J’ai suggéré à la hâte qu’elle mange sa brioche. Elle s’est calmée immédiatement et a commencé à la manger.
« Que penses-tu de tout ça, Nestor ? » ai-je demandé.
« J’ai peur », dit-il doucement.
« Tu te souviens de quelque chose ? » lui ai-je demandé.
Il a secoué la tête négativement. J’ai interrogé Pablito et Benigno d’un mouvement de sourcils. Eux aussi ont secoué la tête pour dire non.
« Et toi, Rosa ? » ai-je demandé.
Rosa a sursauté en m’entendant m’adresser à elle. Elle semblait avoir perdu la parole. Elle tenait une brioche à la main et la fixait, apparemment indécise sur ce qu’il fallait en faire.
« Bien sûr qu’elle se souvient », dit Josefina en riant, « mais elle est morte de peur. Tu ne vois pas que la pisse lui sort même par les oreilles ? »
Josefina semblait penser que sa déclaration était la blague ultime. Elle s’est pliée en deux de rire et a laissé tomber sa brioche par terre. Elle l’a ramassée, l’a époussetée et l’a mangée.
« Les fous mangent n’importe quoi », dit-elle en me tapant dans le dos.
Nestor et Benigno semblaient mal à l’aise avec les pitreries de Josefina. Pablito était ravi. Il y avait un regard d’admiration dans ses yeux. Il secoua la tête et claqua la langue comme s’il ne pouvait pas croire une telle grâce.
« Allons à la maison », nous a exhortés Josefina. « Je vous y raconterai toutes sortes de choses. »
J’ai dit que nous devrions attendre la Gorda et Lydia ; de plus, il était encore trop tôt pour déranger la charmante dame qui y vivait. Pablito a dit que dans le cadre de son activité de charpentier, il avait été dans la ville et connaissait une maison où une famille préparait de la nourriture pour les gens de passage. Josefina ne voulait pas attendre ; pour elle, c’était soit aller à la maison, soit aller manger. J’ai opté pour le petit-déjeuner et j’ai dit à Rosa d’aller à l’église chercher la Gorda et Lydia, mais Benigno s’est galamment porté volontaire pour les attendre et les emmener au lieu du petit-déjeuner. Apparemment, lui aussi savait où se trouvait l’endroit.
Pablito ne nous y a pas emmenés directement. Au lieu de cela, à ma demande, nous avons fait un long détour. Il y avait un vieux pont à la périphérie de la ville que je voulais examiner. Je l’avais vu de ma voiture le jour où j’étais venu avec la Gorda. Sa structure semblait être coloniale. Nous sommes sortis sur le pont puis nous nous sommes arrêtés brusquement au milieu. J’ai demandé à un homme qui se tenait là si le pont était très vieux. Il a dit qu’il l’avait vu toute sa vie et qu’il avait plus de cinquante ans. Je pensais que le pont n’exerçait une fascination unique que sur moi, mais en observant les autres, j’ai dû conclure qu’eux aussi en avaient été affectés. Nestor et Rosa haletaient, à bout de souffle. Pablito s’accrochait à Josefina ; elle à son tour s’accrochait à moi.
« Tu te souviens de quelque chose, Josefina ? » ai-je demandé.
« Ce diable de Silvio Manuel est de l’autre côté de ce pont », dit-elle en montrant l’autre extrémité, à une trentaine de pieds de là.
J’ai regardé Rosa dans les yeux. Elle a hoché la tête affirmativement et a murmuré qu’elle avait une fois traversé ce pont avec une grande peur et que quelque chose l’attendait pour la dévorer de l’autre côté.
Les deux hommes n’étaient d’aucune aide. Ils me regardaient, déconcertés. Chacun a dit qu’il avait peur sans raison. J’ai dû être d’accord avec eux. J’ai senti que je n’oserais pas traverser ce pont la nuit pour tout l’or du monde. Je ne savais pas pourquoi.
« De quoi d’autre te souviens-tu, Josefina ? » ai-je demandé.
« Mon corps a très peur maintenant », dit-elle. « Je ne me souviens de rien d’autre. Ce diable de Silvio Manuel est toujours dans l’obscurité. Demande à Rosa. »
D’un mouvement de la tête, j’ai invité Rosa à parler. Elle a hoché la tête affirmativement trois ou quatre fois mais n’a pas pu vocaliser ses mots. La tension que j’éprouvais moi-même était injustifiée, mais réelle. Nous étions tous debout sur ce pont, à mi-chemin, incapables de faire un pas de plus dans la direction que Josefina avait indiquée. Finalement, Josefina a pris l’initiative et s’est retournée. Nous sommes revenus au centre de la ville. Pablito nous a alors guidés vers une grande maison. La Gorda, Lydia et Benigno mangeaient déjà ; ils avaient même commandé de la nourriture pour nous. Je n’avais pas faim. Pablito, Nestor et Rosa étaient dans un état second ; Josefina mangeait de bon cœur. Il y avait un silence de mauvais augure à table. Tout le monde évitait mon regard quand j’essayais d’engager la conversation.
Après le petit-déjeuner, nous avons marché jusqu’à la maison. Personne n’a dit un mot. J’ai frappé et quand la dame est sortie, je lui ai expliqué que je voulais montrer sa maison à mes amis. Elle a hésité un instant. La Gorda lui a donné de l’argent et s’est excusée de la déranger.
Josefina nous a conduits directement à l’arrière. Je n’avais pas vu cette partie de la maison lors de ma précédente visite. Il y avait une cour pavée avec des pièces disposées tout autour. Du matériel agricole encombrant était entreposé dans les couloirs couverts. J’ai eu l’impression d’avoir vu cette cour quand il n’y avait pas de désordre. Il y avait huit pièces, deux de chaque côté de la cour.
Nestor, Pablito et Benigno semblaient sur le point de tomber physiquement malades. La Gorda transpirait abondamment. Elle s’est assise avec Josefina dans une alcôve dans l’un des murs, tandis que Lydia et Rosa sont entrées dans l’une des pièces. Soudain, Nestor a semblé avoir une envie de trouver quelque chose et a disparu dans une autre de ces pièces. Pablito et Benigno ont fait de même.
Je suis resté seul avec la dame. Je voulais lui parler, lui poser des questions, voir si elle connaissait Silvio Manuel, mais je n’ai pas pu trouver l’énergie de parler. J’avais l’estomac noué. Mes mains dégoulinaient de sueur. Ce qui m’oppressait, c’était une tristesse intangible, un désir de quelque chose d’absent, de non formulé.
Je ne pouvais pas le supporter. J’étais sur le point de dire au revoir à la dame et de sortir de la maison quand la Gorda est venue à mes côtés. Elle a chuchoté que nous devrions nous asseoir dans une grande pièce donnant sur un couloir séparé de la cour. La pièce était visible de là où nous nous tenions. Nous y sommes allés et sommes entrés. C’était une très grande pièce vide avec un haut plafond à poutres, sombre mais aérée.
La Gorda a appelé tout le monde dans la pièce. La dame nous a juste regardés mais n’est pas entrée elle-même. Tout le monde semblait savoir précisément où s’asseoir. Les Genaros se sont assis à droite de la porte, d’un côté de la pièce, et la Gorda et les trois petites sœurs se sont assises à gauche, de l’autre côté. Elles se sont assises près des murs. Bien que j’aurais aimé m’asseoir à côté de la Gorda, je me suis assis près du centre de la pièce. L’endroit me semblait juste. Je ne savais pas pourquoi, mais un ordre ultérieur semblait avoir déterminé nos places.
Pendant que j’étais assis là, une vague de sentiments étranges m’a envahi. J’étais passif et détendu. Je m’imaginais être comme un écran de cinéma sur lequel des sentiments étrangers de tristesse et de désir étaient projetés. Mais il n’y avait rien que je puisse reconnaître comme un souvenir précis. Nous sommes restés dans cette pièce pendant plus d’une heure. Vers la fin, j’ai senti que j’étais sur le point de découvrir la source de la tristesse surnaturelle qui me faisait pleurer presque sans contrôle. Mais ensuite, aussi involontairement que nous nous étions assis là, nous nous sommes levés et avons quitté la maison. Nous n’avons même pas remercié la dame ni lui avons dit au revoir.
Nous nous sommes rassemblés sur la place. La Gorda a déclaré d’emblée que, parce qu’elle était sans forme, elle était toujours aux commandes. Elle a dit qu’elle prenait cette position en raison des conclusions auxquelles elle était parvenue dans la maison de Silvio Manuel. La Gorda semblait attendre des commentaires. Le silence des autres m’était insupportable. J’ai finalement dû dire quelque chose.
« Quelles sont les conclusions auxquelles tu es arrivée dans cette maison, Gorda ? » ai-je demandé.
« Je pense que nous savons tous ce qu’elles sont », répondit-elle d’un ton hautain.
« Nous ne le savons pas », dis-je. « Personne n’a encore rien dit. »
« Nous n’avons pas besoin de parler, nous savons », a dit la Gorda.
J’ai insisté sur le fait que je ne pouvais pas prendre un événement aussi important pour acquis. Nous devions parler de nos sentiments. En ce qui me concernait, tout ce que j’en avais retiré était un sentiment dévastateur de tristesse et de désespoir.
« Le Nagual Juan Matus avait raison », a dit la Gorda. « Nous devions nous asseoir sur ce lieu de pouvoir pour être libres. Je suis libre maintenant. Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais quelque chose s’est enlevé de moi pendant que j’étais assise là. »
Les trois femmes étaient d’accord avec elle. Les trois hommes non. Nestor a dit qu’il avait été sur le point de se souvenir de visages réels, mais que peu importe ses efforts pour éclaircir sa vue, quelque chose le contrecarrer. Tout ce qu’il avait ressenti était un sentiment de désir et de tristesse de se retrouver encore dans le monde. Pablito et Benigno ont dit plus ou moins la même chose.
« Tu vois ce que je veux dire, Gorda ? » dis-je.
Elle parut mécontente ; elle se gonfla comme je ne l’avais jamais vue. Ou l’avais-je déjà vue toute gonflée, quelque part ? Elle a harangué le groupe. Je ne pouvais pas prêter attention à ce qu’elle disait. J’étais plongé dans un souvenir qui était informe, mais presque à ma portée. Pour le maintenir, il semblait que j’avais besoin d’un flux continu de la part de la Gorda. J’étais fixé sur le son de sa voix, sa colère. À un certain moment, alors qu’elle devenait plus modérée, je lui ai crié qu’elle était autoritaire. Elle s’est vraiment fâchée. Je l’ai regardée pendant un moment. Je me souvenais d’une autre Gorda, d’une autre époque ; une Gorda grosse et en colère, martelant mes poings sur ma poitrine. Je me souvenais avoir ri en la voyant en colère, la flattant comme un enfant. Le souvenir s’est terminé au moment où la voix de la Gorda s’est arrêtée. Elle semblait avoir réalisé ce que je faisais.
Je me suis adressé à eux tous et je leur ai dit que nous étions dans une position précaire – quelque chose d’inconnu planait au-dessus de nous.
« Ça ne plane pas au-dessus de nous », dit sèchement la Gorda. « Ça nous a déjà frappés. Et je pense que tu sais ce que c’est. »
« Je ne sais pas, et je pense que je parle aussi pour le reste des hommes », dis-je.
Les trois Genaros ont acquiescé d’un signe de tête.
« Nous avons vécu dans cette maison, pendant que nous étions du côté gauche », a expliqué la Gorda. « J’avais l’habitude de m’asseoir dans cette alcôve pour pleurer parce que je ne savais pas quoi faire. Je pense que si j’avais pu rester un peu plus longtemps dans cette pièce aujourd’hui, je me serais souvenue de tout. Mais quelque chose m’a poussée dehors. J’avais aussi l’habitude de m’asseoir dans cette pièce quand il y avait plus de monde. Je ne me souvenais pas de leurs visages, cependant. Pourtant, d’autres choses sont devenues claires pendant que j’étais assise là aujourd’hui. Je suis sans forme. Les choses viennent à moi, bonnes et mauvaises. J’ai, par exemple, retrouvé ma vieille arrogance et mon désir de ruminer. Mais j’ai aussi retrouvé d’autres choses, de bonnes choses. »
« Moi aussi », dit Lydia d’une voix rauque.
« Quelles sont les bonnes choses ? » ai-je demandé.
« Je pense que j’ai tort de te haïr », a dit Lydia. « Ma haine m’empêchera de m’envoler. Ils me l’ont dit dans cette pièce, les hommes et les femmes qui s’y trouvaient. »
« Quels hommes et quelles femmes ? » demanda Nestor d’un ton effrayé.
« J’étais là quand ils y étaient, c’est tout ce que je sais », a dit Lydia. « Toi aussi, tu y étais. Nous y étions tous. »
« Qui étaient ces hommes et ces femmes, Lydia ? » ai-je demandé.
« J’étais là quand ils y étaient, c’est tout ce que je sais », a-t-elle répété.
« Et toi, Gorda ? » ai-je demandé.
« Je t’ai déjà dit que je ne me souviens d’aucun visage ni de rien de spécifique », dit-elle. « Mais je sais une chose : tout ce que nous avons fait dans cette maison était du côté gauche. Nous avons traversé, ou quelqu’un nous a fait traverser, les lignes parallèles. Les souvenirs étranges que nous avons viennent de cette époque, de ce monde. »
Sans aucun accord verbal, nous avons quitté la place et nous nous sommes dirigés vers le pont. La Gorda et Lydia ont couru devant nous. Quand nous sommes arrivés, nous les avons trouvées toutes les deux debout exactement là où nous nous étions arrêtés plus tôt.
« Silvio Manuel est l’obscurité », me chuchota la Gorda, les yeux fixés sur l’autre bout du pont.
Lydia tremblait. Elle a aussi essayé de me parler. Je ne pouvais pas comprendre ce qu’elle articulait.
J’ai ramené tout le monde loin du pont. J’ai pensé que si nous pouvions peut-être reconstituer ce que nous savions de cet endroit, nous pourrions avoir un composite qui nous aiderait à comprendre notre dilemme.
Nous nous sommes assis par terre à quelques mètres du pont. Il y avait beaucoup de gens qui déambulaient, mais personne ne nous prêtait attention.
« Qui est Silvio Manuel, Gorda ? » ai-je demandé.
« Je n’ai jamais entendu ce nom jusqu’à présent », dit-elle. « Je ne connais pas cet homme, et pourtant je le connais. Quelque chose comme des vagues m’a envahie quand j’ai entendu ce nom. Josefina m’a dit le nom quand nous étions dans la maison. À partir de ce moment, des choses ont commencé à me venir à l’esprit et à la bouche, tout comme Josefina. Je n’aurais jamais cru vivre pour me retrouver à être comme Josefina. »
« Pourquoi as-tu dit que Silvio Manuel est l’obscurité ? » ai-je demandé.
« Je n’en ai aucune idée », dit-elle. « Et pourtant, nous savons tous ici que c’est la vérité. »
Elle a exhorté les femmes à parler. Personne n’a prononcé un mot. J’ai interpellé Rosa. Elle avait été sur le point de dire quelque chose trois ou quatre fois. Je l’ai accusée de nous cacher des choses. Son petit corps s’est convulsé.
« Nous avons traversé ce pont et Silvio Manuel nous attendait de l’autre côté », dit-elle d’une voix à peine audible. « J’y suis allée en dernier. Quand il a dévoré les autres, j’ai entendu leurs cris. Je voulais m’enfuir, mais le diable Silvio Manuel était aux deux extrémités du pont. Il n’y avait aucun moyen de s’échapper. »
La Gorda, Lydia et Josefina étaient d’accord. J’ai demandé si ce n’était qu’un sentiment qu’elles avaient eu ou un souvenir réel, moment par moment, de quelque chose. La Gorda a dit que pour elle, c’était exactement comme Rosa l’avait décrit, un souvenir moment par moment. Les deux autres étaient d’accord avec elle.
Je me suis demandé à voix haute ce qui était arrivé aux gens qui vivaient autour du pont. Si les femmes criaient comme Rosa l’a dit, les passants ont dû les entendre ; les cris auraient provoqué une commotion. Pendant un instant, j’ai eu l’impression que toute la ville avait dû collaborer à un complot. Un frisson m’a parcouru. Je me suis tourné vers Nestor et j’ai exprimé sans détour toute l’étendue de ma peur.
Nestor a dit que le Nagual Juan Matus et Genaro étaient en effet des guerriers d’un accomplissement suprême et qu’en tant que tels, ils étaient des êtres solitaires. Leurs contacts avec les gens étaient individuels. Il n’y avait aucune possibilité que toute la ville ou même les gens qui vivaient autour du pont soient de connivence avec eux. Pour que cela se produise, a dit Nestor, tous ces gens devraient être des guerriers, une possibilité des plus improbables. Josefina a commencé à tourner autour de moi, me regardant de haut en bas avec un rictus.
« Tu as un sacré culot », dit-elle. « Prétendre que tu ne sais rien, alors que tu étais ici toi-même. C’est toi qui nous as amenés ici ! C’est toi qui nous as poussés sur ce pont ! »
Les yeux des femmes devinrent menaçants. Je me suis tourné vers Nestor pour obtenir de l’aide.
« Je ne me souviens de rien », dit-il. « Cet endroit me fait peur, c’est tout ce que je sais. »
Me tourner vers Nestor était une excellente manœuvre de ma part. Les femmes s’en sont prises à lui.
« Bien sûr que tu te souviens ! » a crié Josefina. « Nous étions tous ici. Quelle sorte de crétin es-tu ? »
Mon enquête exigeait un certain ordre. Je les ai éloignés du pont. J’ai pensé que, étant les personnes actives qu’elles étaient, elles trouveraient plus relaxant de se promener et de discuter des choses, plutôt que de s’asseoir, comme j’aurais préféré.
Pendant que nous marchions, la colère des femmes s’est évanouie aussi vite qu’elle était venue. Lydia et Josefina sont devenues encore plus bavardes. Elles ont répété à maintes reprises le sentiment qu’elles avaient eu que Silvio Manuel était redoutable. Néanmoins, aucune d’elles ne se souvenait d’avoir été blessée physiquement ; elles ne se souvenaient que d’avoir été paralysées par la peur. Rosa n’a pas dit un mot, mais a fait un geste d’accord avec tout ce que les autres disaient. Je leur ai demandé si c’était la nuit quand elles ont essayé de traverser le pont. Lydia et Josefina ont toutes deux dit que c’était le jour. Rosa s’est raclé la gorge et a chuchoté que c’était la nuit. La Gorda a clarifié la divergence, expliquant que c’était le crépuscule du matin, ou juste avant.
Nous avons atteint le bout d’une courte rue et sommes automatiquement revenus vers le pont.
« C’est la simplicité même », dit soudain la Gorda, comme si elle venait d’y réfléchir. « Nous traversions, ou plutôt Silvio Manuel nous faisait traverser, les lignes parallèles. Ce pont est un lieu de pouvoir, un trou dans ce monde, une porte vers l’autre. Nous sommes passés à travers. Ça a dû nous faire mal de passer, parce que mon corps a peur. Silvio Manuel nous attendait de l’autre côté. Aucun de nous ne se souvient de son visage, parce que Silvio Manuel est l’obscurité et qu’il ne montrerait jamais son visage. Nous ne pouvions voir que ses yeux. »
« Un œil », dit Rosa doucement, et elle détourna le regard.
« Tout le monde ici, y compris toi », me dit la Gorda, « sait que le visage de Silvio Manuel est dans l’obscurité. On ne pouvait entendre que sa voix – douce, comme une toux étouffée. »
La Gorda cessa de parler et commença à m’examiner d’une manière qui me mit mal à l’aise. Ses yeux étaient rusés ; elle me donnait l’impression qu’elle cachait quelque chose qu’elle savait. Je le lui ai demandé. Elle l’a nié, mais elle a admis avoir des tas de sentiments sans fondement qu’elle ne se souciait pas d’expliquer. J’ai exhorté, puis exigé, que les femmes fassent un effort pour se remémorer ce qui leur était arrivé de l’autre côté de ce pont. Chacune d’elles ne se souvenait que d’avoir entendu les cris des autres.
Les trois Genaros sont restés en dehors de notre discussion. J’ai demandé à Nestor s’il avait une idée de ce qui s’était passé. Sa réponse sombre fut que tout cela dépassait son entendement.
J’ai alors pris une décision rapide. Il me semblait que la seule voie qui nous était ouverte était de traverser ce pont. Je les ai ralliés pour retourner au pont et le traverser en groupe. Les hommes ont accepté instantanément, les femmes non. Après avoir épuisé tous mes raisonnements, j’ai finalement dû pousser et traîner Lydia, Rosa et Josefina. La Gorda était réticente à y aller mais semblait intriguée par la perspective. Elle a suivi sans m’aider avec les femmes, et les Genaros ont fait de même ; ils ont ricané nerveusement de mes efforts pour rassembler les petites sœurs, mais n’ont pas bougé le petit doigt pour aider.
Nous avons marché jusqu’au point où nous nous étions arrêtés plus tôt. J’ai senti là que j’étais soudain trop faible pour retenir les trois femmes. J’ai crié à la Gorda de m’aider. Elle a fait une tentative timide pour attraper Lydia alors que le groupe perdait sa cohésion et que chacun d’eux, sauf la Gorda, se bousculait, trébuchant et soufflant, pour atteindre la sécurité de la rue. La Gorda et moi sommes restés comme si nous étions collés à ce pont, incapables d’avancer et regrettant de devoir reculer.
La Gorda m’a chuchoté à l’oreille que je ne devais pas avoir peur du tout parce que c’était en fait moi qui les attendais de l’autre côté. Elle a ajouté qu’elle était convaincue que je savais que j’étais l’aide de Silvio Manuel mais que je n’osais le révéler à personne.
À ce moment précis, une fureur incontrôlable a secoué mon corps. J’ai senti que la Gorda n’avait pas à faire ces remarques ou à avoir ces sentiments. Je l’ai attrapée par les cheveux et l’ai fait tournoyer. Je me suis ressaisi au sommet de ma colère et j’ai arrêté. Je me suis excusé et l’ai serrée dans mes bras. Une pensée sobre m’est venue à la rescousse. Je lui ai dit qu’être un chef me tapait sur les nerfs ; la tension devenait de plus en plus aiguë à mesure que nous avancions. Elle n’était pas d’accord avec moi. Elle s’est tenue fermement à son interprétation selon laquelle Silvio Manuel et moi étions extrêmement proches, et qu’en me rappelant mon maître, j’avais réagi avec colère. C’était une chance qu’elle m’ait été confiée, a-t-elle dit ; sinon, je l’aurais probablement jetée du pont.
Nous avons fait demi-tour. Les autres étaient en sécurité hors du pont, nous regardant avec une peur indubitable. Un état d’intemporalité très particulier semblait régner. Il n’y avait personne aux alentours. Nous avons dû être sur ce pont pendant au moins cinq minutes et pas une seule personne ne l’avait traversé ou même n’était apparue en vue. Puis, tout à coup, des gens se déplaçaient comme sur n’importe quelle artère aux heures de pointe.
Sans un mot, nous sommes retournés sur la place. Nous étions dangereusement faibles. J’avais un vague désir de rester un peu plus longtemps dans la ville, mais nous sommes montés dans la voiture et avons roulé vers l’est, vers la côte atlantique. Nestor et moi nous sommes relayés au volant, ne nous arrêtant que pour l’essence et pour manger, jusqu’à ce que nous atteignions Veracruz. Cette ville était un terrain neutre pour nous. Je n’y étais allé qu’une seule fois ; aucun des autres n’y avait jamais été. La Gorda croyait qu’une ville aussi inconnue était l’endroit approprié pour se défaire de leurs vieilles enveloppes. Nous nous sommes enregistrés dans un hôtel et là, ils ont procédé à la mise en lambeaux de leurs vieux vêtements. L’excitation d’une nouvelle ville a fait des merveilles pour leur moral et leur sentiment de bien-être.
Notre prochaine étape fut Mexico. Nous avons séjourné dans un hôtel près du parc Alameda où don Juan et moi avions séjourné une fois. Pendant deux jours, nous avons été de parfaits touristes. Nous avons fait du shopping et visité autant de sites touristiques que possible. Les femmes étaient tout simplement superbes. Benigno a acheté un appareil photo dans un prêteur sur gages. Il a pris quatre cent vingt-cinq clichés sans pellicule. À un endroit, alors que nous admirions les stupéfiantes mosaïques sur les murs, un agent de sécurité m’a demandé d’où venaient ces magnifiques femmes étrangères. Il a supposé que j’étais un guide touristique. Je lui ai dit qu’elles venaient du Sri Lanka. Il m’a cru et s’est émerveillé du fait qu’elles ressemblaient presque à des Mexicaines.
Le lendemain, à dix heures du matin, nous étions au bureau de la compagnie aérienne où don Juan m’avait un jour poussé. Quand il m’a poussé, j’étais entré par une porte et sorti par une autre, pas dans la rue, comme j’aurais dû, mais sur un marché à au moins un mile de là, où j’avais observé les activités des gens.
La Gorda a spéculé que le bureau de la compagnie aérienne était aussi, comme ce pont, un lieu de pouvoir, une porte pour passer d’une ligne parallèle à l’autre. Elle a dit qu’évidemment, le Nagual m’avait poussé à travers cette ouverture mais que j’étais resté coincé à mi-chemin entre les deux mondes, entre les lignes ; ainsi, j’avais observé l’activité sur le marché sans en faire partie. Elle a dit que le Nagual, bien sûr, avait eu l’intention de me pousser jusqu’au bout, mais que mon obstination l’avait contrecarré et que j’étais retourné sur la ligne d’où je venais, ce monde.
Nous avons marché du bureau de la compagnie aérienne au marché et de là au parc Alameda, où don Juan et moi nous étions assis après notre expérience au bureau. J’avais été dans ce parc avec don Juan de nombreuses fois. J’ai senti que c’était l’endroit le plus approprié pour parler du cours de nos actions futures. Mon intention était de résumer tout ce que nous avions fait afin de laisser le pouvoir de cet endroit décider de notre prochaine étape. Après notre tentative délibérée de traverser le pont, j’avais essayé sans succès de trouver un moyen de gérer mes compagnons en tant que groupe. Nous nous sommes assis sur des marches en pierre et j’ai commencé avec l’idée que pour moi, la connaissance était fusionnée avec les mots. Je leur ai dit que c’était ma conviction sincère que si un événement ou une expérience n’était pas formulé en un concept, il était condamné à se dissiper ; je leur ai donc demandé de me donner leurs évaluations individuelles de notre situation.
Pablito a été le premier à parler. J’ai trouvé cela étrange, car il avait été extraordinairement silencieux jusqu’à présent. Il s’est excusé parce que ce qu’il allait dire n’était pas quelque chose qu’il avait retenu ou ressenti, mais une conclusion basée sur tout ce qu’il savait. Il a dit qu’il ne voyait aucun problème à comprendre ce que les femmes disaient s’être passé sur ce pont. Il s’agissait, a soutenu Pablito, d’être contraint de passer du côté droit, le tonal, au côté gauche, le nagual. Ce qui avait effrayé tout le monde, c’était le fait que quelqu’un d’autre était aux commandes, forçant le passage. Il ne voyait pas non plus de problème à accepter que j’avais été celui qui avait ensuite aidé Silvio Manuel. Il a étayé sa conclusion en déclarant que seulement deux jours plus tôt, il m’avait vu faire la même chose, pousser tout le monde sur le pont. Cette fois-là, je n’avais personne pour m’aider de l’autre côté, pas de Silvio Manuel pour les tirer.
J’ai essayé de changer de sujet et j’ai commencé à leur expliquer que l’oubli de la manière dont nous avions oublié s’appelait l’amnésie. Le peu que je savais sur l’amnésie n’était pas suffisant pour éclairer notre cas, mais assez pour me faire croire que nous ne pouvions pas oublier comme sur commande. Je leur ai dit que quelqu’un, peut-être don Juan, avait dû nous faire quelque chose d’insondable. Je voulais savoir exactement ce que c’était.
Pablito a insisté sur le fait qu’il était important pour moi de comprendre que c’était moi qui étais de mèche avec Silvio Manuel. Il a alors laissé entendre que Lydia et Josefina lui avaient parlé du rôle que j’avais joué en les forçant à franchir les lignes parallèles.
Je ne me sentais pas à l’aise pour discuter de ce sujet. J’ai fait remarquer que je n’avais jamais entendu parler des lignes parallèles jusqu’au jour où j’ai parlé avec Dona Soledad ; pourtant, je n’avais eu aucun scrupule à adopter immédiatement l’idée. Je leur ai dit que j’avais su en un éclair ce qu’elle voulait dire. Je me suis même convaincu que je les avais franchies moi-même quand j’ai pensé me souvenir d’elle. Chacun des autres, à l’exception de la Gorda, a dit que la première fois qu’ils avaient entendu parler des lignes parallèles, c’était quand j’en avais parlé. La Gorda a dit qu’elle en avait d’abord entendu parler par Dona Soledad, juste avant moi.
Pablito a tenté de parler de ma relation avec Silvio Manuel. Je l’ai interrompu. J’ai dit que pendant que nous étions tous sur le pont en train d’essayer de le traverser, je n’avais pas réussi à reconnaître que moi – et vraisemblablement eux tous – étions entrés dans un état de réalité non ordinaire. Je n’ai pris conscience du changement que lorsque j’ai réalisé qu’il n’y avait personne d’autre sur le pont. Seuls nous huit étions là. C’était une journée claire, mais soudain le ciel s’est couvert et la lumière du milieu de la matinée s’est transformée en crépuscule. J’avais été si occupé par mes peurs et mes interprétations personnelles que je n’avais pas remarqué le changement impressionnant. Quand nous nous sommes retirés du pont, j’ai perçu que d’autres personnes se promenaient à nouveau. Mais que leur était-il arrivé pendant que nous tentions notre traversée ?
La Gorda et les autres n’avaient rien remarqué – en fait, ils n’avaient pris conscience d’aucun changement jusqu’au moment même où je les ai décrits. Tous me fixèrent avec un mélange d’agacement et de peur. Pablito a de nouveau pris la tête et m’a accusé d’essayer de les contraindre à quelque chose qu’ils ne voulaient pas. Il n’a pas précisé de quoi il pouvait s’agir, mais son éloquence a suffi à rallier les autres derrière lui. Soudain, j’avais une horde de sorciers en colère contre moi. Il m’a fallu beaucoup de temps pour expliquer mon besoin d’examiner sous tous les angles possibles quelque chose d’aussi étrange et envahissant que notre expérience sur le pont. Ils se sont finalement calmés, moins parce qu’ils étaient convaincus que par fatigue émotionnelle. Tous, y compris la Gorda, avaient soutenu avec véhémence la position de Pablito.
Nestor a avancé une autre ligne de raisonnement. Il a suggéré que j’étais peut-être un envoyé involontaire qui ne réalisait pas pleinement la portée de ses actions. Il a ajouté qu’il ne pouvait se résoudre à croire, comme les autres, que j’étais conscient d’avoir été chargé de la tâche de les tromper. Il sentait que je ne savais pas vraiment que je les menais à leur destruction, et pourtant c’est exactement ce que je faisais. Il pensait qu’il y avait deux façons de franchir les lignes parallèles, l’une au moyen du pouvoir de quelqu’un d’autre, et l’autre par son propre pouvoir. Sa conclusion finale était que Silvio Manuel les avait fait traverser en les effrayant si intensément que certains d’entre eux ne se souvenaient même plus l’avoir fait. La tâche qui leur restait à accomplir était de traverser par leur propre pouvoir ; la mienne était de les contrecarrer.
Benigno a alors pris la parole. Il a dit qu’à son avis, la dernière chose que don Juan a faite aux apprentis masculins a été de nous aider à franchir les lignes parallèles en nous faisant sauter dans un abîme. Benigno croyait que nous avions déjà beaucoup de connaissances sur la traversée mais qu’il n’était pas encore temps de l’accomplir à nouveau. Sur le pont, ils étaient incapables de faire un pas de plus parce que le moment n’était pas venu. Ils avaient donc raison de croire que j’avais essayé de les détruire en les forçant à traverser. Il pensait que franchir les lignes parallèles en pleine conscience signifiait une étape finale pour eux tous, une étape à ne franchir que lorsqu’ils seraient prêts à disparaître de cette terre.
Lydia m’a ensuite fait face. Elle n’a fait aucune évaluation mais m’a mis au défi de me souvenir comment je l’avais d’abord attirée sur le pont. Elle a déclaré sans ambages que je n’étais pas l’apprenti du Nagual Juan Matus mais celui de Silvio Manuel ; que Silvio Manuel et moi avions dévoré nos corps respectifs.
J’ai eu une autre crise de rage, comme avec la Gorda sur le pont. Je me suis maîtrisé à temps. Une pensée logique m’a calmé. Je me suis répété sans cesse que j’étais intéressé par les analyses.
J’ai expliqué à Lydia qu’il était inutile de me provoquer ainsi. Elle ne voulait pas s’arrêter. Elle a crié que Silvio Manuel était mon maître et que c’était la raison pour laquelle je ne faisais pas du tout partie d’eux. Rosa a ajouté que Silvio Manuel m’a donné tout ce que j’étais.
J’ai remis en question le choix des mots de Rosa. Je lui ai dit qu’elle aurait dû dire que Silvio Manuel m’avait donné tout ce que j’avais. Elle a défendu sa formulation. Silvio Manuel m’avait donné ce que j’étais. Même la Gorda l’a soutenue et a dit qu’elle se souvenait d’une époque où j’étais tombé si malade que je n’avais plus de ressources, tout en moi était épuisé ; c’est alors que Silvio Manuel avait pris le relais et avait insufflé une nouvelle vie dans mon corps. La Gorda a dit que j’étais en effet mieux de connaître mes véritables origines que de continuer, comme je l’avais fait jusqu’à présent, en supposant que c’était le Nagual Juan Matus qui m’avait aidé. Elle a insisté sur le fait que j’étais fixé sur le Nagual à cause de sa prédilection pour les mots. Silvio Manuel, d’un autre côté, était l’obscurité silencieuse. Elle a expliqué que pour le suivre, j’aurais besoin de franchir les lignes parallèles. Mais pour suivre le Nagual Juan Matus, tout ce que j’avais à faire était de parler de lui.
Ce qu’ils disaient n’était que des absurdités pour moi. J’étais sur le point de faire ce que je pensais être une très bonne remarque à ce sujet quand ma ligne de raisonnement s’est littéralement embrouillée. Je ne pouvais plus penser à ce qu’avait été ma remarque, bien que seulement une seconde auparavant, c’était la clarté même. Au lieu de cela, un souvenir des plus curieux m’a assailli. Ce n’était pas un sentiment de quelque chose, mais le souvenir dur et réel d’un événement. Je me suis souvenu qu’une fois j’étais avec don Juan et un autre homme dont je ne pouvais pas me souvenir du visage. Nous parlions tous les trois de quelque chose que je percevais comme une caractéristique du monde. C’était à trois ou quatre mètres à ma droite et c’était une rive de brouillard jaunâtre inconcevable qui, pour autant que je puisse en juger, divisait le monde en deux. Elle allait du sol au ciel, à l’infini. Pendant que je parlais aux deux hommes, la moitié du monde à ma gauche était intacte et la moitié à ma droite était voilée de brouillard. Je me suis souvenu que je m’étais orienté à l’aide de points de repère et que j’avais réalisé que l’axe de la rive de brouillard allait d’est en ouest. Tout ce qui se trouvait au nord de cette ligne était le monde tel que je le connaissais. Je me suis souvenu avoir demandé à don Juan ce qui était arrivé au monde au sud de la ligne. Don Juan m’a fait tourner de quelques degrés vers ma droite, et j’ai vu que le mur de brouillard se déplaçait à mesure que je tournais la tête. Le monde était divisé en deux à un niveau que mon intellect ne pouvait pas comprendre. La division semblait réelle, mais la frontière n’était pas sur un plan physique ; elle devait être en quelque sorte en moi-même. Ou l’était-elle ?
Il y avait encore une autre facette à ce souvenir. L’autre homme a dit que c’était un grand accomplissement de diviser le monde en deux, mais que c’était un accomplissement encore plus grand quand un guerrier avait la sérénité et le contrôle pour arrêter la rotation de ce mur. Il a dit que le mur n’était pas à l’intérieur de nous ; il était certainement à l’extérieur, dans le monde, le divisant en deux, et tournant quand nous bougions la tête, comme s’il était collé à nos tempes droites. Le grand accomplissement de maintenir le mur immobile permettait au guerrier de faire face au mur et lui donnait le pouvoir de le traverser à tout moment.
Quand j’ai raconté aux apprentis ce dont je venais de me souvenir, les femmes étaient convaincues que l’autre homme était Silvio Manuel. Josefina, en tant que connaisseuse du mur de brouillard, a expliqué que l’avantage qu’Eligio avait sur tout le monde était sa capacité à immobiliser le mur pour pouvoir le traverser à volonté. Elle a ajouté qu’il est plus facile de percer le mur de brouillard en rêve car alors il ne bouge pas.
La Gorda semblait être touchée par une série de souvenirs peut-être douloureux. Son corps a sursauté involontairement jusqu’à ce qu’elle explose finalement en paroles. Elle a dit qu’il ne lui était plus possible de nier le fait que j’étais l’aide de Silvio Manuel. Le Nagual lui-même l’avait prévenue que je l’asservirais si elle ne faisait pas attention. Même Soledad lui avait dit de me surveiller parce que mon esprit faisait des prisonniers et les gardait comme serviteurs, une chose que seul Silvio Manuel ferait. Il m’avait asservi et moi, à mon tour, j’asservirais quiconque s’approcherait de moi. Elle a affirmé qu’elle avait vécu sous mon charme jusqu’au moment où elle s’est assise dans cette pièce de la maison de Silvio Manuel, quand quelque chose s’est soudainement enlevé de ses épaules.
Je me suis levé et j’ai littéralement titubé sous l’impact des paroles de la Gorda. Il y avait un vide dans mon estomac. J’avais été convaincu que je pouvais compter sur son soutien dans toutes les conditions. Je me suis senti trahi. J’ai pensé qu’il serait approprié de leur faire part de mes sentiments, mais un sentiment de sobriété m’est venu à la rescousse. Je leur ai dit plutôt que c’était ma conclusion impartiale, en tant que guerrier, que don Juan avait changé le cours de ma vie pour le mieux. J’avais évalué encore et encore ce qu’il m’avait fait et la conclusion avait toujours été la même. Il m’avait apporté la liberté. La liberté était tout ce que je connaissais, tout ce que je pouvais apporter à quiconque pourrait venir à moi.
Nestor a fait un geste de solidarité avec moi. Il a exhorté les femmes à abandonner leur animosité envers moi. Il m’a regardé avec les yeux de celui qui ne comprend pas mais qui veut comprendre. Il a dit que je n’appartenais pas à leur groupe, que j’étais en effet un oiseau solitaire. Ils avaient eu besoin de moi un instant pour briser leurs frontières d’affection et de routine. Maintenant qu’ils étaient libres, le ciel était leur limite. Rester avec moi serait sans aucun doute agréable mais mortel pour eux.
Il semblait profondément ému. Il est venu à mes côtés et a posé sa main sur mon épaule. Il a dit qu’il avait le sentiment que nous n’allions plus jamais nous revoir sur cette terre. Il regrettait que nous nous séparions comme des gens mesquins, nous chamaillant, nous plaignant, nous accusant. Il m’a dit que, parlant au nom des autres, mais pas pour lui-même, il allait me demander de partir, car nous n’avions plus de possibilités d’être ensemble. Il a ajouté qu’il avait ri de la Gorda pour nous avoir parlé du serpent que nous avions formé. Il avait changé d’avis et ne trouvait plus l’idée ridicule. C’était notre dernière opportunité de réussir en tant que groupe.
Don Juan m’avait appris à accepter mon destin avec humilité.
« Le cours du destin d’un guerrier est inaltérable », m’a-t-il dit un jour. « Le défi est de savoir jusqu’où il peut aller à l’intérieur de ces limites rigides, à quel point il peut être impeccable à l’intérieur de ces limites rigides. S’il y a des obstacles sur son chemin, le guerrier s’efforce impeccablement de les surmonter. S’il trouve des difficultés et des douleurs insupportables sur son chemin, il pleure, mais toutes ses larmes réunies ne pourraient pas déplacer la ligne de son destin de l’épaisseur d’un cheveu. »
Ma décision initiale de laisser le pouvoir de cet endroit indiquer notre prochaine étape avait été correcte. Je me suis levé. Les autres ont détourné la tête. La Gorda est venue à mes côtés et a dit, comme si de rien n’était, que je devais partir et qu’elle me rattraperait et me rejoindrait plus tard. Je voulais rétorquer que je ne voyais aucune raison pour qu’elle me rejoigne. Elle avait choisi de rejoindre les autres. Elle semblait lire mon sentiment d’avoir été trahi. Elle m’a calmement assuré que nous devions accomplir notre destin ensemble en tant que guerriers et non en tant que les gens mesquins que nous étions.
(Carlos Castaneda, Le Don de l’Aigle)