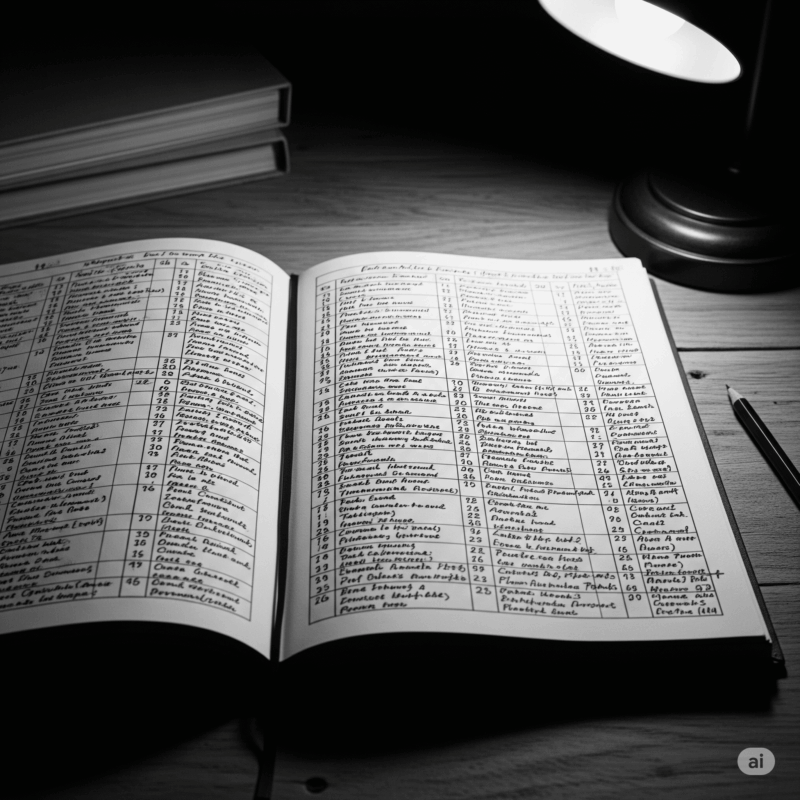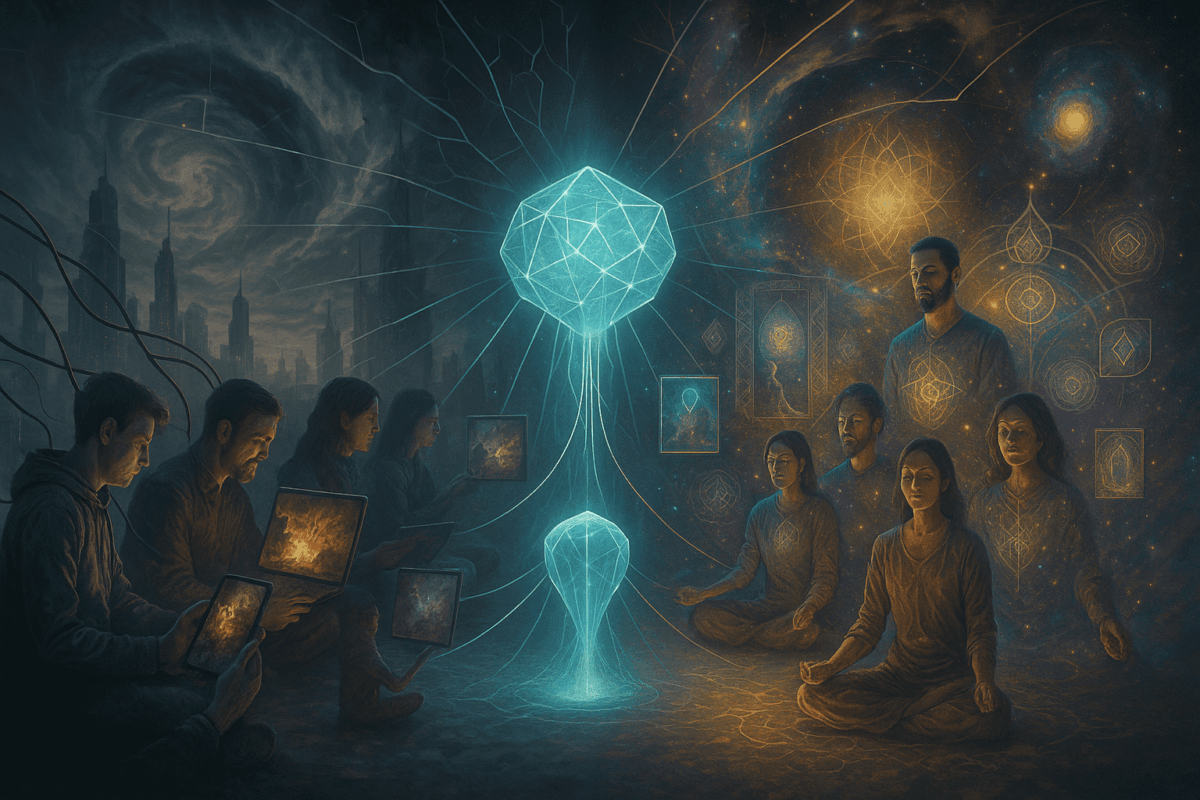Don Juan dit que lorsqu’il fut confié aux femmes de l’ouest pour être purifié, il fut également placé sous la direction de la femme du nord comparable à Florinda, la traqueuse numéro un, qui lui enseigna les principes de cet art. Elle et son bienfaiteur lui donnèrent les moyens concrets de s’assurer les trois guerriers masculins, le courrier et les quatre traqueuses qui devaient composer son groupe.
Les huit voyantes du groupe de son bienfaiteur avaient cherché les configurations de luminosité distinctives et n’avaient eu aucune difficulté à trouver les types appropriés de guerriers masculins et féminins pour le groupe de don Juan. Son bienfaiteur, cependant, ne permit pas à ces voyantes de faire quoi que ce soit pour rassembler les guerriers qu’elles avaient trouvés. Il fut laissé à don Juan le soin d’appliquer les principes de la traque et de les sécuriser.
Le premier guerrier à apparaître fut Vicente. Don Juan ne maîtrisait pas suffisamment la traque pour pouvoir le recruter. Son bienfaiteur et la traqueuse du nord durent faire la plus grande partie du travail. Puis vinrent Silvio Manuel, plus tard don Genaro, et enfin Emilito, le courrier.
Florinda fut la première guerrière. Elle fut suivie par Zoila, puis Delia, et ensuite Carmela. Don Juan dit que son bienfaiteur avait insisté sans relâche pour qu’ils traitent avec le monde exclusivement en termes de folie contrôlée. Le résultat final fut une équipe stupéfiante de praticiens, qui conçurent et exécutèrent les schémas les plus complexes.
Quand ils eurent tous acquis un certain degré de compétence dans l’art de la traque, leur bienfaiteur pensa qu’il était temps pour lui de leur trouver la femme Nagual. Fidèle à sa politique d’aider chacun à s’aider soi-même, il attendit pour l’amener dans leur monde, non seulement que tous soient des traqueurs experts, mais aussi que don Juan ait appris à voir. Bien que don Juan regrettât immensément le temps perdu à attendre, il admit que leur effort commun pour la sécuriser créa un lien plus fort entre eux tous. Cela revitalisa leur engagement à chercher leur liberté.
Son bienfaiteur commença à déployer sa stratégie pour attirer la femme Nagual en devenant tout à coup un fervent catholique. Il exigea que don Juan, en tant qu’héritier de son savoir, se comporte comme un fils et aille à l’église avec lui. Il l’entraîna à la messe presque tous les jours. Don Juan dit que son bienfaiteur, qui était très charmant et volubile, le présentait à tout le monde à l’église comme son fils, un rebouteux.
Don Juan, de son propre aveu un païen non civilisé à l’époque, était mortifié de se trouver dans des situations sociales où il devait parler et rendre compte de lui-même. Il se rassura à l’idée que son bienfaiteur avait un motif ultérieur pour tout ce qu’il faisait. Il tenta de déduire en l’observant quelles pouvaient être ses raisons. Les actions de son bienfaiteur étaient cohérentes et semblaient honnêtes. En tant que catholique exemplaire, il gagna la confiance de nombreuses personnes, en particulier le curé de la paroisse, qui le tenait en haute estime, le considérant comme un ami et un confident. Don Juan ne parvenait pas à comprendre ce qu’il tramait. L’idée lui traversa l’esprit que son bienfaiteur aurait pu sincèrement embrasser le catholicisme, ou être devenu fou. Il n’avait pas encore compris qu’un guerrier ne perd jamais la tête en aucune circonstance.
Les scrupules de don Juan à aller à l’église s’évanouirent lorsque son bienfaiteur commença à le présenter aux filles des gens qu’il connaissait. Il appréciait cela, bien qu’il se sentît mal à l’aise. Don Juan pensait que son bienfaiteur l’aidait à exercer sa langue. Il n’était ni volubile ni charmant, et son bienfaiteur avait dit qu’un Nagual, forcément, doit être les deux.
Un dimanche pendant la messe, après près d’un an de présence quasi quotidienne, don Juan découvrit la vraie raison de leur venue à l’église. Il était agenouillé à côté d’une fille nommée Olinda, la fille d’une des connaissances de son bienfaiteur. Il se tourna pour échanger un regard avec elle, comme c’était devenu leur coutume après des mois de contact quotidien. Leurs yeux se rencontrèrent, et soudain don Juan la vit comme un être lumineux – et puis il vit sa duplicité. Olinda était une femme double. Son bienfaiteur l’avait su depuis le début, et avait pris le chemin le plus difficile pour mettre don Juan en contact avec elle. Don Juan nous a avoué que le moment fut bouleversant pour lui.
Son bienfaiteur sut que don Juan avait vu. Sa mission de réunir les êtres doubles avait été accomplie avec succès et impeccablement. Il se leva, ses yeux balayèrent chaque coin de cette église, puis il sortit sans un regard en arrière. Il n’y avait plus rien pour lui à faire là-bas.
Don Juan dit que lorsque son bienfaiteur sortit au milieu de la messe, toutes les têtes se tournèrent. Don Juan voulut le suivre, mais Olinda lui serra audacieusement la main et le retint. Il sut alors que le pouvoir de voir n’avait pas été seulement le sien. Quelque chose les avait traversés tous les deux et ils étaient transis. Don Juan réalisa tout à coup que non seulement la messe était terminée, mais qu’ils étaient déjà hors de l’église. Son bienfaiteur essayait de calmer la mère d’Olinda, qui était furieuse et honteuse de leur manifestation d’affection inattendue et inadmissible.
Don Juan ne savait que faire ensuite. Il savait qu’il lui incombait de trouver un plan. Il avait les ressources, mais l’importance de l’événement lui fit perdre confiance en sa capacité. Il abandonna sa formation de traqueur et se perdit dans le dilemme intellectuel de traiter ou non Olinda comme une folie contrôlée.
Son bienfaiteur lui dit qu’il ne pouvait pas l’aider. Son devoir avait été seulement de les réunir, et c’est là que sa responsabilité s’arrêtait. C’était à don Juan de prendre les mesures nécessaires pour la sécuriser. Il suggéra que don Juan envisage même de l’épouser, si c’était ce qu’il fallait. Ce n’est qu’après qu’elle soit venue à lui de son plein gré qu’il pourrait aider don Juan en intervenant directement auprès d’elle en tant que Nagual.
Don Juan tenta une cour formelle. Il ne fut pas bien reçu par ses parents, qui ne pouvaient concevoir quelqu’un d’une classe sociale différente comme prétendant pour leur fille. Olinda n’était pas une Indienne ; sa famille était des citadins de la classe moyenne, propriétaires d’une petite entreprise. Le père avait d’autres projets pour sa fille. Il menaça de l’envoyer au loin si don Juan persistait dans son intention de l’épouser.
Don Juan dit que les êtres doubles, en particulier les femmes, sont extraordinairement conservateurs, voire timides. Olinda ne faisait pas exception. Après leur exaltation initiale à l’église, elle fut gagnée par la prudence, puis par la peur. Ses propres réactions l’effrayaient.
Comme manœuvre stratégique, son bienfaiteur fit battre en retraite don Juan, pour faire croire qu’il acquiesçait à son père, qui n’avait pas approuvé la fille – ce qui était la supposition de tous ceux qui avaient été témoins de l’incident à l’église. Les gens dirent que leur manifestation avait déplu si intensément à son père que celui-ci, qui était un catholique si dévot, n’était jamais retourné à l’église.
Son bienfaiteur dit à don Juan qu’un guerrier n’est jamais assiégé. Être assiégé implique que l’on a des possessions personnelles qui pourraient être bloquées. Un guerrier n’a rien au monde sauf son impeccabilité, et l’impeccabilité ne peut être menacée. Néanmoins, dans une bataille pour sa vie, comme celle que don Juan menait pour sécuriser la femme Nagual, un guerrier doit utiliser stratégiquement tous les moyens disponibles.
En conséquence, don Juan résolut d’utiliser toute partie de sa connaissance de traqueur qu’il devait, pour obtenir la fille. À cette fin, il engagea Silvio Manuel pour utiliser ses arts de sorcier, qui même à ce stade précoce étaient formidables, pour enlever la fille. Silvio Manuel et Genaro, qui était un véritable casse-cou, s’introduisirent dans la maison de la fille déguisés en vieilles lavandières. C’était le milieu de la journée et tout le monde dans la maison était occupé à préparer de la nourriture pour un grand groupe de parents et d’amis qui venaient dîner. Ils organisaient une fête de départ informelle pour Olinda. Silvio Manuel comptait sur la probabilité que les gens qui verraient deux lavandières étranges entrer avec des paquets de linge supposeraient que cela avait à voir avec la fête d’Olinda et ne deviendraient pas méfiants. Don Juan avait fourni à Silvio Manuel et Genaro au préalable toutes les informations dont ils avaient besoin concernant les routines des membres de la maisonnée. Il leur dit que les lavandières transportaient habituellement leurs paquets de linge lavé dans la maison et les laissaient dans une pièce de rangement pour être repassés. Portant un grand paquet de linge, Silvio Manuel et Genaro se rendirent directement dans cette pièce, sachant qu’Olinda y serait.
Don Juan dit que Silvio Manuel s’approcha d’Olinda et utilisa ses pouvoirs hypnotiques pour la faire s’évanouir. Ils la mirent dans un sac, enveloppèrent le sac avec ses draps de lit et sortirent, laissant derrière eux le paquet qu’ils avaient apporté. Ils tombèrent sur son père à la porte. Il ne leur jeta même pas un regard.
Le bienfaiteur de don Juan fut absolument contrarié par leur manœuvre. Il ordonna à don Juan de ramener immédiatement la fille chez elle. Il était impératif, dit-il, que la femme double vienne à la maison du bienfaiteur de son plein gré, peut-être pas avec l’idée de se joindre à eux mais au moins parce qu’ils l’intéressaient.
Don Juan sentit que tout était perdu – les chances de la ramener chez elle sans être remarqués étaient trop grandes – mais Silvio Manuel trouva une solution. Il proposa qu’ils laissent les quatre femmes du groupe de don Juan emmener la fille sur une route déserte, où don Juan la sauverait.
Silvio Manuel voulait que les femmes fassent semblant de la kidnapper. À un moment donné sur la route, quelqu’un les verrait et se lancerait à leur poursuite. Leur poursuivant les rattraperait et elles laisseraient tomber le sac, avec une certaine force pour être convaincantes. Le poursuivant serait, bien sûr, don Juan, qui se trouverait miraculeusement au bon endroit au bon moment.
Silvio Manuel exigeait une action fidèle à la réalité. Il ordonna aux femmes de bâillonner la fille, qui à ce moment-là serait sûrement réveillée et crierait à l’intérieur du sac, puis de courir sur des kilomètres en portant le sac. Il leur dit de se cacher de leur poursuivant. Finalement, après une épreuve vraiment épuisante, elles devaient laisser tomber le sac de manière à ce que la fille puisse assister à un combat des plus violents entre don Juan et les quatre femmes. Silvio Manuel dit aux femmes que cela devait être absolument réaliste. Il les arma de bâtons et leur ordonna de frapper don Juan de manière convaincante avant d’être chassées.
Parmi les femmes, Zoila était celle qui se laissait le plus facilement emporter par l’hystérie ; dès qu’elles commencèrent à frapper don Juan, elle fut possédée par son rôle et donna une performance glaçante, frappant don Juan si fort que la chair de son dos et de ses épaules fut arrachée. Pendant un moment, il sembla que les ravisseurs allaient gagner. Silvio Manuel dut sortir de sa cachette et, feignant d’être un passant, leur rappeler que ce n’était qu’un stratagème et qu’il était temps de s’enfuir.
Don Juan devint ainsi le sauveur et le protecteur d’Olinda. Il lui dit qu’il ne pouvait pas la ramener chez elle lui-même car il avait été blessé, mais qu’il la renverrait plutôt avec son père pieux.
Elle l’aida à marcher jusqu’à la maison de son bienfaiteur. Don Juan dit qu’il n’eut pas à feindre d’être blessé ; il saignait abondamment et arriva à peine à la porte. Quand Olinda raconta à son bienfaiteur ce qui s’était passé, le désir de rire de son bienfaiteur était si atroce qu’il dut le déguiser en pleurs.
Don Juan fit panser ses blessures puis alla se coucher. Olinda commença à lui expliquer pourquoi son père s’opposait à lui, mais elle ne termina pas. Le bienfaiteur de don Juan entra dans la pièce et lui dit qu’il était évident pour lui, en observant sa démarche, que les ravisseurs lui avaient blessé le dos. Il proposa de le lui remettre en place avant que cela ne devienne critique.
Olinda hésita. Le bienfaiteur de don Juan lui rappela que les ravisseurs n’avaient pas joué – ils avaient failli tuer son fils, après tout. Ce commentaire suffit ; elle vint aux côtés du bienfaiteur et le laissa lui donner un coup sec sur l’omoplate. Cela fit un bruit de craquement et Olinda entra dans un état de conscience accrue. Il lui dévoila la règle, et tout comme don Juan, elle l’accepta en totalité. Il n’y eut aucun doute, aucune hésitation.
La femme Nagual et don Juan trouvèrent la complétude et le silence en la compagnie de l’autre. Don Juan dit que le sentiment qu’ils avaient l’un pour l’autre n’avait rien à voir avec l’affection ou le besoin ; c’était plutôt un sens physique partagé qu’une barrière menaçante avait été brisée en eux, et qu’ils étaient un seul et même être.
Don Juan et sa femme Nagual, comme le prescrivait la règle, travaillèrent ensemble pendant des années pour trouver l’ensemble des quatre rêveuses, qui se révélèrent être Nelida, Zuleica, Cecilia et Hermelinda, et les trois courriers, Juan Tuma, Teresa et Marta. Les trouver fut une autre occasion où la nature pragmatique de la règle fut rendue claire à don Juan : tous étaient exactement ce que la règle disait qu’ils seraient. Leur avènement introduisit un nouveau cycle pour tout le monde, y compris le bienfaiteur de don Juan et son groupe. Pour don Juan et ses guerriers, cela signifiait le cycle du rêve, et pour son bienfaiteur et son groupe, cela signifiait une période d’impeccabilité inégalée dans leurs actes.
Son bienfaiteur expliqua à don Juan que lorsqu’il était jeune et qu’on lui présenta pour la première fois l’idée de la règle comme moyen de liberté, il avait été exalté, transi de joie. La liberté pour lui était une réalité imminente. Quand il en vint à comprendre la nature de la règle comme une carte, ses espoirs et son optimisme redoublèrent. Plus tard, la sobriété s’empara de sa vie ; plus il vieillissait, moins il voyait de chances de succès pour lui et son groupe. Finalement, il se convainquit que quoi qu’ils fassent, les chances étaient trop grandes contre leur conscience humaine ténue pour qu’elle puisse jamais s’envoler librement. Il fit la paix avec lui-même et son destin, et se rendit à l’échec. Il dit à l’Aigle depuis son for intérieur qu’il était heureux et fier d’avoir nourri sa conscience. L’Aigle était le bienvenu pour la prendre.
Don Juan nous dit que le même état d’esprit était partagé par tous les membres du groupe de son bienfaiteur. La liberté proposée dans la règle était quelque chose qu’ils considéraient comme inaccessible. Ils avaient eu des aperçus de la force anéantissante qu’est l’Aigle, et sentaient qu’ils n’avaient aucune chance contre elle. Tous s’étaient mis d’accord, néanmoins, qu’ils vivraient leur vie impeccablement pour nulle autre raison que d’être impeccables.
Don Juan dit que son bienfaiteur et son groupe, malgré leurs sentiments d’inadéquation, ou peut-être à cause de ces sentiments, trouvèrent leur liberté. Ils entrèrent dans la troisième attention – non pas en groupe, cependant, mais un par un. Le fait qu’ils aient trouvé le passage était la corroboration finale de la vérité contenue dans la règle. Le dernier à quitter le monde de la conscience de la vie quotidienne fut son bienfaiteur. Il se conforma à la règle et emmena la femme Nagual de don Juan avec lui. Alors qu’ils se dissolvaient tous les deux dans la conscience totale, don Juan et tous ses guerriers furent forcés d’exploser de l’intérieur – il ne put trouver d’autre moyen de décrire le sentiment impliqué dans le fait d’être forcé d’oublier tout ce qu’ils avaient vu du monde de leur bienfaiteur.
Celui qui n’oublia jamais fut Silvio Manuel. C’est lui qui engagea don Juan dans l’effort éreintant de rassembler les membres de leur groupe, qui avaient tous été dispersés. Il les plongea ensuite dans la tâche de trouver la totalité d’eux-mêmes. Il leur fallut des années pour accomplir ces deux tâches.
Don Juan avait longuement discuté du sujet de l’oubli, mais seulement en relation avec leur grande difficulté à se retrouver et à recommencer sans leur bienfaiteur. Il ne nous a jamais dit exactement ce que cela impliquait d’oublier ou d’atteindre la totalité de soi-même. À cet égard, il était fidèle aux enseignements de son bienfaiteur, nous aidant seulement à nous aider nous-mêmes.
À cet effet, il nous entraîna, la Gorda et moi, à voir ensemble et fut capable de nous montrer que, bien que les êtres humains apparaissent à un voyant comme des œufs lumineux, la forme ovoïde est un cocon externe, une coquille de luminosité qui abrite un noyau des plus intrigants, obsédants, hypnotiques, composé de cercles concentriques d’une luminosité jaunâtre, de la couleur de la flamme d’une bougie. Lors de notre dernière session, il nous fit voir des gens déambulant autour d’une église. C’était la fin de l’après-midi, presque la nuit, et pourtant les créatures à l’intérieur de leurs cocons rigides et lumineux irradiaient assez de lumière pour rendre tout ce qui les entourait d’une clarté cristalline. Le spectacle était merveilleux.
Don Juan expliqua que les coquilles en forme d’œuf qui nous semblaient si brillantes étaient en réalité ternes. La luminosité émanait du noyau brillant ; la coquille en fait ternissait son éclat. Don Juan nous révéla que la coquille doit être brisée pour libérer cet être. Elle doit être brisée de l’intérieur au bon moment, tout comme les créatures qui sortent des œufs brisent leur coquille. Si elles ne le font pas, elles étouffent et meurent. Comme pour les créatures qui sortent des œufs, il n’y a aucun moyen pour un guerrier de briser la coquille de sa luminosité avant que le moment ne soit venu.
Don Juan nous a dit que perdre la forme humaine était le seul moyen de briser cette coquille, le seul moyen de libérer ce noyau lumineux obsédant, le noyau de la conscience qui est la nourriture de l’Aigle. Briser la coquille signifie se souvenir de l’autre soi, et arriver à la totalité de soi-même.
Don Juan et ses guerriers arrivèrent à la totalité d’eux-mêmes, et se tournèrent alors vers leur dernière tâche, qui était de trouver une nouvelle paire d’êtres doubles. Don Juan dit qu’ils pensaient que ce serait une affaire simple – tout le reste avait été relativement facile pour eux. Ils n’avaient aucune idée que l’apparente facilité de leurs accomplissements en tant que guerriers était une conséquence de la maîtrise et du pouvoir personnel de leur bienfaiteur.
Leur quête d’une nouvelle paire d’êtres doubles fut infructueuse. Dans toutes leurs recherches, ils ne rencontrèrent jamais de femme double. Ils trouvèrent plusieurs hommes doubles, mais ils étaient tous bien situés, occupés, prolifiques et si satisfaits de leur vie qu’il aurait été inutile de les approcher. Ils n’avaient pas besoin de trouver un but dans la vie. Ils pensaient l’avoir déjà trouvé.
Don Juan dit qu’un jour il réalisa que lui et son groupe vieillissaient, et qu’il ne semblait y avoir aucun espoir de jamais accomplir leur tâche. Ce fut la première fois qu’ils ressentirent la morsure du désespoir et de l’impuissance.
Silvio Manuel insista sur le fait qu’ils devaient se résigner et vivre impeccablement sans espoir de trouver leur liberté. Il sembla plausible à don Juan que cela puisse en effet être la clé de tout. À cet égard, il se retrouva à suivre les traces de son bienfaiteur. Il en vint à accepter qu’un pessimisme insurmontable s’empare d’un guerrier à un certain point de son chemin. Un sentiment de défaite, ou peut-être plus précisément, un sentiment d’indignité, s’abat sur lui presque à son insu. Don Juan dit que, auparavant, il riait des doutes de son bienfaiteur et ne pouvait se résoudre à croire qu’il s’inquiétait sérieusement. Malgré les protestations et les avertissements de Silvio Manuel, don Juan avait pensé que tout cela n’était qu’un gigantesque stratagème destiné à leur enseigner quelque chose.
Comme il ne pouvait pas croire que les doutes de son bienfaiteur étaient réels, il ne pouvait pas non plus croire que la résolution de son bienfaiteur de vivre impeccablement sans espoir de liberté était authentique. Quand il comprit enfin que son bienfaiteur, en toute sincérité, s’était résigné à échouer, il lui vint aussi à l’esprit que la résolution d’un guerrier de vivre impeccablement malgré tout ne peut être abordée comme une stratégie pour assurer le succès. Don Juan et son groupe prouvèrent cette vérité par eux-mêmes lorsqu’ils réalisèrent en fait que les chances contre eux étaient stupéfiantes. Don Juan dit qu’à de tels moments, un entraînement de toute une vie prend le dessus, et le guerrier entre dans un état d’humilité inégalée ; lorsque la véritable pauvreté de ses ressources humaines devient indéniable, le guerrier n’a d’autre recours que de prendre du recul et de baisser la tête.
Don Juan s’émerveilla que cette prise de conscience ne semble avoir aucun effet sur les guerrières d’un groupe ; le désarroi semble les laisser impassibles. Il nous dit qu’il avait noté cela dans le groupe de son bienfaiteur : les femmes n’étaient jamais aussi inquiètes et moroses quant à leur sort que les hommes. Elles semblaient simplement acquiescer au jugement du bienfaiteur de don Juan et le suivre sans montrer de signes d’usure émotionnelle. Si les femmes étaient contrariées à un certain niveau, elles y étaient indifférentes. Être occupées était tout ce qui comptait pour elles. C’était comme si seuls les hommes avaient aspiré à la liberté et ressenti l’impact d’une contre-offre.
Dans son propre groupe, don Juan observa le même contraste. Les femmes furent promptement d’accord avec lui quand il dit que ses ressources étaient inadéquates. Il ne pouvait que conclure que les femmes, bien qu’elles ne l’aient jamais mentionné, n’avaient jamais cru avoir de ressources au départ. Il n’y avait par conséquent aucun moyen qu’elles puissent se sentir déçues ou découragées en découvrant qu’elles étaient impuissantes : elles l’avaient toujours su.
Don Juan nous dit que la raison pour laquelle l’Aigle exigeait deux fois plus de guerrières que de guerriers était précisément parce que les femmes ont un équilibre inhérent qui manque aux hommes. Au moment crucial, ce sont les hommes qui deviennent hystériques et se suicident s’ils jugent que tout est perdu. Une femme peut se suicider par manque de direction et de but, mais pas à cause de l’échec d’un système auquel elle se trouve appartenir.
Après que don Juan et son groupe de guerriers eurent perdu espoir – ou plutôt, comme le dit don Juan, après que lui et les guerriers masculins eurent touché le fond et que les femmes eurent trouvé des moyens appropriés pour les amuser – don Juan tomba finalement sur un homme double qu’il pouvait approcher. J’étais cet homme double. Il dit que puisque personne de sain d’esprit ne se porterait volontaire pour un projet aussi absurde qu’une lutte pour la liberté, il devait suivre les enseignements de son bienfaiteur et, dans le plus pur style de traqueur, m’attirer comme il avait attiré les membres de son propre groupe. Il avait besoin de m’avoir seul à un endroit où il pourrait appliquer une pression physique sur mon corps, et il était nécessaire que j’y aille de mon plein gré. Il m’attira dans sa maison avec une grande facilité – comme il le dit, sécuriser l’homme double n’est jamais un grand problème. La difficulté est d’en trouver un qui soit disponible.
Cette première visite à sa maison fut, du point de vue de ma conscience quotidienne, une séance sans histoire. Don Juan était charmant et plaisantait avec moi. Il orienta la conversation vers la fatigue que le corps ressent après de longs trajets, un sujet qui me semblait tout à fait sans conséquence, en tant qu’étudiant en anthropologie. Puis il fit le commentaire désinvolte que mon dos semblait être désaligné, et sans un mot de plus, il posa une main sur ma poitrine, me redressa et me donna une bonne tape dans le dos. Il me prit si au dépourvu que je perdis connaissance. Quand je rouvris les yeux, j’eus l’impression qu’il m’avait brisé la colonne vertébrale, mais je savais que j’étais différent. J’étais quelqu’un d’autre et non le moi que je connaissais. À partir de ce moment, chaque fois que je le voyais, il me faisait passer de ma conscience du côté droit à ma gauche, puis il me révélait la règle.
Presque immédiatement après m’avoir trouvé, don Juan rencontra une femme double. Il ne me mit pas en contact avec elle par un stratagème, comme son bienfaiteur l’avait fait avec lui, mais il conçut un plan, aussi efficace et élaboré que n’importe lequel de ceux de son bienfaiteur, par lequel il attira et sécurisa lui-même la femme double. Il assuma ce fardeau car il croyait que c’était le devoir du bienfaiteur de sécuriser les deux êtres doubles immédiatement après les avoir trouvés, puis de les réunir en tant que partenaires dans une entreprise inconcevable.
Il me raconta qu’un jour, alors qu’il vivait en Arizona, il était allé à un bureau du gouvernement pour remplir un formulaire. La dame au bureau lui dit de le porter à un employé de la section adjacente, et sans regarder, elle pointa vers sa gauche. Don Juan suivit la direction de son bras tendu et vit une femme double assise à un bureau. Quand il lui apporta son formulaire, il réalisa qu’elle n’était qu’une jeune fille. Elle lui dit qu’elle n’avait rien à voir avec les formulaires. Néanmoins, par sympathie pour un pauvre vieil Indien, elle prit le temps de l’aider à le traiter.
Certains documents légaux étaient nécessaires, documents que don Juan avait dans sa poche, mais il feignit une ignorance et une impuissance totales. Il fit croire que l’organisation bureaucratique était une énigme pour lui. Il n’était pas difficile du tout de dépeindre une absence totale d’esprit, dit don Juan ; tout ce qu’il avait à faire était de revenir à ce qui avait été autrefois son état de conscience normal. Son but était de prolonger son interaction avec la fille aussi longtemps que possible. Son mentor lui avait dit, et il l’avait lui-même vérifié dans ses recherches, que les femmes doubles sont assez rares. Son mentor l’avait également averti qu’elles ont des ressources intérieures qui les rendent très volatiles. Don Juan craignait que si il ne jouait pas ses cartes expertement, elle ne parte. Il joua sur sa sympathie pour gagner du temps. Il créa un délai supplémentaire en prétendant que les documents légaux étaient perdus. Presque chaque jour, il lui en apportait un différent. Elle le lisait et lui disait avec regret que ce n’était pas le bon. La fille était si touchée par sa triste condition qu’elle se proposa même de payer un avocat pour lui rédiger une déclaration sous serment à la place des papiers.
Après trois mois de cela, don Juan pensa qu’il était temps de produire les documents. À ce moment-là, elle s’était habituée à lui et s’attendait presque à le voir tous les jours. Don Juan vint une dernière fois pour exprimer ses remerciements et dire au revoir. Il lui dit qu’il aurait aimé lui apporter un cadeau pour montrer sa reconnaissance, mais qu’il n’avait même pas d’argent pour manger. Elle fut émue par sa franchise et l’emmena déjeuner. Pendant qu’ils mangeaient, il songea qu’un cadeau n’a pas nécessairement à être un objet que l’on achète. Cela pourrait être quelque chose qui n’est que pour les yeux de celui qui le regarde. Quelque chose à se souvenir plutôt qu’à posséder.
Elle fut intriguée par ses paroles. Don Juan lui rappela qu’elle avait exprimé de la compassion pour les Indiens et leur condition de pauvres. Il lui demanda si elle aimerait voir les Indiens sous un jour différent – non pas comme des pauvres mais comme des artistes. Il lui dit qu’il connaissait un vieil homme qui était le dernier de sa lignée de danseurs de pouvoir. Il l’assura que l’homme danserait pour elle à sa demande ; et de plus, il lui promit que jamais dans sa vie elle n’avait vu quelque chose de semblable ni ne le verrait jamais plus. C’était quelque chose que seuls les Indiens voyaient.
Elle fut ravie de l’idée. Elle le récupéra après son travail, et ils se dirigèrent vers les collines où il lui dit que l’Indien vivait. Don Juan l’emmena chez lui. Il lui fit arrêter la voiture à une certaine distance, et ils commencèrent à marcher le reste du chemin. Avant d’atteindre la maison, il s’arrêta et traça une ligne avec son pied dans la terre sablonneuse et sèche. Il lui dit que la ligne était une frontière et la persuada de la franchir.
La femme Nagual elle-même m’a dit que jusqu’à ce point, elle avait été très intriguée par la possibilité d’assister à une véritable danse indienne, mais quand le vieil Indien a tracé une ligne dans la terre et l’a appelée une frontière, elle a commencé à hésiter. Puis elle est devenue carrément alarmée quand il lui a dit que la frontière était pour elle seule, et qu’une fois qu’elle l’aurait franchie, il n’y aurait aucun moyen de revenir.
L’Indien vit apparemment sa consternation et tenta de la rassurer. Il lui tapota poliment le bras et lui donna sa garantie qu’aucun mal ne lui arriverait tant qu’il serait là. La frontière pouvait s’expliquer, lui dit-il, comme une forme de paiement symbolique au danseur, car il ne voulait pas d’argent. Le rituel tenait lieu d’argent, et le rituel exigeait qu’elle franchisse la frontière de son plein gré.
Le vieil Indien franchit joyeusement la ligne et lui dit que pour lui, tout cela n’était que pure absurdité indienne, mais que le danseur, qui les observait de l’intérieur de la maison, devait être amadoué si elle voulait le voir danser.
La femme Nagual dit qu’elle eut soudain si peur qu’elle ne put bouger pour franchir la ligne. Le vieil Indien fit un effort pour la persuader, disant que franchir cette frontière était bénéfique pour tout le corps. La franchir ne l’avait pas seulement fait se sentir plus jeune, cela l’avait en fait rendu plus jeune, tel était le pouvoir de cette frontière. Pour prouver son propos, il la retraversa et immédiatement ses épaules s’affaissèrent, les coins de sa bouche tombèrent, ses yeux perdirent leur éclat. La femme Nagual ne pouvait nier les différences que les traversées avaient faites.
Don Juan retraversa la ligne une troisième fois. Il respira profondément, bombant le torse, ses mouvements vifs et audacieux. La femme Nagual dit que l’idée lui traversa l’esprit qu’il pourrait même lui faire des avances sexuelles. Sa voiture était trop loin pour qu’elle puisse s’enfuir. La seule chose qu’elle pouvait faire était de se dire qu’il était stupide de craindre ce vieil Indien.
Alors le vieil homme fit un autre appel à sa raison et à son sens de l’humour. D’un ton conspirateur, comme s’il révélait un secret avec une certaine réticence, il lui dit qu’il faisait juste semblant d’être jeune pour plaire au danseur, et que si elle ne l’aidait pas en franchissant la ligne, il allait s’évanouir à tout moment à cause du stress de marcher sans se voûter. Il marcha d’avant en arrière à travers la ligne pour lui montrer l’immense effort que sa pantomime impliquait.
La femme Nagual dit que ses yeux suppliants révélaient la douleur que son vieux corps endurait pour imiter la jeunesse. Elle franchit la ligne pour l’aider et en finir ; elle voulait rentrer chez elle.
Au moment où elle franchit la ligne, don Juan fit un saut prodigieux et plana au-dessus du toit de la maison. La femme Nagual dit qu’il vola comme un énorme boomerang. Quand il atterrit à côté d’elle, elle tomba sur le dos. Sa frayeur dépassait tout ce qu’elle avait jamais connu, mais son excitation d’avoir été témoin d’une telle merveille aussi. Elle ne demanda même pas comment il avait accompli un exploit aussi magnifique. Elle voulait courir jusqu’à sa voiture et rentrer chez elle.
Le vieil homme l’aida à se relever et s’excusa de l’avoir trompée. En fait, dit-il, il était lui-même le danseur et son vol au-dessus de la maison avait été sa danse. Il lui demanda si elle avait prêté attention à la direction de son vol. La femme Nagual fit un cercle avec sa main dans le sens antihoraire. Il lui tapota paternellement la tête et lui dit qu’il était très auspicieux qu’elle ait été attentive. Puis il dit qu’elle avait peut-être blessé son dos dans sa chute, et qu’il ne pouvait pas la laisser partir sans s’assurer qu’elle allait bien. Audacieusement, il redressa ses épaules et souleva son menton et l’arrière de sa tête, comme s’il la dirigeait pour étirer sa colonne vertébrale. Il lui donna ensuite une bonne claque entre les omoplates, lui coupant littéralement le souffle. Pendant un moment, elle fut incapable de respirer et s’évanouit.
Quand elle reprit conscience, elle était à l’intérieur de sa maison. Son nez saignait, ses oreilles bourdonnaient, sa respiration était accélérée, elle ne pouvait pas focaliser ses yeux. Il lui ordonna de prendre de profondes inspirations en comptant jusqu’à huit. Plus elle respirait, plus tout devenait clair. À un moment donné, me dit-elle, toute la pièce devint incandescente ; tout brillait d’une lumière ambrée. Elle devint stupéfaite et ne put plus respirer profondément. La lumière ambrée était alors si épaisse qu’elle ressemblait à du brouillard. Puis le brouillard se transforma en toiles d’araignée ambrées. Il se dissipa finalement, mais le monde resta uniformément ambré pendant un certain temps encore.
Don Juan commença alors à lui parler. Il l’emmena à l’extérieur de la maison et lui montra que le monde était divisé en deux moitiés. Le côté gauche était clair mais le côté droit était voilé d’un brouillard ambré. Il lui dit qu’il est monstrueux de penser que le monde est compréhensible ou que nous-mêmes sommes compréhensibles. Il dit que ce qu’elle percevait était une énigme, un mystère que l’on ne pouvait qu’accepter avec humilité et admiration.
Il lui révéla alors la règle. Sa clarté d’esprit était si intense qu’elle comprit tout ce qu’il disait. La règle lui parut appropriée et évidente.
Il lui expliqua que les deux côtés d’un être humain sont totalement séparés et qu’il faut une grande discipline et une grande détermination pour briser ce sceau et passer d’un côté à l’autre. Un être double a un grand avantage : la condition d’être double permet un mouvement relativement facile entre les compartiments du côté droit. Le grand inconvénient des êtres doubles est qu’en vertu d’avoir deux compartiments, ils sont sédentaires, conservateurs, effrayés par le changement.
Don Juan lui dit que son intention avait été de la faire passer de son compartiment extrême droit à son côté gauche-droit plus lucide et plus net, mais au lieu de cela, par une bizarrerie inexplicable, son coup l’avait projetée à travers toute sa duplicité, de son côté extrême droit de tous les jours à son côté extrême gauche. Il essaya quatre fois de la faire revenir à un état de conscience normal, mais en vain. Ses coups l’aidèrent cependant à activer et désactiver sa perception du mur de brouillard à volonté. Bien qu’il ne l’eût pas voulu, don Juan avait eu raison de dire que la ligne était une frontière à sens unique pour elle. Une fois qu’elle l’eut franchie, tout comme Silvio Manuel, elle ne revint jamais.
Quand don Juan nous mit, la femme Nagual et moi, face à face, aucun de nous ne connaissait l’existence de l’autre, et pourtant nous sentîmes instantanément que nous nous étions familiers. Don Juan savait par sa propre expérience que le réconfort que les êtres doubles ressentent en la compagnie de l’autre est indescriptible, et bien trop bref. Il nous dit que nous avions été réunis par des forces incompréhensibles à notre raison, et que la seule chose que nous n’avions pas était le temps. Chaque minute pouvait être la dernière ; par conséquent, elle devait être vécue avec l’esprit.
Une fois que don Juan nous eut réunis, tout ce qu’il restait à faire pour lui et ses guerriers était de trouver quatre traqueuses, trois guerriers masculins et un courrier masculin pour composer notre groupe. À cette fin, don Juan trouva Lydia, Josefina, la Gorda, Rosa, Benigno, Nestor, Pablito et le courrier Eligio. Chacun d’eux était une réplique sous une forme non développée des membres du propre groupe de don Juan.
(Carlos Castaneda, Le Don de l’Aigle)