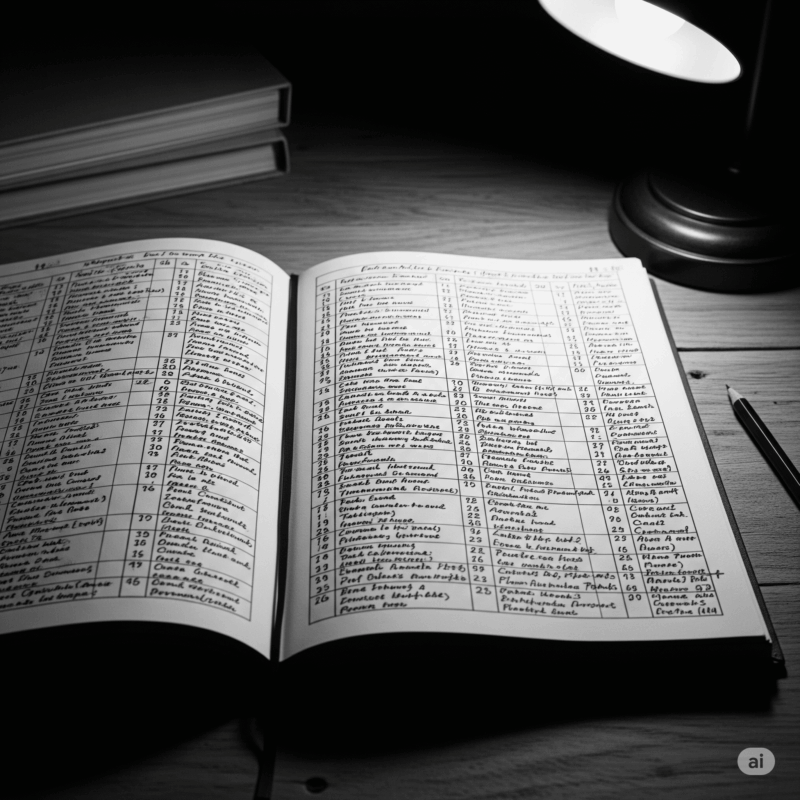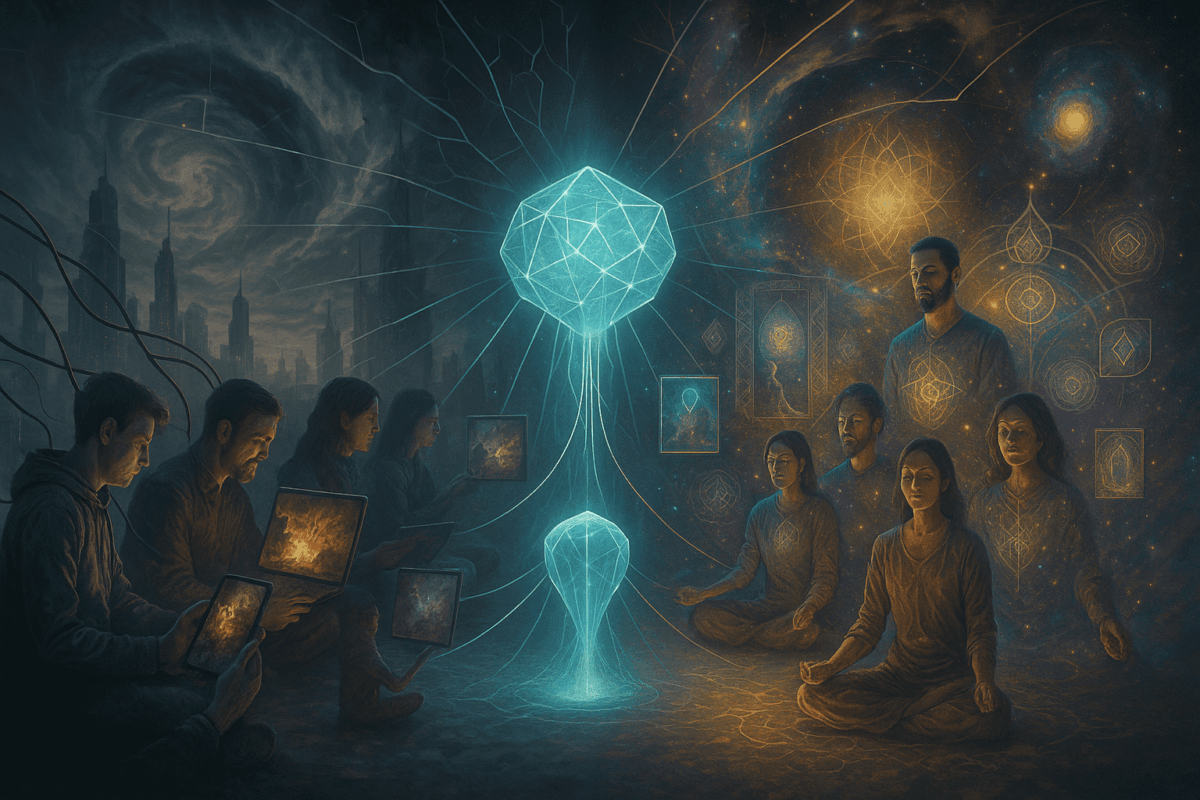La Gorda et moi étions en accord total sur le fait qu’au moment où Zuleica nous avait enseigné les subtilités du rêve, nous avions accepté le fait indéniable que la règle est une carte, qu’il y a une autre conscience cachée en nous, et qu’il est possible d’entrer dans cette conscience. Don Juan avait accompli ce que la règle prescrivait.
La règle déterminait que son prochain mouvement était de me présenter à Florinda, la seule de ses guerrières que je n’avais pas rencontrée. Don Juan me dit que je devais me rendre seul chez elle, car ce qui se passerait entre Florinda et moi ne concernait personne d’autre. Il dit que Florinda devait être mon guide personnel, exactement comme si j’étais un Nagual comme lui. Il avait eu ce genre de relation avec la guerrière du groupe de son bienfaiteur qui était comparable à Florinda.
Don Juan me laissa un jour à la porte de la maison de Nelida. Il me dit d’entrer, que Florinda m’attendait à l’intérieur.
« C’est un honneur de faire votre connaissance », dis-je à la femme qui me faisait face dans le couloir.
« Je suis Florinda », dit-elle.
Nous nous regardâmes en silence. J’étais émerveillé. Mon état de conscience était aussi aiguisé qu’il ne l’avait jamais été. Jamais plus je n’ai ressenti une sensation comparable.
« C’est un beau nom », réussis-je à dire, mais je voulais dire bien plus que cela.
L’énonciation douce et longue des voyelles espagnoles rendait le nom fluide et sonore ; surtout le ‘i’ après le ‘r’. Le nom n’était pas rare ; je n’avais simplement jamais rencontré personne, jusqu’à ce jour, qui fût l’essence de ce nom. La femme en face de moi s’y intégrait comme s’il avait été fait pour elle, ou peut-être comme si elle-même avait fait en sorte que sa personne s’y adapte.
Physiquement, elle ressemblait exactement à Nelida, sauf qu’elle paraissait plus sûre d’elle, plus puissante. Elle était plutôt grande et mince. Elle avait la peau olivâtre des peuples méditerranéens. Espagnole, ou peut-être française. Elle était âgée et pourtant elle n’était ni faible ni même vieille. Son corps semblait souple et mince. De longues jambes, des traits anguleux, une petite bouche, un nez magnifiquement ciselé, des yeux sombres et des cheveux blancs tressés. Pas de bajoues, pas de peau affaissée sur son visage et son cou. Elle était vieille comme si on l’avait maquillée pour paraître vieille.
En me souvenant, rétrospectivement, de ma première rencontre avec elle, je me rappelle quelque chose de tout à fait sans rapport mais à propos. J’ai vu une fois dans un hebdomadaire la reproduction d’une photographie vieille de vingt ans d’une actrice hollywoodienne alors jeune qui avait été maquillée pour paraître vingt ans de plus afin de jouer le rôle d’une femme vieillissante. À côté, le journal avait imprimé une photo actuelle de la même actrice telle qu’elle était après vingt années réelles de vie difficile. Florinda, à mon jugement subjectif, était comme la première photo de l’actrice de cinéma, une jeune fille maquillée pour paraître vieille.
« Qu’avons-nous là ? » dit-elle en me pinçant. « Tu n’as pas l’air de grand-chose. Mou. Complaisant jusqu’à la moelle sans aucun doute. »
Sa franchise me rappela celle de don Juan ; de même que la vie intérieure de ses yeux. Il m’était venu à l’esprit, en repensant à ma vie avec don Juan, que ses yeux étaient toujours en repos. On ne voyait aucune agitation en eux. Ce n’était pas que les yeux de don Juan fussent beaux à regarder. J’ai vu des yeux magnifiques, mais je n’ai jamais trouvé qu’ils disaient quoi que ce soit. Les yeux de Florinda, comme ceux de don Juan, me donnaient le sentiment qu’ils avaient été témoins de tout ce qu’il y a à voir ; ils étaient calmes, mais pas fades. L’excitation avait été refoulée à l’intérieur et s’était transformée en quelque chose que je ne pouvais décrire que comme une vie intérieure.
Florinda me fit traverser le salon et sortir sur un patio couvert. Nous nous assîmes sur des fauteuils confortables ressemblant à des canapés. Ses yeux semblaient chercher quelque chose sur mon visage.
« Sais-tu qui je suis et ce que je suis censée faire pour toi ? » demanda-t-elle.
Je dis que tout ce que je savais d’elle et de sa relation avec moi était ce que don Juan avait esquissé. Au cours de l’explication de ma position, je l’appelai doña Florinda.
« Ne m’appelle pas doña Florinda », dit-elle avec un geste enfantin d’agacement et d’embarras. « Je ne suis pas encore si vieille, ni même si respectable. »
Je lui demandai comment elle s’attendait à ce que je m’adresse à elle.
« Juste Florinda suffira », dit-elle. « Pour ce qui est de qui je suis, je peux te dire tout de suite que je suis une guerrière qui connaît les secrets de la traque. Et pour ce qui est de ce que je suis censée faire pour toi, je peux te dire que je vais t’enseigner les sept premiers principes de la traque, les trois premiers principes de la règle pour les traqueurs, et les trois premières manœuvres de la traque. »
Elle ajouta que la chose normale était que chaque guerrier oublie ce qui se passe lorsque l’interaction se fait du côté gauche, et qu’il me faudrait des années pour me familiariser avec tout ce qu’elle allait m’enseigner. Elle dit que son instruction n’était que le commencement, et qu’un jour elle finirait de m’enseigner, mais dans des circonstances différentes. Je lui demandai si cela la dérangeait que je lui pose des questions. « Fais comme tu veux », dit-elle. « Tout ce dont j’ai besoin de ta part, c’est ton engagement à pratiquer. Après tout, tu sais d’une manière ou d’une autre tout ce dont nous allons discuter. Tes défauts sont que tu n’as pas confiance en toi et que tu ne veux pas revendiquer ta connaissance comme un pouvoir. Le Nagual, étant un homme, t’a hypnotisé. Tu ne peux pas agir par toi-même. Seule une femme peut te libérer de cela.
« Je commencerai par te raconter l’histoire de ma vie, et ce faisant, les choses deviendront claires pour toi. Je devrai te la raconter par bribes, donc tu devras venir ici assez souvent. »
Sa volonté apparente de me raconter sa vie me parut en contradiction avec la réticence de tous les autres à révéler quoi que ce soit de personnel sur eux-mêmes. Après des années avec eux, j’avais accepté leurs manières si inconditionnellement que son intention volontaire de révéler sa vie personnelle me parut excentrique. Sa déclaration me mit immédiatement sur mes gardes.
« Je vous demande pardon », dis-je. « Avez-vous dit que vous alliez me révéler votre vie personnelle ? »
« Pourquoi pas ? » demanda-t-elle.
Je lui répondis par une longue explication de ce que don Juan m’avait dit sur la force encombrante de l’histoire personnelle, et la nécessité pour un guerrier de l’effacer. Je conclus en lui disant qu’il m’avait interdit de jamais parler de ma vie.
Elle rit d’une voix aiguë de fausset. Elle semblait ravie.
« Cela ne s’applique qu’aux hommes », dit-elle. « Le non-agir de ta vie personnelle est de raconter des histoires sans fin, mais pas une seule sur ton vrai moi. Tu vois, être un homme signifie que tu as une histoire solide derrière toi. Tu as une famille, des amis, des connaissances, et chacun d’eux a une idée précise de toi. Être un homme signifie que tu es responsable. Tu ne peux pas disparaître si facilement. Pour t’effacer, tu as eu besoin de beaucoup de travail.
« Mon cas est différent. Je suis une femme et cela me donne un avantage splendide. Je ne suis pas responsable. Ne sais-tu pas que les femmes ne sont pas responsables ? »
« Je ne sais pas ce que vous voulez dire par responsable », dis-je.
« Je veux dire qu’une femme peut facilement disparaître », répondit-elle. « Une femme peut, à défaut d’autre chose, se marier. Une femme appartient à son mari. Dans une famille avec beaucoup d’enfants, les filles sont écartées très tôt. Personne ne compte sur elles et il y a des chances que certaines disparaissent sans laisser de trace. Leur disparition est facilement acceptée.
« Un fils, en revanche, est quelque chose sur quoi on compte. Ce n’est pas si facile pour un fils de s’esquiver et de disparaître. Et même s’il le fait, il laissera des traces derrière lui. Un fils se sent coupable de disparaître. Une fille non.
« Quand le Nagual t’a entraîné à te taire sur ta vie personnelle, il voulait t’aider à surmonter ton sentiment d’avoir mal agi envers ta famille et tes amis qui comptaient sur toi d’une manière ou d’une autre.
« Après une lutte de toute une vie, le guerrier masculin finit, bien sûr, par s’effacer, mais cette lutte a un coût pour l’homme. Il devient secret, toujours sur ses gardes contre lui-même. Une femme n’a pas à affronter cette épreuve. Une femme est déjà prête à se désintégrer dans les airs. En fait, c’est ce qu’on attend d’elle.
« Étant une femme, je ne suis pas contrainte au secret. Je m’en fiche éperdument. Le secret est le prix que vous, les hommes, devez payer pour être importants pour la société. La lutte n’est que pour les hommes, parce qu’ils répugnent à s’effacer et trouveraient des moyens curieux de réapparaître quelque part, d’une manière ou d’une autre. Prends ton cas par exemple ; tu donnes des conférences. »
Florinda me rendait nerveux d’une manière très particulière. Je me sentais étrangement agité en sa présence. J’admettrais sans hésiter que don Juan et Silvio Manuel me rendaient aussi nerveux et appréhensif, mais c’était un sentiment différent. J’avais réellement peur d’eux, surtout de Silvio Manuel. Il me terrifiait et pourtant j’avais appris à vivre avec ma terreur. Florinda ne m’effrayait pas. Ma nervosité était plutôt le résultat d’être agacé, menacé par son savoir-faire.
Elle ne me fixait pas comme le faisaient don Juan ou Silvio Manuel. Ils fixaient toujours leurs yeux sur moi jusqu’à ce que je détourne le visage dans un geste de soumission. Florinda ne faisait que me jeter des regards. Ses yeux passaient continuellement d’une chose à l’autre. Elle semblait examiner non seulement mes yeux, mais chaque centimètre de mon visage et de mon corps. Pendant qu’elle parlait, elle passait par de rapides regards de mon visage à mes mains, ou à ses pieds, ou au toit.
« Je te mets mal à l’aise, n’est-ce pas ? » demanda-t-elle.
Sa question me prit complètement au dépourvu. Je ris. Son ton n’était pas du tout menaçant.
« En effet », dis-je.
« Oh, c’est parfaitement compréhensible », continua-t-elle. « Tu as l’habitude d’être un homme. Une femme pour toi est quelque chose fait pour ton bénéfice. Une femme est stupide pour toi. Et le fait que tu sois un homme et le Nagual rend les choses encore plus difficiles. »
Je me sentis obligé de me défendre. Je pensais qu’elle était une dame très dogmatique et je voulais le lui dire. Je commençai en grande forme mais je m’épuisai presque immédiatement en entendant son rire. C’était un rire joyeux et jeune. Don Juan et don Genaro se moquaient de moi tout le temps et leur rire était aussi jeune, mais celui de Florinda avait une vibration différente. Il n’y avait pas de hâte dans son rire, pas de pression.
« Je pense que nous ferions mieux d’entrer », dit-elle. « Il ne devrait y avoir aucune distraction. Le Nagual Juan Matus t’a déjà fait visiter, te montrant le monde ; c’était important pour ce qu’il avait à te dire. J’ai d’autres choses à dire, qui nécessitent un autre cadre. »
Nous nous assîmes sur un canapé en cuir dans un bureau attenant au patio. Je me sentis plus à l’aise à l’intérieur. Elle se lança directement dans l’histoire de sa vie.
Elle dit qu’elle était née dans une ville mexicaine assez grande, dans une famille aisée. Comme elle était enfant unique, ses parents la gâtèrent dès sa naissance. Sans la moindre trace de fausse modestie, Florinda admit qu’elle avait toujours été consciente d’être belle. Elle dit que la beauté est un démon qui se reproduit et prolifère lorsqu’on l’admire. Elle m’assura qu’elle pouvait dire sans l’ombre d’un doute que ce démon est le plus difficile à vaincre, et que si je regardais autour de moi pour trouver ceux qui sont beaux, je trouverais les êtres les plus misérables imaginables.
Je ne voulais pas discuter avec elle, mais j’avais le désir le plus intense de lui dire qu’elle était en quelque sorte dogmatique. Elle a dû percevoir mes sentiments ; elle me fit un clin d’œil.
« Ils sont misérables, tu ferais mieux de le croire », continua-t-elle. « Essaie-les. Refuse de souscrire à leur idée qu’ils sont beaux, et à cause de cela, importants. Tu verras ce que je veux dire. »
Elle dit qu’elle pouvait difficilement blâmer entièrement ses parents ou elle-même pour sa vanité. Tout le monde autour d’elle avait conspiré dès son enfance pour la faire se sentir importante et unique.
« Quand j’avais quinze ans », continua-t-elle, « je pensais être la plus grande chose qui soit jamais venue sur terre. Tout le monde le disait, surtout les hommes. »
Elle avoua que pendant son adolescence, elle se complut dans l’attention et l’adulation de nombreux admirateurs. À dix-huit ans, elle choisit judicieusement le meilleur mari possible parmi pas moins de onze prétendants sérieux. Elle épousa Celestino, un homme aisé, de quinze ans son aîné.
Florinda décrivit sa vie conjugale comme le paradis sur terre. Au cercle énorme d’amis qu’elle avait déjà, elle ajouta les amis de Celestino. L’effet total fut celui d’une fête perpétuelle.
Son bonheur, cependant, ne dura que six mois, qui passèrent presque inaperçus. Tout s’arrêta de la manière la plus abrupte et brutale, lorsqu’elle contracta une maladie mystérieuse et invalidante. Son pied, sa cheville et son mollet gauches commencèrent à enfler. La ligne de sa belle jambe fut ruinée ; l’enflure devint si intense que les tissus cutanés commencèrent à former des cloques et à éclater. Toute sa jambe inférieure, du genou vers le bas, devint le siège de croûtes et d’une sécrétion pestilentielle. La peau devint dure. La maladie fut diagnostiquée comme une éléphantiasis. Les tentatives des médecins pour guérir son état furent maladroites et douloureuses, et leur conclusion finale fut que seuls en Europe il y avait des centres médicaux suffisamment avancés pour entreprendre éventuellement une cure.
En l’espace de trois mois, le paradis de Florinda s’était transformé en enfer sur terre. Désespérée et en véritable agonie, elle préférait mourir plutôt que de continuer. Sa souffrance était si pathétique qu’un jour une servante, ne pouvant plus la supporter, lui avoua qu’elle avait été soudoyée par l’ancienne maîtresse de Celestino pour glisser une certaine concoction dans sa nourriture – un poison fabriqué par des sorciers. La servante, en acte de contrition, promit de l’emmener chez une guérisseuse, une femme réputée être la seule personne capable de contrecarrer un tel poison.
Florinda gloussa, se souvenant de son dilemme. Elle avait été élevée en fervente catholique. Elle ne croyait pas à la sorcellerie ni aux guérisseurs indiens. Mais sa douleur était si intense et son état si grave qu’elle était prête à tout essayer. Celestino s’y opposait farouchement. Il voulait livrer la servante aux autorités. Florinda intercéda, moins par compassion que par crainte de ne pas trouver la guérisseuse par elle-même.
Florinda se leva soudainement. Elle me dit que je devais partir. Elle me tint le bras et me raccompagna à la porte comme si j’avais été son plus vieil et plus cher ami. Elle expliqua que j’étais épuisé, car être dans la conscience du côté gauche est une condition spéciale et fragile qui doit être utilisée avec parcimonie. Ce n’est certainement pas un état de pouvoir. La preuve était que j’avais failli mourir lorsque Silvio Manuel avait essayé de rallier ma seconde attention en me forçant à y entrer hardiment. Elle dit qu’il n’y a aucun moyen sur terre de commander à quiconque ou à nous-mêmes de rallier la connaissance. C’est plutôt une affaire lente ; le corps, au bon moment et dans les circonstances appropriées d’impeccabilité, rallie sa connaissance sans l’intervention du désir.
Nous sommes restés un moment à la porte d’entrée, échangeant des remarques aimables et des banalités. Elle a soudainement dit que la raison pour laquelle le Nagual Juan Matus m’avait amenée à elle ce jour-là était parce qu’il savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Les deux formes d’instruction que j’avais reçues, selon le plan directeur de Silvio Manuel, étaient déjà terminées. Tout ce qui restait en suspens était ce qu’elle avait à me dire. Elle a souligné que la sienne n’était pas une instruction à proprement parler, mais plutôt l’établissement de mon lien avec elle.
La fois suivante où don Juan m’emmena voir Florinda, juste avant de me laisser à la porte, il répéta ce qu’elle m’avait dit, que le moment approchait pour lui et son groupe d’entrer dans la troisième attention. Avant que je puisse le questionner, il me poussa à l’intérieur de la maison. Sa poussée m’envoya non seulement dans la maison, mais dans mon état de conscience le plus aigu. Je vis le mur de brouillard.
Florinda se tenait dans le couloir, comme si elle avait attendu que don Juan me pousse à l’intérieur. Elle me prit le bras et me conduisit tranquillement au salon. Nous nous assîmes. Je voulais entamer une conversation mais je ne pouvais pas parler. Elle expliqua qu’une poussée d’un guerrier impeccable, comme le Nagual Juan Matus, peut provoquer un passage vers une autre zone de conscience. Elle dit que mon erreur depuis le début avait été de croire que les procédures sont importantes. La procédure de pousser un guerrier dans un autre état de conscience n’est utilisable que si les deux participants, en particulier celui qui pousse, sont impeccables et imprégnés de pouvoir personnel.
Le fait que je voyais le mur de brouillard me rendait extrêmement nerveux, sur un plan physique. Mon corps tremblait de manière incontrôlable. Florinda dit que mon corps tremblait parce qu’il avait appris à désirer l’activité tout en restant dans cet état de conscience, et que mon corps pouvait aussi apprendre à concentrer son attention la plus vive sur ce qui était dit, plutôt que sur ce qui était fait.
Elle me dit alors qu’être placé dans la conscience du côté gauche était un expédient. En me forçant à entrer dans un état de conscience accrue et en me permettant d’interagir avec ses guerriers uniquement lorsque j’étais dans cet état, le Nagual Juan Matus s’assurait que j’aurais un rebord sur lequel me tenir. Florinda dit que sa stratégie était de cultiver une petite partie de l’autre moi en le remplissant délibérément de souvenirs d’interaction. Les souvenirs ne sont oubliés que pour refaire surface un jour afin de servir de poste avancé rationnel d’où partir vers l’immensité incommensurable de l’autre moi.
Parce que j’étais si nerveux, elle proposa de me calmer en poursuivant l’histoire de sa vie, qui, précisa-t-elle, n’était pas vraiment l’histoire de sa vie en tant que femme dans le monde, mais l’histoire de la façon dont une femme minable fut aidée à devenir une guerrière.
Elle dit qu’une fois qu’elle eut décidé de voir la guérisseuse, il n’y avait aucun moyen de l’arrêter. Elle partit, transportée sur une civière par la servante et quatre hommes, pour le voyage de deux jours qui changea le cours de sa vie. Il n’y avait pas de routes. C’était montagneux et parfois les hommes devaient la porter sur leur dos.
Ils arrivèrent à la maison de la guérisseuse au crépuscule. L’endroit était bien éclairé et il y avait beaucoup de monde dans la maison. Florinda dit qu’un vieil homme poli lui dit que la guérisseuse était partie pour la journée traiter un patient. L’homme semblait très bien informé des activités de la guérisseuse et Florinda trouva facile de parler avec lui. Il était prévenant et confia qu’il était lui-même un patient. Il décrivit sa maladie comme une condition incurable qui le rendait inconscient du monde. Ils discutèrent amicalement jusqu’à tard : le vieil homme était si serviable qu’il donna même son lit à Florinda pour qu’elle puisse se reposer et attendre jusqu’au lendemain le retour de la guérisseuse.
Le matin, Florinda dit qu’elle fut soudainement réveillée par une douleur aiguë à la jambe. Une femme bougeait sa jambe, la pressant avec un morceau de bois brillant.
« La guérisseuse était une très jolie femme », continua Florinda. « Elle jeta un coup d’œil à ma jambe et secoua la tête.
« Je sais qui t’a fait ça », dit-elle. « Il a dû être grassement payé, ou il a dû supposer que tu es un être humain inutile. Lequel penses-tu que c’était ? »
Florinda rit. Elle dit qu’elle pensait que la guérisseuse était soit folle, soit grossière. Elle n’avait aucune idée que quelqu’un au monde puisse croire qu’elle était un être humain inutile. Même si elle souffrait d’une douleur atroce, elle fit savoir à la femme, en autant de mots, qu’elle était une personne riche et digne, et pas la dupe de n’importe qui.
Florinda se souvint que la guérisseuse changea d’attitude sur-le-champ. Elle sembla avoir peur. Elle s’adressa respectueusement à elle en l’appelant « Mademoiselle » et se leva de sa chaise et ordonna à tout le monde de sortir de la pièce. Quand elles furent seules, la guérisseuse s’assit sur la poitrine de Florinda et lui renversa la tête en arrière sur le bord du lit. Florinda dit qu’elle se débattit. Elle pensait qu’elle allait être tuée. Elle essaya de crier, d’alerter ses serviteurs, mais la guérisseuse lui couvrit rapidement la tête avec une couverture et lui boucha le nez. Florinda haleta pour respirer et dut respirer par la bouche ouverte. Plus la guérisseuse pressait sur la poitrine de Florinda et plus elle lui bouchait le nez, plus Florinda ouvrait la bouche. Quand elle réalisa ce que la guérisseuse faisait vraiment, elle avait déjà bu le contenu liquide immonde d’une grande bouteille que la guérisseuse avait mise dans sa bouche ouverte. Florinda commenta que la guérisseuse l’avait si bien manœuvrée qu’elle ne s’était même pas étouffée malgré le fait que sa tête pendait sur le côté du lit.
« J’ai bu tellement de liquide que j’étais sur le point de vomir », continua Florinda. « Elle me fit m’asseoir et me regarda droit dans les yeux sans ciller. Je voulais mettre mon doigt au fond de ma gorge pour vomir. Elle me gifla jusqu’à ce que mes lèvres saignent. Une Indienne qui me gifle ! Faisant saigner mes lèvres ! Ni mon père ni ma mère ne m’avaient jamais levé la main dessus. Ma surprise fut si grande que j’en oubliai l’inconfort dans mon estomac.
« Elle appela mes hommes et leur dit de me ramener à la maison. Puis elle se pencha et mit sa bouche à mon oreille pour que personne n’entende : « Si tu ne reviens pas dans neuf jours, connasse », murmura-t-elle, « tu enflereras comme un crapaud et tu souhaiteras à Dieu d’être morte. » »
Florinda dit que le liquide lui avait irrité la gorge et les cordes vocales. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. C’était cependant le cadet de ses soucis. Quand elle arriva chez elle, Celestino attendait dans un état de frénésie. Incapable de parler, Florinda était en mesure de l’observer. Elle remarqua que sa colère n’avait rien à voir avec l’inquiétude pour sa santé, mais avec le souci de sa réputation d’homme riche et de statut social. Il ne supportait pas d’être vu par ses amis influents en train de recourir à des guérisseurs indiens. Il fulminait, criant qu’il allait porter sa plainte au quartier général de l’armée, faire capturer la femme guérisseuse par les soldats et l’amener en ville pour être fouettée et jetée en prison. Ce n’étaient pas que de vaines menaces ; il pressa effectivement un commandant militaire d’envoyer une patrouille à la recherche de la guérisseuse. Les soldats revinrent quelques jours plus tard avec la nouvelle que la femme s’était enfuie.
Florinda fut rassurée par sa servante, qui lui assura que la guérisseuse l’attendrait si elle souhaitait y retourner. Bien que l’inflammation de sa gorge persistât au point qu’elle ne pouvait pas manger d’aliments solides et pouvait à peine avaler des liquides, Florinda avait hâte que le jour arrive où elle devait retourner voir la guérisseuse. Le médicament avait soulagé la douleur dans sa jambe. Quand elle fit part de ses intentions à Celestino, il devint assez furieux pour rassembler de l’aide afin de mettre fin lui-même à cette absurdité. Lui et trois de ses hommes de confiance partirent à cheval devant elle.
Florinda dit que lorsqu’elle arriva à la maison de la guérisseuse, elle s’attendait à la trouver peut-être morte, mais au lieu de cela, elle trouva Celestino assis seul.
(Carlos Castaneda, Le Don de l’Aigle)