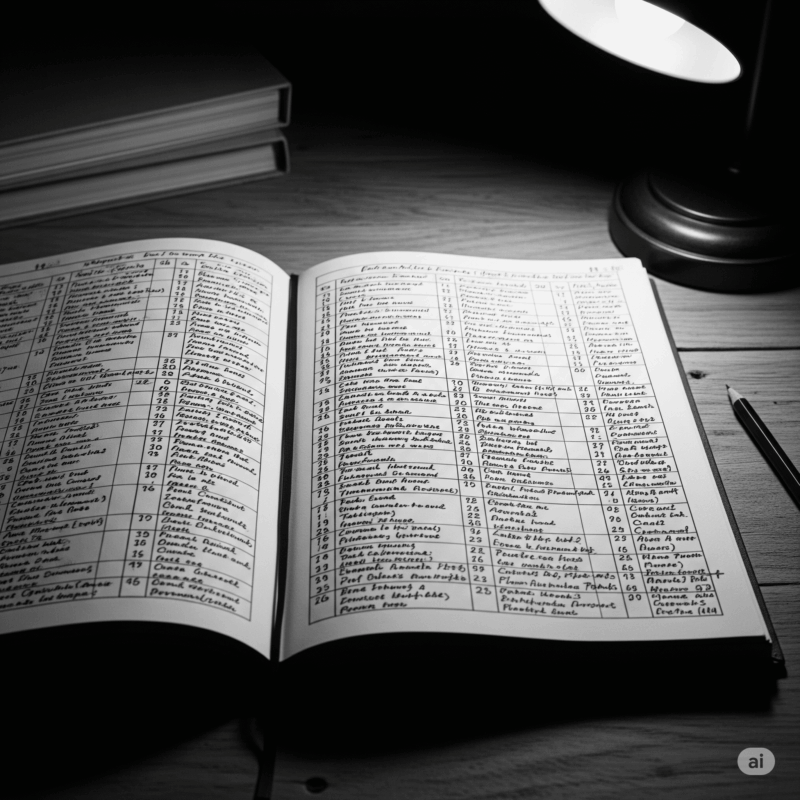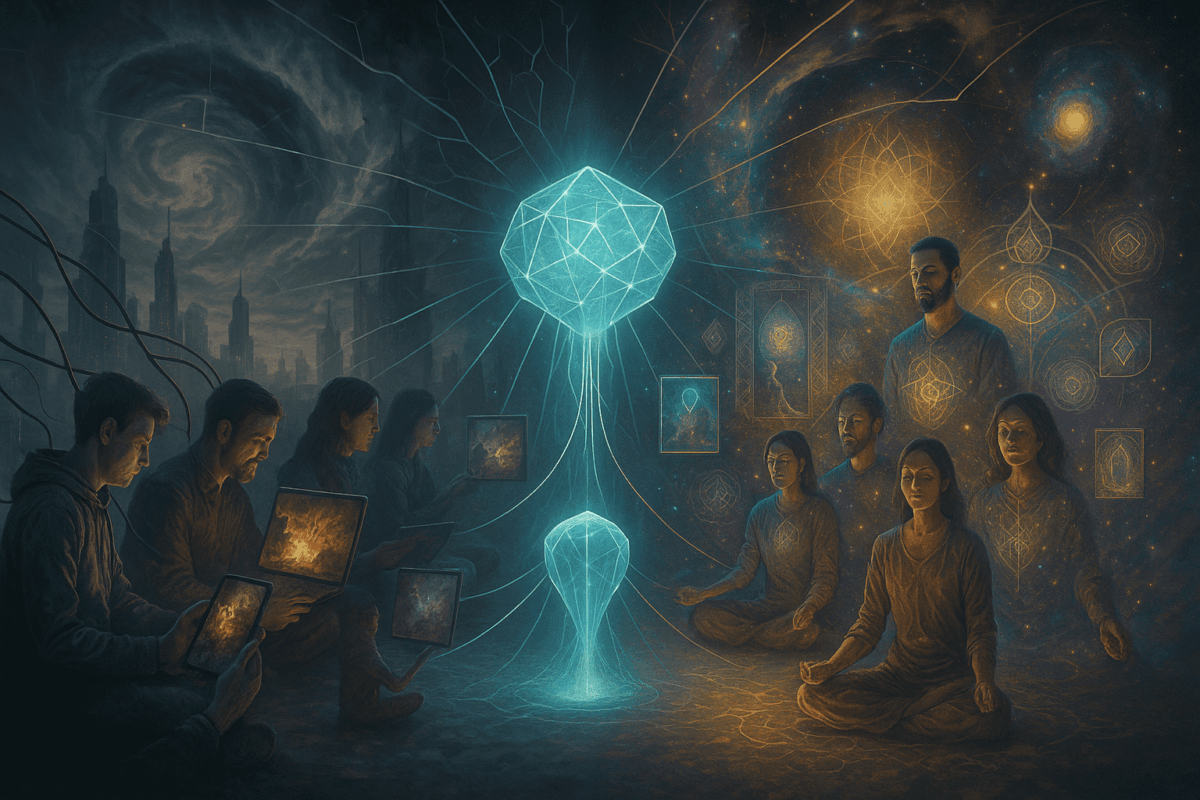J’étais vaguement conscient du bruit fort d’un moteur qui semblait tourner à plein régime sur place. Je pensais que les préposés réparaient une voiture dans le parking à l’arrière de l’immeuble où j’avais mon bureau/appartement. Le bruit est devenu si intense qu’il a fini par me réveiller. J’ai maudit en silence les garçons qui géraient le parking pour avoir réparé leur voiture juste sous la fenêtre de ma chambre. J’avais chaud, j’étais en sueur et fatigué. Je me suis assis sur le bord de mon lit, puis j’ai eu les crampes les plus douloureuses aux mollets. Je les ai massés un moment. Ils semblaient s’être contractés si fort que j’ai eu peur d’avoir d’horribles bleus. Je me suis dirigé automatiquement vers la salle de bain pour chercher du liniment. Je ne pouvais pas marcher. J’avais des vertiges. Je suis tombé, ce qui ne m’était jamais arrivé auparavant. Quand j’ai retrouvé un minimum de contrôle, j’ai remarqué que je ne m’inquiétais pas du tout des crampes dans mes mollets. J’avais toujours été un quasi-hypocondriaque. Une douleur inhabituelle dans mes mollets comme celle que j’avais maintenant m’aurait normalement plongé dans un état d’anxiété chaotique.
Je suis ensuite allé à la fenêtre pour la fermer, bien que je n’entende plus le bruit. J’ai réalisé que la fenêtre était verrouillée et qu’il faisait nuit dehors. C’était la nuit ! La pièce était étouffante. J’ai ouvert les fenêtres. Je ne comprenais pas pourquoi je les avais fermées. L’air de la nuit était frais et pur. Le parking était vide. Il m’est venu à l’esprit que le bruit devait avoir été fait par une voiture accélérant dans l’allée entre le parking et mon immeuble. Je n’y ai plus pensé et je suis retourné à mon lit pour me rendormir. Je me suis allongé en travers avec les pieds par terre. Je voulais dormir de cette façon pour aider la circulation dans mes mollets, qui étaient très douloureux, mais je n’étais pas sûr s’il aurait été préférable de les garder baissés ou peut-être de les surélever sur un oreiller.
Alors que je commençais à me reposer confortablement et à me rendormir, une pensée m’est venue à l’esprit avec une force si féroce qu’elle m’a fait me lever d’un seul réflexe. J’avais sauté dans un abîme au Mexique ! La pensée suivante que j’ai eue était une déduction quasi-logique : puisque j’avais délibérément sauté dans l’abîme pour mourir, je devais maintenant être un fantôme. Quelle étrangeté, pensai-je, que je doive revenir, sous forme fantomatique, à mon bureau/appartement au coin de Westwood et Wilshire à Los Angeles après ma mort. Pas étonnant que mes sentiments ne soient pas les mêmes. Mais si j’étais un fantôme, raisonnai-je, pourquoi aurais-je senti le souffle d’air frais sur mon visage, ou la douleur dans mes mollets ?
J’ai touché les draps de mon lit ; ils me semblaient réels. Tout comme son cadre en métal. Je suis allé à la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir. D’après mon apparence, j’aurais facilement pu être un fantôme. J’avais une sale gueule. Mes yeux étaient enfoncés, avec d’énormes cernes noirs en dessous. J’étais déshydraté, ou mort. Dans une réaction automatique, j’ai bu de l’eau directement du robinet. Je pouvais réellement l’avaler. J’ai bu gorgée après gorgée, comme si je n’avais pas bu d’eau depuis des jours. J’ai senti mes profondes inspirations. J’étais en vie ! Par Dieu, j’étais en vie ! Je le savais sans l’ombre d’un doute, mais je n’étais pas ravi, comme j’aurais dû l’être.
Une pensée des plus inhabituelles m’a alors traversé l’esprit : j’étais mort et j’avais ressuscité auparavant. J’y étais habitué ; cela ne signifiait rien pour moi. La vivacité de la pensée, cependant, l’a transformée en un quasi-souvenir. C’était un quasi-souvenir qui ne provenait pas de situations où ma vie avait été en danger. C’était quelque chose de tout à fait différent de cela. C’était, plutôt, une vague connaissance de quelque chose qui n’était jamais arrivé et n’avait aucune raison d’être dans mes pensées.
Il n’y avait aucun doute dans mon esprit que j’avais sauté dans un abîme au Mexique. J’étais maintenant dans mon appartement à Los Angeles, à plus de trois mille miles de l’endroit où j’avais sauté, sans aucun souvenir d’avoir fait le voyage de retour. D’une manière automatique, j’ai fait couler l’eau dans la baignoire et je m’y suis assis. Je ne sentais pas la chaleur de l’eau ; j’étais glacé jusqu’aux os. Don Juan m’avait appris qu’aux moments de crise, comme celui-ci, on doit utiliser l’eau courante comme un facteur de nettoyage. Je me suis souvenu de cela et je suis allé sous la douche. J’ai laissé l’eau chaude couler sur mon corps pendant peut-être plus d’une heure.
Je voulais penser calmement et rationnellement à ce qui m’arrivait, mais je ne le pouvais pas. Les pensées semblaient avoir été effacées de mon esprit. J’étais sans pensées, mais j’étais rempli à ras bord de sensations qui venaient à tout mon corps en rafales que j’étais incapable d’examiner. Tout ce que je pouvais faire, c’était de sentir leurs assauts et de les laisser me traverser. Le seul choix conscient que j’ai fait a été de m’habiller et de partir. Je suis allé prendre le petit déjeuner, ce que je faisais toujours à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, au restaurant Ship’s sur Wilshire, à un pâté de maisons de mon bureau/appartement.
J’avais marché de mon bureau à Ship’s tant de fois que je connaissais chaque pas du chemin. La même marche cette fois-ci était une nouveauté pour moi. Je ne sentais pas mes pas. C’était comme si j’avais un coussin sous mes pieds, ou comme si le trottoir était recouvert de moquette. J’ai pratiquement glissé. Je me suis soudain retrouvé à la porte du restaurant après ce que je pensais n’avoir été que deux ou trois pas. Je savais que je pouvais avaler de la nourriture parce que j’avais bu de l’eau dans mon appartement. Je savais aussi que je pouvais parler parce que j’avais raclé ma gorge et juré pendant que l’eau coulait sur moi. Je suis entré dans le restaurant comme je l’avais toujours fait. Je me suis assis au comptoir et une serveuse qui me connaissait est venue vers moi.
« Vous n’avez pas l’air très bien aujourd’hui, mon cher », dit-elle. « Avez-vous la grippe ? »
« Non », ai-je répondu, en essayant de paraître joyeux. « J’ai trop travaillé. Je suis resté debout pendant vingt-quatre heures d’affilée à écrire un devoir pour un cours. D’ailleurs, quel jour sommes-nous ? »
Elle a regardé sa montre et m’a donné la date, expliquant qu’elle avait une montre spéciale qui était aussi un calendrier, un cadeau de sa fille. Elle m’a aussi donné l’heure : 3h15 du matin.
J’ai commandé un steak avec des œufs, des pommes de terre rissolées et du pain de mie blanc beurré. Quand elle est partie pour préparer ma commande, une autre vague d’horreur a inondé mon esprit : n’était-ce qu’une illusion que j’avais sauté dans cet abîme au Mexique, au crépuscule de la veille ? Mais même si le saut n’avait été qu’une illusion, comment aurais-je pu revenir à L.A. d’un endroit si reculé seulement dix heures plus tard ? Avais-je dormi pendant dix heures ? Ou est-ce qu’il m’avait fallu dix heures pour voler, glisser, flotter, ou quoi que ce soit d’autre, jusqu’à Los Angeles ? Avoir voyagé par des moyens conventionnels jusqu’à Los Angeles depuis l’endroit où j’avais sauté dans l’abîme était hors de question, puisqu’il aurait fallu deux jours juste pour voyager jusqu’à Mexico depuis l’endroit où j’avais sauté.
Une autre pensée étrange a émergé dans mon esprit. Elle avait la même clarté que mon quasi-souvenir d’être mort et d’avoir ressuscité auparavant, et la même qualité d’être totalement étrangère à moi : ma continuité était maintenant rompue sans espoir de réparation. J’étais vraiment mort, d’une manière ou d’une autre, au fond de ce ravin. Il était impossible de comprendre que j’étais en vie, prenant mon petit déjeuner chez Ship’s. Il m’était impossible de regarder en arrière dans mon passé et de voir la ligne ininterrompue d’événements continus que nous voyons tous lorsque nous regardons dans le passé.
La seule explication qui s’offrait à moi était que j’avais suivi les directives de don Juan ; j’avais déplacé mon point d’assemblage à une position qui empêchait ma mort, et depuis mon silence intérieur, j’avais fait le voyage de retour à L.A. Il n’y avait aucune autre justification à laquelle m’accrocher. Pour la toute première fois, cette ligne de pensée m’était totalement acceptable, et totalement satisfaisante. Elle n’expliquait rien en réalité, mais elle indiquait certainement une procédure pragmatique que j’avais testée auparavant sous une forme atténuée lorsque j’avais rencontré don Juan dans cette ville de notre choix, et cette pensée semblait mettre tout mon être à l’aise.
Des pensées vives ont commencé à émerger dans mon esprit. Elles avaient la qualité unique de clarifier les problèmes. La première qui a éclaté concernait quelque chose qui m’avait tourmenté depuis le début. Don Juan l’avait décrite comme une occurrence commune chez les sorciers masculins : mon incapacité à me souvenir des événements qui s’étaient produits alors que j’étais dans des états de conscience accrue.
Don Juan avait expliqué la conscience accrue comme un déplacement infime de mon point d’assemblage, qu’il réalisait, chaque fois que je le voyais, en poussant réellement avec force sur mon dos. Il m’aidait, avec de tels déplacements, à engager des champs d’énergie qui étaient normalement périphériques à ma conscience. En d’autres termes, les champs d’énergie qui étaient habituellement à la périphérie de mon point d’assemblage devenaient centraux pendant ce déplacement. Un déplacement de cette nature avait deux conséquences pour moi : une acuité de pensée et de perception extraordinaire, et l’incapacité de me souvenir, une fois de retour à mon état de conscience normal, de ce qui s’était passé pendant que j’étais dans cet autre état.
Ma relation avec mes cohortes avait été un exemple de ces deux conséquences. J’avais des cohortes, les autres apprentis de don Juan, des compagnons pour mon voyage définitif. Je n’interagissais avec eux que dans un état de conscience accrue. La clarté et la portée de notre interaction étaient suprêmes. L’inconvénient pour moi était que dans ma vie quotidienne, ils n’étaient que de poignants quasi-souvenirs qui me poussaient au désespoir par l’anxiété et les attentes. Je pourrais dire que je vivais ma vie normale à l’affût perpétuel de quelqu’un qui allait apparaître tout à coup devant moi, peut-être sortant d’un immeuble de bureaux, peut-être tournant un coin et me heurtant. Où que j’aille, mes yeux dardaient partout, sans cesse et involontairement, à la recherche de personnes qui n’existaient pas et qui pourtant existaient comme personne d’autre.
Alors que j’étais assis chez Ship’s ce matin-là, tout ce qui m’était arrivé en état de conscience accrue, jusqu’au moindre détail, pendant toutes les années avec don Juan est redevenu un souvenir continu sans interruption. Don Juan avait déploré qu’un sorcier masculin qui est le nagual doive forcément être fragmenté à cause du volume de sa masse énergétique. Il a dit que chaque fragment vivait une gamme spécifique d’une portée totale d’activité, et que les événements qu’il expérimentait dans chaque fragment devaient un jour être réunis pour donner une image complète et consciente de tout ce qui avait eu lieu dans sa vie totale.
En me regardant dans les yeux, il m’avait dit que cette unification prend des années à accomplir, et qu’on lui avait parlé de cas de naguals qui n’ont jamais atteint la portée totale de leurs activités de manière consciente et ont vécu fragmentés.
Ce que j’ai vécu ce matin-là chez Ship’s dépassait tout ce que j’aurais pu imaginer dans mes fantasmes les plus fous. Don Juan m’avait dit maintes et maintes fois que le monde des sorciers n’était pas un monde immuable, où le mot est final, immuable, mais que c’est un monde de fluctuation éternelle où rien ne doit être tenu pour acquis. Le saut dans l’abîme avait modifié ma cognition si radicalement qu’il permettait maintenant l’entrée de possibilités à la fois prodigieuses et indescriptibles. Mais tout ce que j’aurais pu dire sur l’unification de mes fragments cognitifs aurait pâli en comparaison de la réalité. Ce matin fatidique chez Ship’s, j’ai vécu quelque chose d’infiniment plus puissant que le jour où j’ai vu l’énergie telle qu’elle circule dans l’univers, pour la première fois – le jour où j’ai fini dans le lit de mon bureau/appartement après avoir été sur le campus de l’UCLA sans rentrer chez moi de la manière que mon système cognitif exigeait pour que tout l’événement soit réel. Chez Ship’s, j’ai intégré tous les fragments de mon être. J’avais agi dans chacun d’eux avec une certitude et une cohérence parfaites, et pourtant je n’avais aucune idée que j’avais fait cela. J’étais, en substance, un puzzle gigantesque, et assembler chaque pièce de ce puzzle produisait un effet qui n’avait pas de nom.
Je me suis assis au comptoir de Ship’s, transpirant abondamment, réfléchissant inutilement, et posant obsessionnellement des questions qui ne pouvaient être répondues : Comment tout cela était-il possible ? Comment avais-je pu être fragmenté de cette manière ? Qui sommes-nous vraiment ? Certainement pas les personnes que nous avons tous été amenés à croire que nous sommes. J’avais des souvenirs d’événements qui n’étaient jamais arrivés, pour ce qui est d’un certain noyau de moi-même. Je ne pouvais même pas pleurer.
« Un sorcier pleure quand il est fragmenté », m’avait dit un jour don Juan. « Quand il est complet, il est pris d’un frisson qui a le potentiel, parce qu’il est si intense, de mettre fin à sa vie. »
Je vivais un tel frisson ! Je doutais de revoir un jour mes cohortes. Il m’apparaissait que tous étaient partis avec don Juan. J’étais seul. Je voulais y penser, pleurer ma perte, me plonger dans une tristesse satisfaisante comme je l’avais toujours fait. Je ne le pouvais pas. Il n’y avait rien à pleurer, rien dont être triste. Rien n’importait. Nous étions tous des guerriers-voyageurs, et nous avions tous été avalés par l’infini.
Depuis le début, j’avais écouté don Juan parler du guerrier-voyageur. J’avais immensément aimé la description, et je m’étais identifié à elle sur une base purement émotionnelle. Pourtant, je n’avais jamais ressenti ce qu’il voulait vraiment dire par là, peu importe le nombre de fois où il m’avait expliqué sa signification. Cette nuit-là, au comptoir de Ship’s, je savais de quoi don Juan avait parlé. J’étais un guerrier-voyageur. Seuls les faits énergétiques étaient significatifs pour moi. Tout le reste n’était que des fioritures sans aucune importance.
Cette nuit-là, alors que j’étais assis en attendant ma nourriture, une autre pensée vive a éclaté dans mon esprit. J’ai senti une vague d’empathie, une vague d’identification avec les prémisses de don Juan. J’avais enfin atteint le but de ses enseignements : j’étais un avec lui comme je ne l’avais jamais été auparavant. Il n’avait jamais été question que je me batte simplement contre don Juan ou ses concepts, qui étaient révolutionnaires pour moi parce qu’ils ne remplissaient pas la linéarité de mes pensées en tant qu’homme occidental. C’était plutôt que la précision de don Juan dans la présentation de ses concepts m’avait toujours terrifié. Son efficacité avait semblé être du dogmatisme. C’est cette apparence qui m’avait forcé à chercher des éclaircissements, et m’avait fait agir, depuis le début, comme si j’avais été un croyant réticent.
Oui, j’avais sauté dans un abîme, me dis-je, et je n’étais pas mort parce qu’avant d’atteindre le fond de ce ravin, j’ai laissé la mer sombre de la conscience m’avaler. Je me suis rendu à elle, sans peur ni regrets. Et cette mer sombre m’avait fourni tout ce qui était nécessaire pour que je ne meure pas, mais que je finisse dans mon lit à L.A. Cette explication ne m’aurait rien expliqué deux jours auparavant. À trois heures du matin, chez Ship’s, elle signifiait tout pour moi.
J’ai frappé ma main sur la table comme si j’étais seul dans la pièce. Les gens m’ont regardé et ont souri d’un air entendu. Je m’en fichais. Mon esprit était concentré sur un dilemme insoluble : j’étais en vie malgré le fait d’avoir sauté dans un abîme pour mourir dix heures auparavant. Je savais qu’un tel dilemme ne pourrait jamais être résolu. Ma cognition normale exigeait une explication linéaire pour être satisfaite, et les explications linéaires n’étaient pas possibles. C’était le nœud de l’interruption de la continuité. Don Juan avait dit que cette interruption était de la sorcellerie. Je le savais maintenant, aussi clairement que j’en étais capable. Comme don Juan avait eu raison quand il avait dit que pour que je reste derrière, j’avais besoin de toute ma force, de toute ma patience, et par-dessus tout, des tripes d’acier d’un guerrier-voyageur.
Je voulais penser à don Juan, mais je ne le pouvais pas. D’ailleurs, je ne me souciais pas de don Juan. Il semblait y avoir une barrière géante entre nous. J’ai vraiment cru à ce moment-là que la pensée étrangère qui s’était insinuée en moi depuis mon réveil était vraie : j’étais quelqu’un d’autre. Un échange avait eu lieu au moment de mon saut. Sinon, j’aurais savouré la pensée de don Juan ; j’aurais eu la nostalgie de lui. J’aurais même ressenti une pointe de ressentiment parce qu’il ne m’avait pas emmené avec lui. Cela aurait été mon moi normal. Je n’étais vraiment plus le même. Cette pensée a pris de l’ampleur jusqu’à envahir tout mon être. Tout résidu de mon ancien moi que j’aurais pu conserver a alors disparu.
Une nouvelle humeur a pris le dessus. J’étais seul ! Don Juan m’avait laissé à l’intérieur d’un rêve comme son agent provocateur. J’ai senti mon corps commencer à perdre sa rigidité ; il est devenu flexible, par degrés, jusqu’à ce que je puisse respirer profondément et librement. J’ai ri à haute voix. Peu m’importait que les gens me regardent fixement et ne sourient pas cette fois. J’étais seul, et il n’y avait rien que je puisse y faire !
J’ai eu la sensation physique d’entrer réellement dans un passage, un passage qui avait une force propre. Il m’a attiré. C’était un passage silencieux. Don Juan était ce passage, silencieux et immense. C’était la toute première fois que je sentais que don Juan était dépourvu de physicalité. Il n’y avait pas de place pour le sentimentalisme ou la nostalgie. Je ne pouvais pas lui manquer car il était là comme une émotion dépersonnalisée qui m’attirait.
Le passage me défiait. J’ai eu une sensation d’exubérance, d’aisance. Oui, je pouvais parcourir ce passage, seul ou en compagnie, peut-être pour toujours. Et faire cela n’était pas une imposition pour moi, ni un plaisir. C’était plus que le début du voyage définitif, le destin inévitable d’un guerrier-voyageur, c’était le début d’une nouvelle ère. J’aurais dû pleurer en réalisant que j’avais trouvé ce passage, mais je ne l’ai pas fait. J’affrontais l’infini chez Ship’s ! Quelle chose extraordinaire ! J’ai senti un frisson dans le dos. J’ai entendu la voix de don Juan dire que l’univers était en effet insondable.
À ce moment-là, la porte arrière du restaurant, celle qui menait au parking, s’est ouverte et un étrange personnage est entré : un homme peut-être au début de la quarantaine, débraillé et émacié, mais avec des traits plutôt beaux. Je l’avais vu pendant des années errer autour de l’UCLA, se mêlant aux étudiants. Quelqu’un m’avait dit qu’il était un patient externe de l’hôpital des vétérans voisin. Il semblait être mentalement déséquilibré. Je l’avais vu maintes et maintes fois chez Ship’s, recroquevillé sur une tasse de café, toujours au même bout du comptoir. Je l’avais aussi vu attendre dehors, regardant par la fenêtre, guettant que son tabouret préféré se libère si quelqu’un y était assis.
Quand il est entré dans le restaurant, il s’est assis à sa place habituelle, puis il m’a regardé. Nos regards se sont croisés. La chose suivante que j’ai su, c’est qu’il avait poussé un cri formidable qui m’a glacé, ainsi que toutes les personnes présentes, jusqu’aux os. Tout le monde m’a regardé, les yeux écarquillés, certains avec de la nourriture non mâchée dans la bouche. De toute évidence, ils pensaient que j’avais crié. J’avais créé les précédents en frappant sur le comptoir puis en riant à haute voix. L’homme a sauté de son tabouret et a couru hors du restaurant, se retournant pour me regarder fixement tout en faisant des gestes agités avec ses mains au-dessus de sa tête.
J’ai succombé à une envie impulsive et j’ai couru après l’homme. Je voulais qu’il me dise ce qu’il avait vu en moi qui l’avait fait crier. Je l’ai rattrapé dans le parking et je lui ai demandé de me dire pourquoi il avait crié. Il s’est couvert les yeux et a crié de nouveau, encore plus fort. Il était comme un enfant, effrayé par un cauchemar, hurlant à pleins poumons. Je l’ai laissé et je suis retourné au restaurant.
« Que vous est-il arrivé, mon cher ? » a demandé la serveuse d’un air inquiet. « Je pensais que vous m’aviez abandonnée. »
« Je suis juste allé voir un ami », dis-je.
La serveuse m’a regardé et a fait un geste de fausse contrariété et de surprise.
« Ce type est votre ami ? » a-t-elle demandé.
« Le seul ami que j’ai au monde », dis-je, et c’était la vérité, si je pouvais définir « ami » comme quelqu’un qui voit à travers le vernis qui vous recouvre et sait d’où vous venez vraiment.
(Carlos Castaneda, Le Voyage Définitif)