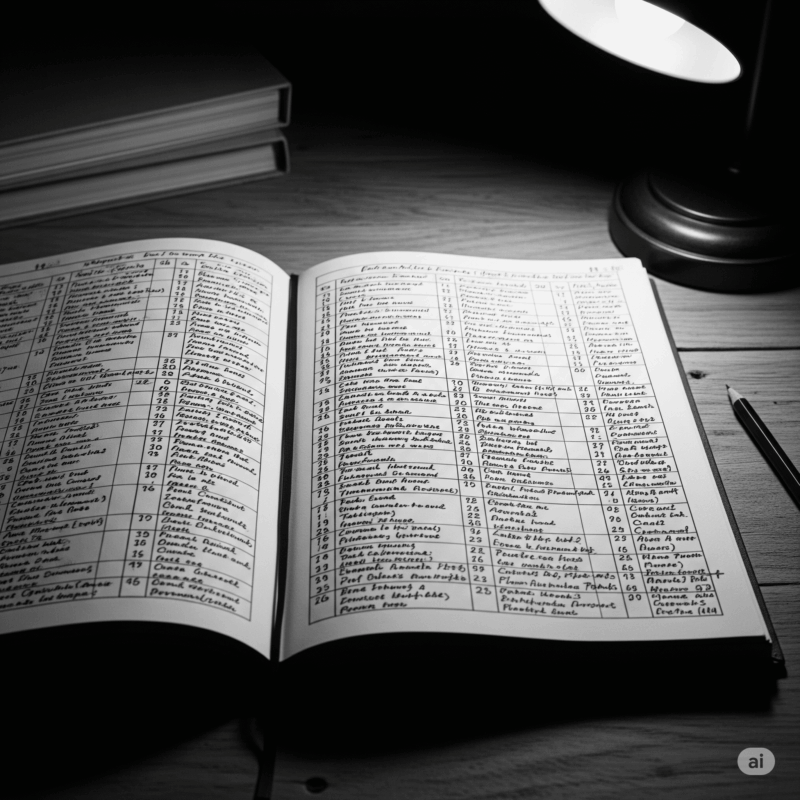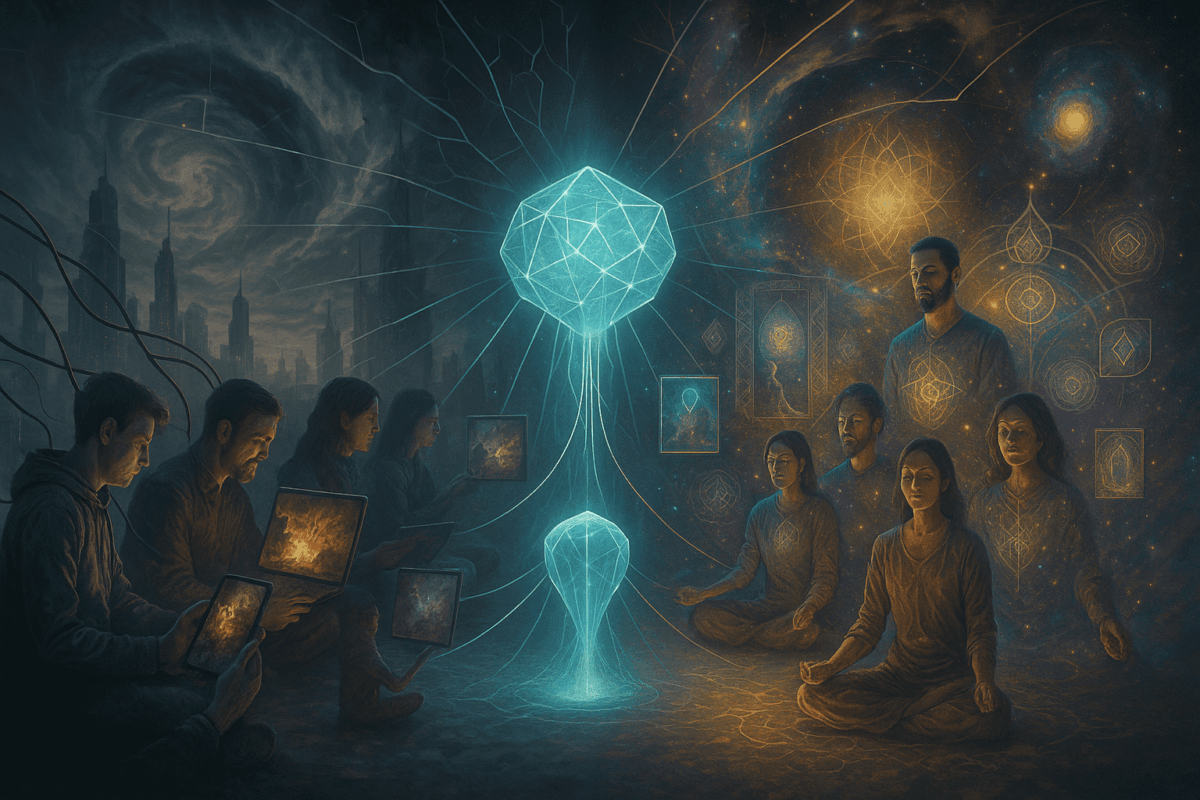Los Angeles a toujours été mon chez-moi. Mon choix de Los Angeles n’avait pas été volontaire. Pour moi, rester à Los Angeles a toujours été l’équivalent d’y être né, peut-être même plus que cela. Mon attachement émotionnel à cette ville a toujours été total. Mon amour pour la ville de Los Angeles a toujours été si intense, si intrinsèquement une partie de moi, que je n’ai jamais eu à l’exprimer. Je n’ai jamais eu à le revoir ou à le renouveler, jamais.
J’avais, à Los Angeles, ma famille d’amis. Ils faisaient pour moi partie de mon milieu immédiat, ce qui signifie que je les avais totalement acceptés, de la même manière que j’avais accepté la ville. Un de mes amis a dit un jour, à moitié en plaisantant, que nous nous détestions tous cordialement. Sans doute pouvaient-ils se permettre de tels sentiments, car ils disposaient d’autres arrangements émotionnels, comme des parents, des épouses et des maris. Je n’avais que mes amis à Los Angeles.
Pour une raison ou une autre, j’étais le confident de chacun. Chacun d’eux me déversait ses problèmes et ses vicissitudes. Mes amis étaient si proches de moi que je n’avais jamais reconnu leurs problèmes ou leurs tribulations comme autre chose que normaux. Je pouvais leur parler pendant des heures des mêmes choses qui m’avaient horrifié chez le psychiatre et sur ses bandes.
De plus, je n’avais jamais réalisé que chacun de mes amis était étonnamment similaire au psychiatre et au professeur d’anthropologie. Je n’avais jamais remarqué à quel point mes amis étaient tendus. Tous fumaient compulsivement, comme le psychiatre, mais cela ne m’avait jamais paru évident car je fumais tout autant moi-même et j’étais tout aussi tendu. Leur affectation dans le parler était une autre chose qui ne m’avait jamais semblé apparente, bien qu’elle fût là. Ils affectaient toujours un accent traînant de l’ouest des États-Unis, mais ils étaient très conscients de ce qu’ils faisaient. Je n’avais jamais non plus remarqué leurs insinuations flagrantes sur une sensualité qu’ils étaient incapables de ressentir, sauf intellectuellement.
La véritable confrontation avec moi-même a commencé lorsque j’ai été confronté au dilemme de mon ami Pete. Il est venu me voir, tout amoché. Il avait la bouche enflée et un œil gauche rouge et enflé qui avait manifestement été frappé et qui virait déjà au bleu. Avant que j’aie eu le temps de lui demander ce qui lui était arrivé, il a lâché que sa femme, Patricia, était allée à une convention d’agents immobiliers pendant le week-end, dans le cadre de son travail, et que quelque chose de terrible lui était arrivé. Vu l’état de Pete, j’ai pensé que Patricia avait peut-être été blessée, ou même tuée, dans un accident.
« Est-ce qu’elle va bien ? » ai-je demandé, sincèrement inquiet.
« Bien sûr qu’elle va bien », aboya-t-il. « C’est une salope et une pute, et il n’arrive rien aux salopes-putes, sauf qu’elles se font baiser, et elles aiment ça ! »
Pete était enragé. Il tremblait, presque convulsant. Ses cheveux touffus et bouclés partaient dans tous les sens. D’habitude, il les peignait soigneusement et mettait en place ses boucles naturelles. Maintenant, il avait l’air aussi sauvage qu’un diable de Tasmanie.
« Tout était normal jusqu’à aujourd’hui », a continué mon ami. « Puis, ce matin, après que je sois sorti de la douche, elle a fait claquer une serviette sur mes fesses nues, et c’est ce qui m’a fait prendre conscience de sa merde ! J’ai su instantanément qu’elle avait baisé avec quelqu’un d’autre. »
J’étais perplexe face à son raisonnement. Je l’ai interrogé davantage, je lui ai demandé comment faire claquer une serviette pouvait révéler quoi que ce soit de ce genre à quelqu’un.
« Ça ne révélerait rien aux connards ! » dit-il avec un pur venin dans la voix. « Mais je connais Patricia, et jeudi, avant qu’elle aille à la convention des agents immobiliers, elle ne pouvait pas faire claquer une serviette ! En fait, elle n’a jamais pu faire claquer une serviette de tout le temps où nous avons été mariés. Quelqu’un a dû lui apprendre à le faire, pendant qu’ils étaient nus ! Alors je l’ai attrapée par la gorge et je lui ai arraché la vérité ! Oui ! Elle baise avec son patron ! »
Pete a dit qu’il est allé au bureau de Patricia pour en découdre avec son patron, mais l’homme était lourdement protégé par des gardes du corps. Ils l’ont jeté sur le parking. Il voulait briser les vitres du bureau, leur jeter des pierres, mais les gardes du corps ont dit que s’il faisait ça, il finirait en prison, ou pire encore, il recevrait une balle dans la tête.
« Ce sont eux qui t’ont battu, Pete ? » lui ai-je demandé.
« Non », dit-il, abattu. « J’ai descendu la rue et je suis entré dans le bureau de vente d’un parc de voitures d’occasion. J’ai frappé le premier vendeur qui est venu me parler. L’homme a été choqué, mais il ne s’est pas mis en colère. Il a dit : « Calmez-vous, monsieur, calmez-vous ! Il y a de la place pour la négociation. » Quand je l’ai frappé à nouveau à la bouche, il s’est énervé. C’était un grand type, et il m’a frappé à la bouche et à l’œil et m’a assommé. Quand j’ai repris mes esprits », a poursuivi Pete, « j’étais allongé sur le canapé de leur bureau. J’ai entendu une ambulance approcher. Je savais qu’ils venaient pour moi, alors je me suis levé et je suis sorti en courant. Puis je suis venu te voir. »
Il a commencé à pleurer de manière incontrôlable. Il a eu mal au ventre. Il était en piteux état. J’ai appelé sa femme, et en moins de dix minutes, elle était dans l’appartement. Elle s’est agenouillée devant Pete et a juré qu’elle n’aimait que lui, que tout le reste qu’elle faisait était de la pure imbécillité, et que leur amour était une question de vie ou de mort – les autres n’étaient rien. Elle ne s’en souvenait même pas. Tous deux ont pleuré à cœur joie, et bien sûr, ils se sont pardonnés. Patricia portait des lunettes de soleil pour cacher l’hématome près de son œil droit où Pete l’avait frappée – Pete était gaucher. Tous deux étaient inconscients de ma présence, et quand ils sont partis, ils ne savaient même pas que j’étais là. Ils sont simplement sortis, laissant la porte ouverte, s’enlaçant.
La vie semblait continuer pour moi comme elle l’avait toujours fait. Mes amis agissaient avec moi comme ils l’avaient toujours fait. Nous étions, comme d’habitude, occupés à aller à des fêtes, ou au cinéma, ou simplement à « papoter », ou à chercher des restaurants où ils offraient « à volonté » pour le prix d’un repas. Cependant, malgré cette pseudo-normalité, un étrange nouveau facteur semblait être entré dans ma vie. En tant que sujet qui l’expérimentait, il m’est apparu que, tout à coup, j’étais devenu extrêmement étroit d’esprit. J’avais commencé à juger mes amis de la même manière que j’avais jugé le psychiatre et le professeur d’anthropologie. Qui étais-je, de toute façon, pour m’ériger en juge de qui que ce soit d’autre ?
J’ai ressenti un immense sentiment de culpabilité. Juger mes amis créait une humeur jusqu’alors inconnue pour moi. Mais ce que je considérais comme encore pire, c’est que non seulement je les jugeais, mais je trouvais leurs problèmes et leurs tribulations étonnamment banals. J’étais le même homme ; ils étaient mes mêmes amis. J’avais entendu leurs plaintes et leurs récits de leurs situations des centaines de fois, et je n’avais jamais ressenti autre chose qu’une profonde identification avec tout ce que j’écoutais. Mon horreur en découvrant cette nouvelle humeur en moi était stupéfiante.
L’aphorisme selon lequel un malheur n’arrive jamais seul n’aurait pas pu être plus vrai pour moi à ce moment de ma vie. La désintégration totale de mon mode de vie est survenue lorsque mon ami Rodrigo Cummings m’a demandé de l’emmener à l’aéroport de Burbank ; de là, il allait s’envoler pour New York. C’était une manœuvre très dramatique et désespérée de sa part. Il considérait comme sa damnation d’être coincé à Los Angeles. Pour le reste de ses amis, c’était une grosse blague, le fait qu’il ait essayé de traverser le pays en voiture pour New York plusieurs fois, et que chaque fois qu’il avait essayé de le faire, sa voiture était tombée en panne. Une fois, il était allé jusqu’à Salt Lake City avant que sa voiture ne s’effondre ; elle avait besoin d’un nouveau moteur. Il a dû la mettre à la ferraille là-bas. La plupart du temps, ses voitures rendaient l’âme dans la banlieue de Los Angeles.
« Qu’arrive-t-il à tes voitures, Rodrigo ? » lui ai-je demandé une fois, poussé par une véritable curiosité.
« Je ne sais pas », répondit-il avec un vague sentiment de culpabilité. Et puis, d’une voix digne du professeur d’anthropologie dans son rôle de prédicateur revivaliste, il a dit : « C’est peut-être parce que quand je prends la route, j’accélère parce que je me sens libre. J’ouvre généralement toutes mes fenêtres. Je veux que le vent souffle sur mon visage. J’ai l’impression d’être un gamin à la recherche de quelque chose de nouveau. »
Il était évident pour moi que ses voitures, qui étaient toujours des tacots, n’étaient plus capables de rouler vite, et qu’il brûlait tout simplement leurs moteurs.
De Salt Lake City, Rodrigo était revenu à Los Angeles en auto-stop. Bien sûr, il aurait pu faire de l’auto-stop jusqu’à New York, mais cela ne lui était jamais venu à l’esprit. Rodrigo semblait être affligé de la même condition que moi : une passion inconsciente pour Los Angeles, qu’il voulait refuser à tout prix.
Une autre fois, sa voiture était en excellent état mécanique. Elle aurait pu faire tout le voyage avec facilité, mais Rodrigo n’était apparemment pas en état de quitter Los Angeles. Il a conduit jusqu’à San Bernardino, où il est allé voir un film – Les Dix Commandements. Ce film, pour des raisons connues de Rodrigo seul, a créé en lui une nostalgie imbattable de L.A. Il est revenu, et a pleuré, me disant comment la putain de ville de Los Angeles avait construit une clôture autour de lui qui ne le laissait pas passer. Sa femme était ravie qu’il ne soit pas parti, et sa petite amie, Melissa, était encore plus ravie, bien que également chagrinée car elle a dû rendre les dictionnaires qu’il lui avait donnés.
Sa dernière tentative désespérée d’atteindre New York par avion a été rendue encore plus dramatique car il a emprunté de l’argent à ses amis pour payer le billet. Il a dit que de cette façon, comme il n’avait pas l’intention de les rembourser, il s’assurait de ne pas revenir.
J’ai mis ses valises dans le coffre de ma voiture et je me suis dirigé avec lui vers l’aéroport de Burbank. Il a fait remarquer que l’avion ne partait pas avant sept heures. C’était en début d’après-midi, et nous avions amplement le temps d’aller voir un film. De plus, il voulait jeter un dernier regard sur Hollywood Boulevard, le centre de nos vies et de nos activités.
Nous sommes allés voir une épopée en Technicolor et Cinerama. C’était un film long et atroce qui semblait captiver l’attention de Rodrigo. Quand nous sommes sortis du cinéma, il commençait déjà à faire nuit. Je me suis précipité à Burbank au milieu d’un trafic intense. Il a exigé que nous prenions les rues de surface plutôt que l’autoroute, qui était bloquée à cette heure-là. L’avion était sur le point de partir quand nous sommes arrivés à l’aéroport. C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Doux et vaincu, Rodrigo s’est rendu à un guichet et a présenté son billet pour se faire rembourser. Le caissier a noté son nom, lui a donné un reçu et a dit que son argent serait envoyé dans un délai de six à douze semaines depuis le Tennessee, où se trouvaient les bureaux de comptabilité de la compagnie aérienne.
Nous sommes retournés à l’immeuble où nous vivions tous les deux. Comme il n’avait dit au revoir à personne cette fois-ci, de peur de perdre la face, personne n’avait jamais remarqué qu’il avait tenté de partir une fois de plus. Le seul inconvénient était qu’il avait vendu sa voiture. Il m’a demandé de le conduire chez ses parents, car son père allait lui donner l’argent qu’il avait dépensé pour le billet. Son père avait toujours été, aussi loin que je me souvienne, l’homme qui avait tiré Rodrigo de toutes les situations problématiques dans lesquelles il s’était jamais trouvé. Le slogan du père était « N’ayez crainte, Rodrigo Senior est là ! ». Après avoir entendu la demande de Rodrigo pour un prêt afin de payer son autre prêt, le père a regardé mon ami avec l’expression la plus triste que j’aie jamais vue. Il rencontrait lui-même de terribles difficultés financières.
Mettant son bras autour des épaules de son fils, il a dit : « Je ne peux pas t’aider cette fois-ci, mon garçon. Maintenant, tu devrais avoir peur, car Rodrigo Senior n’est plus là. »
Je voulais désespérément m’identifier à mon ami, ressentir son drame comme je l’avais toujours fait, mais je ne le pouvais pas. Je me suis seulement concentré sur la déclaration du père. Elle m’a semblé si définitive qu’elle m’a galvanisé. J’ai recherché avidement la compagnie de don Juan. J’ai tout laissé en suspens à Los Angeles et j’ai fait un voyage à Sonora. Je lui ai parlé de l’étrange humeur dans laquelle j’étais entré avec mes amis. Sanglotant de remords, je lui ai dit que j’avais commencé à les juger.
« Ne vous énervez pas pour rien », dit calmement don Juan. « Vous savez déjà que toute une ère de votre vie touche à sa fin, mais une ère ne se termine pas vraiment tant que le roi n’est pas mort. »
« Que voulez-vous dire par là, don Juan ? »
« Vous êtes le roi, et vous êtes exactement comme vos amis. C’est la vérité qui vous fait trembler de peur. Une chose que vous pouvez faire est de l’accepter telle quelle, ce que, bien sûr, vous ne pouvez pas faire. L’autre chose que vous pouvez faire est de dire : « Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça », et de vous répéter que vous n’êtes pas comme ça. Je vous promets, cependant, qu’un moment viendra où vous réaliserez que vous êtes comme ça. »
(Carlos Castaneda, Le Voyage Définitif)