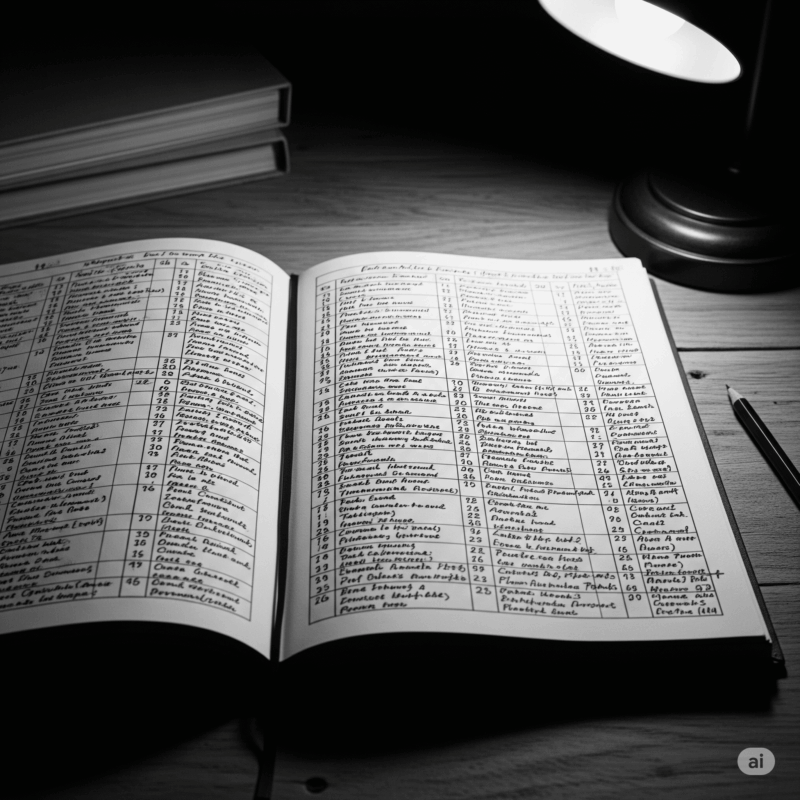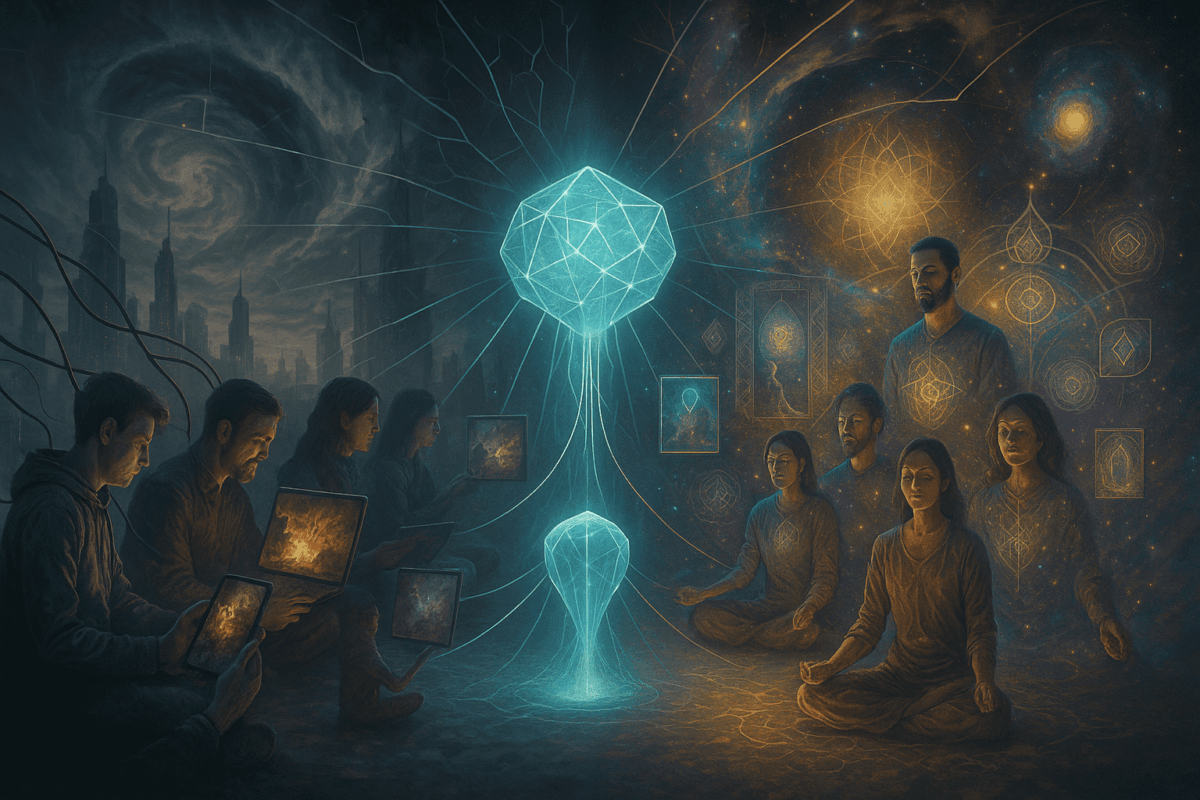Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans une impasse totale quant à la manière de me comporter dans le monde. Le monde qui m’entourait n’avait pas changé. Cela provenait définitivement d’un défaut en moi. L’influence de don Juan et toutes les activités découlant de ses pratiques, dans lesquelles il m’avait si profondément engagé, me pesaient et provoquaient en moi une grave incapacité à traiter avec mes semblables. J’ai examiné mon problème et j’ai conclu que mon défaut était ma compulsion à mesurer tout le monde en utilisant don Juan comme étalon.
Don Juan était, à mon avis, un être qui vivait sa vie professionnellement, dans tous les sens du terme, ce qui signifie que chacun de ses actes, aussi insignifiant soit-il, comptait. J’étais entouré de gens qui se croyaient des êtres immortels, qui se contredisaient à chaque pas ; c’étaient des êtres dont les actes ne pouvaient jamais être justifiés. C’était un jeu injuste ; les cartes étaient truquées contre les gens que je rencontrais. J’étais habitué au comportement inaltérable de don Juan, à son absence totale d’importance personnelle et à la portée insondable de son intellect ; très peu de gens que je connaissais étaient même conscients qu’il existait un autre modèle de comportement qui favorisait ces qualités. La plupart d’entre eux ne connaissaient que le modèle de comportement de l’auto-réflexion, qui rend les hommes faibles et tordus.
Par conséquent, j’éprouvais de très grandes difficultés dans mes études universitaires. Je les perdais de vue. J’ai essayé désespérément de trouver une justification qui légitimerait mes efforts académiques. La seule chose qui m’est venue en aide et m’a donné un lien, aussi ténu soit-il, avec le monde universitaire, fut la recommandation que don Juan m’avait faite une fois, selon laquelle les guerriers-voyageurs devraient avoir une romance avec la connaissance, sous quelque forme que la connaissance se présente.
Il avait défini le concept de guerriers-voyageurs, disant qu’il se référait aux sorciers qui, en étant des guerriers, voyageaient dans la mer sombre de la conscience. Il avait ajouté que les êtres humains étaient des voyageurs de la mer sombre de la conscience, et que cette Terre n’était qu’une étape de leur voyage ; pour des raisons extérieures, qu’il ne se souciait pas de divulguer à l’époque, les voyageurs avaient interrompu leur voyage. Il a dit que les êtres humains étaient pris dans une sorte de remous, un courant qui tournait en rond, leur donnant l’impression de bouger alors qu’ils étaient, en substance, stationnaires. Il a soutenu que les sorciers étaient les seuls adversaires de la force qui maintenait les êtres humains prisonniers, et que par leur discipline, les sorciers se libéraient de son emprise et poursuivaient leur voyage de conscience.
Ce qui a précipité le bouleversement chaotique final dans ma vie universitaire, c’est mon incapacité à concentrer mon intérêt sur des sujets de préoccupation anthropologique qui ne m’importaient pas du tout, non pas à cause de leur manque d’attrait, mais parce qu’il s’agissait principalement de questions où les mots et les concepts devaient être manipulés, comme dans un document juridique, pour obtenir un résultat donné qui établirait des précédents. On soutenait que la connaissance humaine se construit de cette manière, et que l’effort de chaque individu était une pierre angulaire dans la construction d’un système de connaissance. L’exemple qui m’a été donné était celui du système juridique par lequel nous vivons, et qui est d’une importance inestimable pour nous.
Cependant, mes notions romantiques de l’époque m’empêchaient de me concevoir comme un avocat-en-anthropologie. J’avais acheté, corps et âme, le concept que l’anthropologie devait être la matrice de toute entreprise humaine, ou la mesure de l’homme.
Don Juan, un pragmatique consommé, un véritable guerrier-voyageur de l’inconnu, a dit que j’étais plein de balivernes. Il a dit que peu importait que les sujets anthropologiques qui m’étaient proposés fussent des manœuvres de mots et de concepts, que ce qui était important, c’était l’exercice de la discipline.
« Peu importe », m’a-t-il dit une fois, « à quel point vous êtes un bon lecteur, et combien de livres merveilleux vous pouvez lire. Ce qui est important, c’est que vous ayez la discipline de lire ce que vous ne voulez pas lire. Le nœud de l’exercice des sorciers d’aller à l’école réside dans ce que vous refusez, pas dans ce que vous acceptez. »
J’ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à mes études et je suis allé travailler dans le département artistique d’une entreprise qui fabriquait des décalcomanies. Mon travail a mobilisé mes efforts et mes pensées au maximum. Mon défi était d’accomplir les tâches qui m’étaient assignées aussi parfaitement et aussi rapidement que possible. Préparer les feuilles de vinyle avec les images à traiter par sérigraphie pour en faire des décalcomanies était une procédure standard qui n’admettait aucune innovation, et l’efficacité du travailleur était mesurée par l’exactitude et la vitesse. Je suis devenu un bourreau de travail et je me suis énormément amusé.
Le directeur du département artistique et moi sommes devenus de grands amis. Il m’a pratiquement pris sous son aile. Son nom était Ernest Lipton. Je l’admirais et le respectais immensément. C’était un artiste raffiné et un magnifique artisan. Son défaut était sa douceur, sa considération incroyable pour les autres, qui frisait la passivité.
Par exemple, un jour, nous sortions du parking d’un restaurant où nous avions déjeuné. Très poliment, il a attendu qu’une autre voiture sorte de la place de parking devant lui. Le conducteur ne nous a manifestement pas vus et a commencé à reculer à une vitesse considérable. Ernest Lipton aurait facilement pu klaxonner pour attirer l’attention de l’homme afin qu’il regarde où il allait. Au lieu de cela, il est resté assis, souriant comme un idiot pendant que le type emboutissait sa voiture. Puis il s’est tourné et s’est excusé auprès de moi. « Mince, j’aurais pu klaxonner », dit-il, « mais c’est tellement fort, ça me gêne. »
Le type qui avait reculé dans la voiture d’Ernest était furieux et a dû être apaisé.
« Ne vous inquiétez pas », a dit Ernest. « Il n’y a aucun dommage à votre voiture. De plus, vous n’avez fait que casser mes phares ; j’allais les remplacer de toute façon. »
Un autre jour, dans le même restaurant, des Japonais, clients de l’entreprise de décalcomanies et ses invités pour le déjeuner, nous parlaient avec animation, posant des questions. Le serveur est arrivé avec la nourriture et a débarrassé la table de quelques assiettes de salade, faisant de la place, du mieux qu’il pouvait sur la table étroite, pour les énormes assiettes chaudes du plat principal. L’un des clients japonais avait besoin de plus d’espace. Il a poussé son assiette en avant ; la poussée a mis l’assiette d’Ernest en mouvement et elle a commencé à glisser de la table. Encore une fois, Ernest aurait pu avertir l’homme, mais il ne l’a pas fait. Il est resté assis là, souriant, jusqu’à ce que l’assiette tombe sur ses genoux.
À une autre occasion, je suis allé chez lui pour l’aider à monter des chevrons sur son patio, où il allait laisser pousser une vigne pour avoir de l’ombre partielle et des fruits. Nous avons pré-arrangé les chevrons en un immense cadre, puis nous avons soulevé un côté et l’avons boulonné à des poutres. Ernest était un homme grand et très fort, et utilisant un morceau de deux par quatre comme dispositif de levage, il a soulevé l’autre extrémité pour que j’insère les boulons dans des trous qui étaient déjà percés dans les poutres de soutien. Mais avant que j’aie eu la chance de mettre les boulons, on a frappé avec insistance à la porte et Ernest m’a demandé d’aller voir qui c’était pendant qu’il tenait le cadre de chevrons.
Sa femme était à la porte avec ses paquets d’épicerie. Elle m’a engagé dans une longue conversation et j’ai oublié Ernest. Je l’ai même aidée à ranger ses courses. Au milieu de l’arrangement de ses branches de céleri, je me suis souvenu que mon ami tenait toujours le cadre de chevrons, et le connaissant, je savais qu’il serait toujours à la tâche, s’attendant à ce que tout le monde ait la considération qu’il avait lui-même. Je me suis précipité désespérément dans l’arrière-cour, et il était là, par terre. Il s’était effondré d’épuisement à force de tenir le lourd cadre en bois. Il ressemblait à une poupée de chiffon. Nous avons dû appeler ses amis pour donner un coup de main et hisser le cadre de chevrons – il ne pouvait plus le faire. Il a dû se coucher. Il était sûr d’avoir une hernie.
L’histoire classique à propos d’Ernest Lipton est qu’un jour, il est parti en randonnée pour le week-end dans les montagnes de San Bernardino avec des amis. Ils ont campé dans les montagnes pour la nuit. Pendant que tout le monde dormait, Ernest Lipton est allé dans les buissons et, étant un homme si prévenant, il s’est éloigné du camp pour ne déranger personne. Il a glissé dans l’obscurité et a dévalé le flanc de la montagne. Il a raconté à ses amis par la suite qu’il savait avec certitude qu’il tombait vers la mort au fond de la vallée. Il a eu de la chance de s’agripper à une corniche du bout des doigts ; il s’y est tenu pendant des heures, cherchant dans le noir avec ses pieds un quelconque soutien, car ses bras étaient sur le point de céder – il allait s’accrocher jusqu’à la mort. En étendant ses jambes aussi largement que possible, il a trouvé de minuscules protubérances dans la roche qui l’ont aidé à tenir. Il est resté collé à la roche, comme les décalcomanies qu’il fabriquait, jusqu’à ce qu’il y ait assez de lumière pour qu’il se rende compte qu’il n’était qu’à un pied du sol.
« Ernest, tu aurais pu crier à l’aide ! » se sont plaints ses amis.
« Mince, je ne pensais pas que ça servirait à quelque chose », a-t-il répondu. « Qui aurait pu m’entendre ? Je pensais avoir dévalé au moins un mile dans la vallée. De plus, tout le monde dormait. »
Le coup de grâce est venu pour moi quand Ernest Lipton, qui passait deux heures par jour à faire la navette entre sa maison et l’atelier, a décidé d’acheter une voiture économique, une Coccinelle Volkswagen, et a commencé à mesurer combien de miles il parcourait par gallon d’essence. J’ai été extrêmement surpris quand il a annoncé un matin qu’il avait atteint 125 miles par gallon. Étant un homme très exact, il a nuancé sa déclaration, disant que la plupart de sa conduite ne se faisait pas en ville, mais sur l’autoroute, bien qu’à l’heure de pointe, il devait souvent ralentir et accélérer. Une semaine plus tard, il a dit qu’il avait atteint la barre des 250 miles par gallon.
Cet événement merveilleux a escaladé jusqu’à ce qu’il atteigne un chiffre incroyable : 645 miles par gallon. Ses amis lui ont dit qu’il devrait inscrire ce chiffre dans les registres de la société Volkswagen. Ernest Lipton était ravi et se vantait, disant qu’il ne saurait pas quoi faire s’il atteignait la barre des mille miles. Ses amis lui ont dit qu’il devrait revendiquer un miracle.
Cette situation extraordinaire s’est poursuivie jusqu’à un matin où il a surpris un de ses amis, qui depuis des mois lui jouait la plus vieille blague du monde, en ajoutant de l’essence à son réservoir. Chaque matin, il avait ajouté trois ou quatre tasses de sorte que la jauge d’essence d’Ernest n’était jamais sur vide.
Ernest Lipton était presque en colère. Son commentaire le plus sévère fut : « Mince ! C’est censé être drôle ? »
Je savais depuis des semaines que ses amis lui jouaient ce tour, mais j’étais incapable d’intervenir. Je sentais que ce n’était pas mes affaires. Les personnes qui jouaient le tour à Ernest Lipton étaient ses amis de toujours. J’étais un nouveau venu. Quand j’ai vu son regard de déception et de douleur, et son incapacité à se mettre en colère, j’ai ressenti une vague de culpabilité et d’anxiété. J’affrontais à nouveau un vieil ennemi. Je méprisais Ernest Lipton, et en même temps, je l’aimais immensément. Il était impuissant.
La vérité, c’est qu’Ernest Lipton ressemblait à mon père. Ses lunettes épaisses et sa calvitie naissante, ainsi que la barbe grisonnante qu’il n’arrivait jamais à raser complètement, me rappelaient les traits de mon père. Il avait le même nez droit et pointu et le même menton pointu. Mais voir l’incapacité d’Ernest Lipton à se mettre en colère et à frapper les farceurs au nez est ce qui a vraiment scellé sa ressemblance avec mon père pour moi et l’a poussé au-delà du seuil de sécurité.
Je me suis souvenu comment mon père était follement amoureux de la sœur de son meilleur ami. Je l’ai aperçue un jour dans une station balnéaire, main dans la main avec un jeune homme. Sa mère était avec elle comme chaperon. La fille semblait si heureuse. Les deux jeunes gens se regardaient, ravis. D’après ce que je pouvais voir, c’était le jeune amour à son meilleur. Quand j’ai vu mon père, je lui ai dit, savourant chaque instant de mon récit avec toute la méchanceté de mes dix ans, que sa petite amie avait un vrai petit ami. Il a été décontenancé. Il ne me croyait pas.
« Mais as-tu dit quoi que ce soit à la fille ? » lui ai-je demandé audacieusement. « Sait-elle que tu es amoureux d’elle ? »
« Ne sois pas stupide, petit salaud ! » m’a-t-il lancé. « Je n’ai pas à dire de merde de ce genre à une femme ! » Comme un enfant gâté, il m’a regardé d’un air pétulant, les lèvres tremblantes de rage. « Elle est à moi ! Elle devrait savoir qu’elle est ma femme sans que j’aie à lui dire quoi que ce soit ! »
Il a déclaré tout cela avec la certitude d’un enfant qui a tout eu dans la vie sans avoir à se battre pour cela.
Au sommet de ma forme, j’ai porté mon coup de grâce. « Eh bien », dis-je, « je pense qu’elle s’attendait à ce que quelqu’un le lui dise, et quelqu’un vient de te devancer. »
J’étais prêt à sauter hors de sa portée et à courir parce que je pensais qu’il me frapperait avec toute la fureur du monde, mais au lieu de cela, il s’est effondré et a commencé à pleurer. Il m’a demandé, sanglotant de manière incontrôlable, que puisque j’étais capable de tout, si je voulais bien espionner la fille pour lui et lui dire ce qui se passait.
Je méprisais mon père au-delà de tout ce que je pouvais dire, et en même temps je l’aimais, avec une tristesse inégalée. Je me suis maudit d’avoir précipité cette honte sur lui.
Ernest Lipton me rappelait tellement mon père que j’ai quitté mon travail, prétextant que je devais retourner à l’école. Je ne voulais pas augmenter le fardeau que je portais déjà sur mes épaules. Je ne m’étais jamais pardonné d’avoir causé cette angoisse à mon père, et je ne lui avais jamais pardonné d’avoir été si lâche.
Je suis retourné à l’école et j’ai commencé la tâche gigantesque de me réintégrer dans mes études d’anthropologie. Ce qui a rendu cette réintégration très difficile, c’est le fait que s’il y avait quelqu’un avec qui j’aurais pu travailler avec facilité et plaisir en raison de son admirable doigté, de sa curiosité audacieuse et de sa volonté d’élargir ses connaissances sans s’énerver ni défendre des points indéfendables, c’était quelqu’un en dehors de mon département, un archéologue. C’est grâce à son influence que je m’étais intéressé au travail de terrain en premier lieu. Peut-être parce qu’il allait littéralement sur le terrain pour déterrer des informations, son pragmatisme était une oasis de sobriété pour moi. Il était le seul à m’avoir encouragé à aller de l’avant et à faire du travail de terrain parce que je n’avais rien à perdre.
« Perdez tout, et vous gagnerez tout », m’a-t-il dit une fois, le conseil le plus judicieux que j’aie jamais reçu dans le monde universitaire. Si je suivais le conseil de don Juan, et que je travaillais à corriger mon obsession de l’auto-réflexion, je n’avais véritablement rien à perdre et tout à gagner. Mais cette possibilité n’était pas dans les cartes pour moi à cette époque.
Quand j’ai parlé à don Juan de la difficulté que je rencontrais à trouver un professeur avec qui travailler, j’ai pensé que sa réaction à ce que j’avais dit était vicieuse. Il m’a traité de petit con, et pire encore. Il m’a dit ce que je savais déjà : que si je n’étais pas si tendu, j’aurais pu travailler avec succès avec n’importe qui dans le monde universitaire, ou dans les affaires.
« Les guerriers-voyageurs ne se plaignent pas », a poursuivi don Juan. « Ils prennent tout ce que l’infini leur tend comme un défi. Un défi est un défi. Ce n’est pas personnel. On ne peut pas le prendre comme une malédiction ou une bénédiction. Un guerrier-voyageur soit remporte le défi, soit le défi le démolit. C’est plus excitant de gagner, alors gagnez ! »
Je lui ai dit que c’était facile pour lui ou pour n’importe qui d’autre de dire ça, mais que le mettre en pratique était une autre affaire, et que mes tribulations étaient insolubles parce qu’elles provenaient de l’incapacité de mes semblables à être cohérents.
« Ce ne sont pas les gens autour de vous qui sont en faute », dit-il. « Ils ne peuvent pas s’en empêcher. La faute est la vôtre, parce que vous pouvez vous aider, mais vous êtes déterminé à les juger, à un niveau profond de silence. N’importe quel idiot peut juger. Si vous les jugez, vous n’obtiendrez que le pire d’eux. Nous tous, êtres humains, sommes des prisonniers, et c’est cette prison qui nous fait agir d’une manière si misérable. Votre défi est de prendre les gens tels qu’ils sont ! Laissez les gens tranquilles. »
« Vous avez absolument tort cette fois, don Juan », dis-je. « Croyez-moi, je n’ai aucun intérêt à les juger, ou à m’emmêler avec eux de quelque manière que ce soit. »
« Vous comprenez très bien de quoi je parle », a-t-il insisté obstinément. « Si vous n’êtes pas conscient de votre désir de les juger », a-t-il poursuivi, « vous êtes dans une situation encore pire que je ne le pensais. C’est le défaut des guerriers-voyageurs lorsqu’ils reprennent leurs voyages. Ils deviennent arrogants, incontrôlables. »
J’ai admis à don Juan que mes plaintes étaient mesquines à l’extrême. Je le savais bien. Je lui ai dit que j’étais confronté à des événements quotidiens, des événements qui avaient la qualité néfaste d’user toute ma résolution, et que j’étais gêné de relater à don Juan les incidents qui pesaient lourdement sur mon esprit.
« Allez », m’a-t-il exhorté. « Dites-le ! Ne me cachez rien. Je suis un tube vide. Tout ce que vous me direz sera projeté dans l’infini. »
« Tout ce que j’ai, ce sont de misérables plaintes », dis-je. « Je suis exactement comme toutes les personnes que je connais. Il n’y a aucun moyen de parler à l’une d’entre elles sans entendre une plainte ouverte ou secrète. »
J’ai raconté à don Juan comment, même dans les dialogues les plus simples, mes amis parvenaient à glisser un nombre infini de plaintes, comme dans un dialogue comme celui-ci :
« Comment ça va, Jim ? »
« Oh, bien, bien, Cal. » Un énorme silence suivrait.
Je serais obligé de dire : « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, Jim ? »
« Non ! Tout va bien. J’ai un petit problème avec Mel, mais tu sais comment est Mel – égoïste et merdique. Mais il faut prendre ses amis comme ils viennent, n’est-ce pas ? Il pourrait, bien sûr, avoir un peu plus de considération. Mais qu’est-ce que ça peut foutre. Il est lui-même. Il te met toujours le fardeau sur les épaules – prends-moi ou laisse-moi. Il fait ça depuis qu’on a douze ans, donc c’est vraiment de ma faute. Pourquoi diable dois-je le supporter ? »
« Eh bien, tu as raison, Jim, tu sais que Mel est très dur, oui. Ouais ! »
« Eh bien, en parlant de gens merdiques, tu n’es pas mieux que Mel, Cal. Je ne peux jamais compter sur toi », etc.
Un autre dialogue classique était :
« Comment ça va, Alex ? Comment va ta vie de marié ? »
« Oh, super. Pour la première fois, je mange à heures fixes, des repas faits maison, mais je grossis. Il n’y a rien à faire pour moi à part regarder la télé. J’avais l’habitude de sortir avec vous, les gars, mais maintenant je ne peux plus. Theresa ne me laisse pas. Bien sûr, je pourrais lui dire d’aller se faire foutre, mais je ne veux pas la blesser. Je me sens content, mais misérable. »
Et Alex avait été le type le plus misérable avant de se marier. C’était lui dont la blague classique était de dire à ses amis, chaque fois que nous le rencontrions : « Hé, venez à ma voiture, je veux vous présenter ma salope. »
Il s’amusait comme un fou de nos attentes déçues quand nous voyions que ce qu’il avait dans sa voiture était une chienne. Il a présenté sa « salope » à tous ses amis. Nous avons été choqués quand il a réellement épousé Theresa, une coureuse de fond. Ils se sont rencontrés lors d’un marathon quand Alex s’est évanoui. Ils étaient dans les montagnes, et Theresa a dû le ranimer par tous les moyens, alors elle lui a pissé sur le visage. Après ça, Alex était son prisonnier. Elle avait marqué son territoire. Ses amis disaient : « Son prisonnier pissé ». Ses amis pensaient qu’elle était la vraie salope qui avait transformé l’étrange Alex en un gros chien.
Don Juan et moi avons ri un moment. Puis il m’a regardé avec une expression sérieuse.
« Ce sont les hauts et les bas de la vie quotidienne », dit don Juan. « On gagne, et on perd, et on ne sait pas quand on gagne ou quand on perd. C’est le prix à payer pour vivre sous la règle de l’auto-réflexion. Il n’y a rien que je puisse vous dire, et il n’y a rien que vous puissiez vous dire à vous-même. Je pourrais seulement vous recommander de ne pas vous sentir coupable parce que vous êtes un connard, mais que vous vous efforciez de mettre fin à la domination de l’auto-réflexion. Retournez à l’école. N’abandonnez pas encore. »
Mon intérêt à rester dans le monde universitaire diminuait considérablement. J’ai commencé à vivre en pilote automatique. Je me sentais lourd, abattu. Cependant, j’ai remarqué que mon esprit n’était pas impliqué. Je ne calculais rien, ni ne fixais d’objectifs ou d’attentes de quelque sorte que ce soit. Mes pensées n’étaient pas obsessionnelles, mais mes sentiments l’étaient. J’ai essayé de conceptualiser cette dichotomie entre un esprit calme et des sentiments turbulents. C’est dans cet état d’esprit sans pensées et de sentiments submergés que j’ai marché un jour de Haines Hall, où se trouvait le département d’anthropologie, à la cafétéria pour déjeuner.
J’ai été soudainement assailli par un étrange tremblement. J’ai cru que j’allais m’évanouir, et je me suis assis sur des marches en brique. J’ai vu des taches jaunes devant mes yeux. J’ai eu la sensation que je tournais. J’étais sûr que j’allais avoir mal au ventre. Ma vision est devenue floue, et finalement je ne pouvais plus rien voir. Mon inconfort physique était si total et intense qu’il ne laissait aucune place à une seule pensée. Je n’avais que des sensations corporelles de peur et d’anxiété mêlées d’exaltation, et une étrange anticipation que j’étais au seuil d’un événement gigantesque. C’étaient des sensations sans la contrepartie de la pensée. À un moment donné, je ne savais plus si j’étais assis ou debout. J’étais entouré de l’obscurité la plus impénétrable que l’on puisse imaginer, et puis, j’ai vu l’énergie telle qu’elle circule dans l’univers.
J’ai vu une succession de sphères lumineuses marchant vers moi ou s’éloignant de moi. Je les ai vues une par une, comme don Juan m’avait toujours dit qu’on les voyait. Je savais que c’étaient des individus différents à cause de leurs différences de taille. J’ai examiné les détails de leurs structures. Leur luminosité et leur rondeur étaient faites de fibres qui semblaient être collées ensemble. C’étaient des fibres fines ou épaisses. Chacune de ces figures lumineuses avait un revêtement épais et hirsute. Elles ressemblaient à d’étranges animaux lumineux et poilus, ou à de gigantesques insectes ronds couverts de poils lumineux.
Ce qui a été le plus choquant pour moi, c’est la prise de conscience que j’avais vu ces insectes poilus toute ma vie. Chaque occasion où don Juan m’avait fait les voir délibérément m’a semblé à ce moment-là être comme un détour que j’avais pris avec lui. Je me suis souvenu de chaque instance de son aide pour me faire voir les gens comme des sphères lumineuses, et toutes ces instances étaient distinctes de la masse de vision à laquelle j’avais accès maintenant. J’ai alors su, au-delà de l’ombre d’un doute, que j’avais perçu l’énergie telle qu’elle circule dans l’univers toute ma vie, par moi-même, sans l’aide de personne. Une telle prise de conscience a été écrasante pour moi. Je me sentais infiniment vulnérable, frêle. J’avais besoin de chercher un abri, de me cacher quelque part. C’était exactement comme le rêve que la plupart d’entre nous semblent avoir à un moment ou à un autre, dans lequel nous nous retrouvons nus et ne savons pas quoi faire. Je me sentais plus que nu ; je me sentais sans protection, faible, et je redoutais de retourner à mon état normal. D’une manière vague, j’ai senti que j’étais allongé. Je me suis préparé à mon retour à la normalité. J’ai conçu l’idée que j’allais me retrouver allongé sur le trottoir en briques, tressaillant convulsivement, entouré d’un cercle entier de spectateurs.
La sensation que j’étais allongé est devenue de plus en plus accentuée. J’ai senti que je pouvais bouger les yeux. Je pouvais voir la lumière à travers mes paupières fermées, mais je redoutais de les ouvrir. La partie étrange était que je n’entendais aucune de ces personnes que j’imaginais être autour de moi. Je n’entendais aucun bruit du tout. Finalement, j’ai osé ouvrir les yeux. J’étais sur mon lit, dans mon appartement de bureau au coin des boulevards Wilshire et Westwood.
Je suis devenu assez hystérique en me retrouvant dans mon lit. Mais pour une raison qui dépassait ma compréhension, je me suis calmé presque immédiatement. Mon hystérie a été remplacée par une indifférence corporelle, ou par un état de satisfaction corporelle, quelque chose comme ce que l’on ressent après un bon repas. Cependant, je ne pouvais pas calmer mon esprit. C’avait été la chose la plus choquante imaginable pour moi de réaliser que j’avais perçu l’énergie directement toute ma vie. Comment diable était-il possible que je ne l’aie pas su ? Qu’est-ce qui m’avait empêché d’accéder à cette facette de mon être ? Don Juan avait dit que chaque être humain a le potentiel de voir l’énergie directement. Ce qu’il n’avait pas dit, c’est que chaque être humain voit déjà l’énergie directement mais ne le sait pas.
J’ai posé cette question à un ami psychiatre. Il n’a pu jeter aucune lumière sur mon dilemme. Il pensait que ma réaction était le résultat de la fatigue et de la surstimulation. Il m’a donné une ordonnance de Valium et m’a dit de me reposer. Je n’avais osé mentionner à personne que je m’étais réveillé dans mon lit sans pouvoir expliquer comment j’y étais arrivé. Par conséquent, ma hâte de voir don Juan était plus que justifiée. J’ai pris l’avion pour Mexico dès que j’ai pu, j’ai loué une voiture et j’ai conduit jusqu’à l’endroit où il vivait.
« Vous avez déjà fait tout ça ! » dit don Juan en riant, quand je lui ai raconté mon expérience ahurissante. « Il n’y a que deux choses de nouvelles. L’une est que maintenant vous avez perçu l’énergie tout seul. Ce que vous avez fait, c’est arrêter le monde, et puis vous avez réalisé que vous avez toujours vu l’énergie telle qu’elle circule dans l’univers, comme le fait tout être humain, mais sans le savoir délibérément. L’autre chose nouvelle, c’est que vous avez voyagé depuis votre silence intérieur tout seul. »
« Vous savez, sans que j’aie à vous le dire, que tout est possible si l’on part du silence intérieur. Cette fois, votre peur et votre vulnérabilité ont permis que vous vous retrouviez dans votre lit, ce qui n’est pas si loin du campus de l’UCLA. Si vous ne vous complaisiez pas dans votre surprise, vous réaliseriez que ce que vous avez fait n’est rien, rien d’extraordinaire pour un guerrier-voyageur. »
« Mais la question de la plus haute importance n’est pas de savoir que vous avez toujours perçu l’énergie directement, ou votre voyage depuis le silence intérieur, mais plutôt une affaire double. Premièrement, vous avez expérimenté quelque chose que les sorciers de l’ancien Mexique appelaient la vue claire, ou perdre la forme humaine : le moment où la mesquinerie humaine s’évanouit, comme si c’était un banc de brouillard planant au-dessus de nous, un brouillard qui s’éclaircit lentement et se dissipe. Mais en aucun cas vous ne devez croire que c’est un fait accompli. Le monde des sorciers n’est pas un monde immuable comme le monde de la vie quotidienne, où l’on vous dit qu’une fois que vous avez atteint un but, vous restez un gagnant pour toujours. Dans le monde des sorciers, arriver à un certain but signifie que vous avez simplement acquis les outils les plus efficaces pour continuer votre combat, qui, soit dit en passant, ne finira jamais. »
« La deuxième partie de cette double affaire est que vous avez expérimenté la question la plus exaspérante pour le cœur des êtres humains. Vous l’avez exprimée vous-même lorsque vous vous êtes posé les questions : « Comment diable était-il possible que je ne sache pas que j’avais perçu l’énergie directement toute ma vie ? Qu’est-ce qui m’avait empêché d’accéder à cette facette de mon être ? » »
(Carlos Castaneda, Le Voyage Définitif)