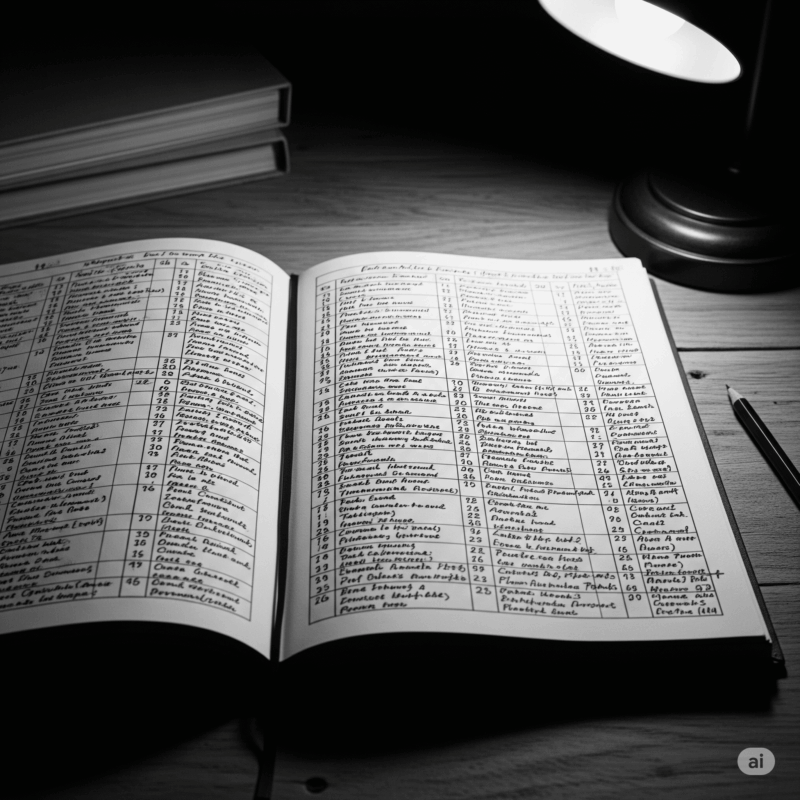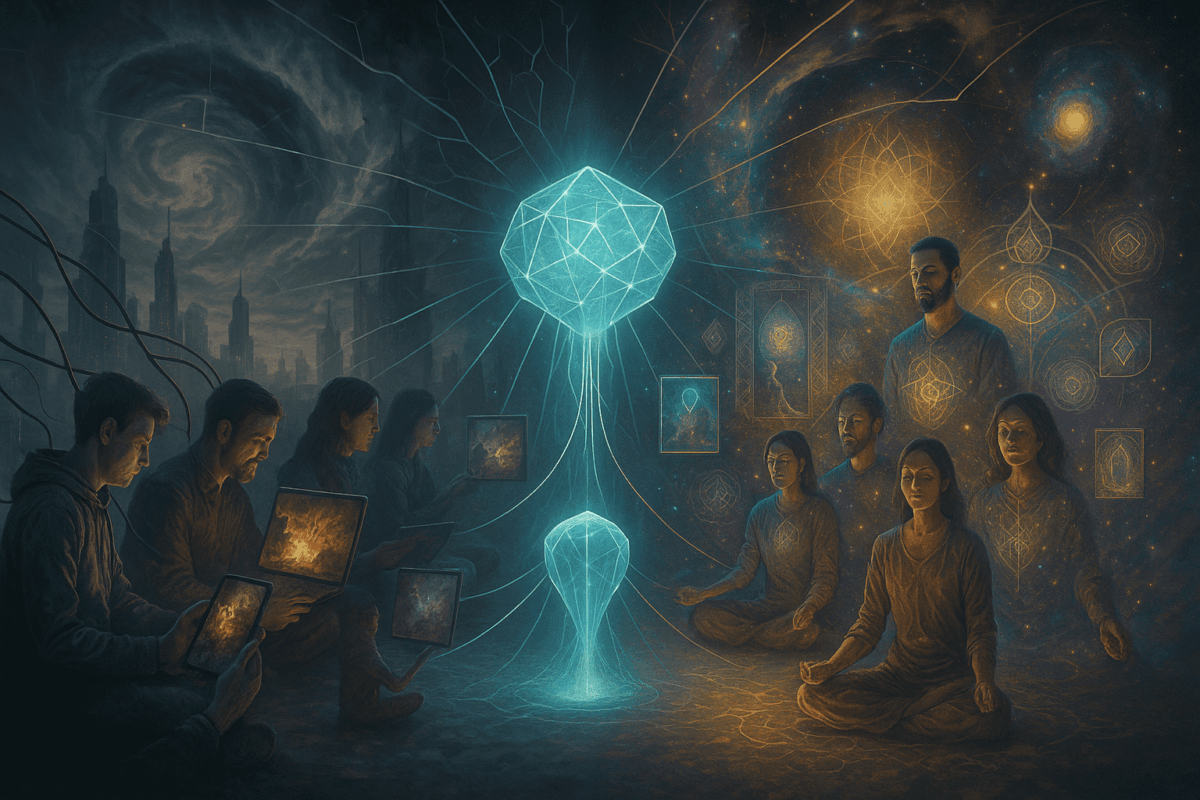Ce livre est une collection des événements mémorables de ma vie. Don Juan m’a révélé au fil du temps que les chamans de l’ancien Mexique avaient conçu cette collection d’événements mémorables comme un véritable dispositif pour remuer des caches d’énergie qui existent en soi. Ils expliquaient que ces caches étaient composées d’énergie provenant du corps lui-même et qui se trouve déplacée, mise hors de portée par les circonstances de notre vie quotidienne. En ce sens, la collection d’événements mémorables était, pour don Juan et les chamans de sa lignée, le moyen de redéployer leur énergie inutilisée.
Je les ai rassemblés en suivant la recommandation de don Juan Matus, un chaman indien Yaqui du Mexique qui, en tant qu’enseignant, s’est efforcé pendant treize ans de me rendre accessible le monde cognitif des chamans qui vivaient au Mexique dans les temps anciens. La suggestion de don Juan Matus de rassembler cette collection d’événements mémorables a été faite comme si c’était quelque chose de fortuit, quelque chose qui lui était venu à l’esprit sur le coup. C’était le style d’enseignement de don Juan. Il voilait l’importance de certaines manœuvres derrière le banal. Il cachait, de cette manière, le piquant de la finalité, le présentant comme quelque chose qui ne différait en rien des préoccupations de la vie de tous les jours.
Don Juan m’a révélé au fil du temps que les chamans de l’ancien Mexique avaient conçu cette collection d’événements mémorables comme un véritable dispositif pour remuer des caches d’énergie qui existent en soi. Ils expliquaient que ces caches étaient composées d’énergie provenant du corps lui-même et qui se trouve déplacée, mise hors de portée par les circonstances de notre vie quotidienne. En ce sens, la collection d’événements mémorables était, pour don Juan et les chamans de sa lignée, le moyen de redéployer leur énergie inutilisée.
La condition préalable à cette collection était l’acte authentique et dévorant de rassembler la somme totale de ses émotions et de ses réalisations, sans rien épargner. Selon don Juan, les chamans de sa lignée étaient convaincus que la collection d’événements mémorables était le véhicule de l’ajustement émotionnel et énergétique nécessaire pour s’aventurer, en termes de perception, dans l’inconnu.
Don Juan a décrit le but ultime de la connaissance chamanique qu’il maîtrisait comme étant la préparation à affronter le voyage définitif : le voyage que chaque être humain doit entreprendre à la fin de sa vie. Il disait que, par leur discipline et leur résolution, les chamans étaient capables de conserver leur conscience et leur but individuels après la mort. Pour eux, l’état vague et idéaliste que l’homme moderne appelle « la vie après la mort » était une région concrète remplie à ras bord d’affaires pratiques d’un ordre différent des affaires pratiques de la vie quotidienne, mais ayant une praticité fonctionnelle similaire. Don Juan considérait que rassembler les événements mémorables de leur vie était, pour les chamans, la préparation à leur entrée dans cette région concrète qu’ils appelaient le côté actif de l’infini.
Un après-midi, don Juan et moi parlions sous sa ramada, une structure légère faite de minces poteaux de bambou. Cela ressemblait à un porche couvert, partiellement ombragé du soleil, mais qui n’offrirait aucune protection contre la pluie. Il y avait là quelques petites boîtes de transport robustes qui servaient de bancs. Leurs marques de transport étaient estompées et semblaient plus ornementales qu’identificatrices. J’étais assis sur l’une d’elles, le dos contre le mur avant de la maison. Don Juan était assis sur une autre boîte, appuyé contre un poteau qui soutenait la ramada. Je venais d’arriver en voiture quelques minutes plus tôt. La journée de route avait été longue, par un temps chaud et humide. J’étais nerveux, agité et en sueur.
Don Juan a commencé à me parler dès que je me suis confortablement installé sur la boîte. Avec un large sourire, il a commenté que les personnes en surpoids ne savaient presque jamais comment combattre la graisse. Le sourire qui jouait sur ses lèvres me laissa entendre qu’il n’était pas facétieux. Il me faisait simplement remarquer, de la manière la plus directe et en même temps indirecte, que j’étais en surpoids. Je suis devenu si nerveux que j’ai fait basculer la boîte sur laquelle j’étais assis et mon dos a heurté très fort le mince mur de la maison. L’impact a secoué la maison jusqu’à ses fondations. Don Juan m’a regardé d’un air interrogateur, mais au lieu de me demander si j’allais bien, il m’a assuré que je n’avais pas fissuré la maison. Puis il m’a expliqué longuement que sa maison était une demeure temporaire pour lui, qu’il vivait en réalité ailleurs. Quand je lui ai demandé où il vivait vraiment, il m’a dévisagé. Son regard n’était pas belliqueux ; c’était plutôt une ferme dissuasion aux questions déplacées. Je n’ai pas compris ce qu’il voulait. J’étais sur le point de reposer la même question, mais il m’a arrêté.
« Ce genre de questions ne se pose pas par ici », dit-il fermement. « Demande tout ce que tu veux sur les procédures ou les idées. Quand je serai prêt à te dire où je vis, si jamais je le suis, je te le dirai, sans que tu aies à me le demander. »
Je me suis immédiatement senti rejeté. Mon visage est devenu rouge involontairement. J’étais définitivement offensé. L’éclat de rire de don Juan a immensément ajouté à mon chagrin. Non seulement il m’avait rejeté, mais il m’avait insulté et ensuite s’était moqué de moi.
« Je vis ici temporairement », continua-t-il, indifférent à ma mauvaise humeur, « parce que c’est un centre magique. En fait, je vis ici à cause de toi. »
Cette déclaration m’a décontenancé. Je ne pouvais pas le croire. Je pensais qu’il disait probablement cela pour apaiser mon irritation d’avoir été insulté. « Est-ce que tu vis vraiment ici à cause de moi ? » lui ai-je finalement demandé, incapable de contenir ma curiosité.
« Oui », dit-il d’un ton égal. « Je dois te préparer. Tu es comme moi. Je vais te répéter maintenant ce que je t’ai déjà dit : la quête de chaque nagual, ou chef, dans chaque génération de chamans, ou sorciers, est de trouver un nouvel homme ou une nouvelle femme qui, comme lui, montre une double structure énergétique ; j’ai vu cette caractéristique en toi lorsque nous étions à la gare routière de Nogales. Quand je vois ton énergie, je vois deux boules de luminosité superposées, l’une sur l’autre, et cette caractéristique nous lie. Je ne peux pas plus te refuser que tu ne peux me refuser. »
Ses paroles ont provoqué en moi une agitation des plus étranges. Un instant auparavant j’étais en colère, maintenant j’avais envie de pleurer. Il a poursuivi en disant qu’il voulait m’initier à quelque chose que les chamans appelaient la voie du guerrier, soutenu par la force de la région où il vivait, qui était le centre d’émotions et de réactions très fortes. Des peuples guerriers y avaient vécu pendant des milliers d’années, imprégnant la terre de leur préoccupation pour la guerre.
Il vivait à cette époque dans l’État de Sonora, dans le nord du Mexique, à environ cent miles au sud de la ville de Guaymas. J’allais toujours lui rendre visite là-bas sous le prétexte de mener mon travail de terrain.
« Ai-je besoin d’entrer en guerre, don Juan ? » ai-je demandé, sincèrement inquiet après qu’il eut déclaré que la préoccupation pour la guerre était quelque chose dont j’aurais besoin un jour. J’avais déjà appris à prendre tout ce qu’il disait avec le plus grand sérieux.
« Tu peux en être sûr », répondit-il en souriant. « Quand tu auras absorbé tout ce qu’il y a à absorber dans cette région, je déménagerai. »
Je n’avais aucune raison de douter de ce qu’il disait, mais je ne pouvais pas l’imaginer vivre ailleurs. Il faisait absolument partie de tout ce qui l’entourait. Sa maison, cependant, semblait en effet être une demeure temporaire. C’était une cabane typique des fermiers Yaquis ; elle était faite de torchis et de pisé avec un toit plat de chaume ; elle avait une grande pièce pour manger et dormir et une cuisine sans toit.
« C’est très difficile de traiter avec les personnes en surpoids », dit-il.
Cela semblait être un coq-à-l’âne, mais ce n’en était pas un. Don Juan revenait simplement au sujet qu’il avait abordé avant que je ne l’interrompe en me cognant le dos contre le mur de sa maison.
« Il y a une minute, tu as heurté ma maison comme une boule de démolition », dit-il en secouant lentement la tête. « Quel impact ! Un impact digne d’un homme corpulent. »
J’ai eu le sentiment inconfortable qu’il me parlait du point de vue de quelqu’un qui avait renoncé à moi. J’ai immédiatement adopté une attitude défensive. Il écouta, avec un sourire en coin, mes explications frénétiques selon lesquelles mon poids était normal pour ma structure osseuse.
« C’est vrai », concéda-t-il facétieusement. « Tu as de gros os. Tu pourrais probablement porter trente livres de plus avec une grande facilité et personne, je t’assure, personne, ne le remarquerait. Moi, je ne le remarquerais pas. »
Son sourire moqueur me dit que j’étais définitivement grassouillet. Il m’a ensuite interrogé sur ma santé en général, et j’ai continué à parler, essayant désespérément d’éviter tout autre commentaire sur mon poids. Il a changé de sujet lui-même.
« Quoi de neuf concernant tes excentricités et tes aberrations ? » demanda-t-il avec une expression impassible.
J’ai stupidement répondu qu’elles allaient bien. « Excentricités et aberrations » était la façon dont il qualifiait mon intérêt pour la collection. À cette époque, j’avais repris avec un zèle renouvelé quelque chose que j’avais aimé faire toute ma vie : collectionner tout ce qui était collectionnable. Je collectionnais des magazines, des timbres, des disques, des articles de la Seconde Guerre mondiale tels que des poignards, des casques militaires, des drapeaux, etc.
« Tout ce que je peux te dire, don Juan, à propos de mes aberrations, c’est que j’essaie de vendre mes collections », dis-je avec l’air d’un martyr forcé de faire quelque chose d’odieux.
« Être collectionneur n’est pas une si mauvaise idée », dit-il comme s’il le croyait vraiment. « Le nœud du problème n’est pas que tu collectionnes, mais ce que tu collectionnes. Tu collectionnes des vieilleries, des objets sans valeur qui t’emprisonnent aussi sûrement que ton chien de compagnie. Tu ne peux pas simplement partir si tu dois t’occuper de ton animal ou si tu dois t’inquiéter de ce qu’il adviendrait de tes collections si tu n’étais pas là. »
« Je cherche sérieusement des acheteurs, don Juan, crois-moi », ai-je protesté.
« Non, non, non, ne crois pas que je t’accuse de quoi que ce soit », rétorqua-t-il. « En fait, j’aime ton esprit de collectionneur. Je n’aime tout simplement pas tes collections, c’est tout. J’aimerais, cependant, faire appel à ton œil de collectionneur. J’aimerais te proposer une collection qui en vaille la peine. »
Don Juan fit une longue pause. Il semblait chercher ses mots ; ou peut-être n’était-ce qu’une hésitation dramatique et bien placée. Il me regarda avec un regard profond et pénétrant. « Chaque guerrier, par devoir, collectionne un album spécial », poursuivit don Juan, « un album qui révèle la personnalité du guerrier, un album qui atteste des circonstances de sa vie. »
« Pourquoi appelles-tu cela une collection, don Juan ? » demandai-je d’un ton argumentatif. « Ou un album, d’ailleurs ? »
« Parce que c’est les deux », rétorqua-t-il. « Mais par-dessus tout, c’est comme un album de photos faites de souvenirs, des photos faites à partir du souvenir d’événements mémorables. »
« Ces événements mémorables sont-ils mémorables d’une manière spécifique ? » ai-je demandé.
« Ils sont mémorables parce qu’ils ont une signification particulière dans la vie de quelqu’un », dit-il. « Ma proposition est que tu assembles cet album en y mettant le récit complet de divers événements qui ont eu une profonde signification pour toi. »
« Chaque événement de ma vie a eu une profonde signification pour moi, don Juan ! » dis-je avec force, et je sentis instantanément l’impact de ma propre suffisance.
« Pas vraiment », répondit-il en souriant, appréciant apparemment immensément mes réactions. « Tous les événements de ta vie n’ont pas eu une profonde signification pour toi. Il y en a quelques-uns, cependant, que je considérerais comme susceptibles d’avoir changé les choses pour toi, d’avoir illuminé ton chemin. Ordinairement, les événements qui changent notre chemin sont des affaires impersonnelles, et pourtant extrêmement personnelles. »
« Je n’essaie pas d’être difficile, don Juan, mais crois-moi, tout ce qui m’est arrivé répond à ces qualifications », dis-je, sachant que je mentais.
Immédiatement après avoir exprimé cette déclaration, j’ai voulu m’excuser, mais don Juan ne m’a pas prêté attention. C’était comme si je n’avais rien dit.
« Ne pense pas à cet album en termes de banalités, ou en termes d’un ressassement trivial de tes expériences de vie », dit-il.
Je pris une profonde inspiration, fermai les yeux et essayai de calmer mon esprit. Je me parlais frénétiquement de mon problème insoluble : je n’aimais très certainement pas du tout rendre visite à don Juan. En sa présence, je me sentais menacé. Il m’abordait verbalement et ne me laissait aucune place pour montrer ma valeur. Je détestais perdre la face chaque fois que j’ouvrais la bouche ; je détestais être le sot. Mais il y avait une autre voix en moi, une voix qui venait d’une plus grande profondeur, plus lointaine, presque faible. Au milieu de mes barrages de dialogues connus, je m’entendais dire qu’il était trop tard pour que je fasse marche arrière. Mais ce n’était pas vraiment ma voix ou mes pensées que j’expérimentais ; c’était plutôt comme une voix inconnue qui disait que j’étais trop avancé dans le monde de don Juan, et que j’avais plus besoin de lui que de l’air que je respirais.
« Dis tout ce que tu veux », la voix semblait me dire, « mais si tu n’étais pas l’égomane que tu es, tu ne serais pas si chagriné. »
« C’est la voix de ton autre mental », dit don Juan, comme s’il avait écouté ou lu mes pensées.
Mon corps sursauta involontairement. Ma frayeur fut si intense que des larmes me vinrent aux yeux. J’ai avoué à don Juan toute la nature de mon trouble.
« Ton conflit est très naturel », dit-il. « Et crois-moi, je ne l’exacerbe pas tant que ça. Je ne suis pas du genre. J’ai quelques histoires à te raconter sur ce que mon maître, le nagual Julian, me faisait. Je le détestais de tout mon être. J’étais très jeune, et je voyais comment les femmes l’adoraient, se donnaient à lui comme rien, et quand j’essayais de leur dire bonjour, elles se retournaient contre moi comme des lionnes, prêtes à me mordre la tête. Elles haïssaient mes tripes et l’aimaient. Comment penses-tu que je me sentais ? »
« Comment as-tu résolu ce conflit, don Juan ? » ai-je demandé avec un intérêt plus que sincère.
« Je n’ai rien résolu », a-t-il déclaré. « Le conflit, ou quoi que ce soit, était le résultat de la bataille entre mes deux mentals. Chacun de nous, êtres humains, a deux mentals. L’un est totalement nôtre, et c’est comme une voix faible qui nous apporte toujours l’ordre, la droiture, le but. L’autre mental est une installation étrangère. Il nous apporte le conflit, l’affirmation de soi, les doutes, le désespoir. »
Ma fixation sur mes propres concaténations mentales était si intense que j’ai complètement manqué ce que don Juan avait dit. Je pouvais me souvenir clairement de chacun de ses mots, mais ils n’avaient aucun sens pour moi. Don Juan, très calmement et en me regardant droit dans les yeux, répéta ce qu’il venait de dire. J’étais toujours incapable de saisir ce qu’il voulait dire. Je ne pouvais pas concentrer mon attention sur ses paroles.
« Pour une raison étrange, don Juan, je ne peux pas me concentrer sur ce que tu me dis », dis-je.
« Je comprends parfaitement pourquoi tu ne peux pas », dit-il en souriant largement, « et tu le comprendras aussi, un jour, en même temps que tu résoudras le conflit de savoir si tu m’aimes ou non, le jour où tu cesseras d’être le centre du monde moi-moi. »
« En attendant », continua-t-il, « mettons de côté le sujet de nos deux mentals et revenons à l’idée de préparer ton album d’événements mémorables. Je devrais ajouter qu’un tel album est un exercice de discipline et d’impartialité. Considère cet album comme un acte de guerre. »
L’affirmation de don Juan – que mon conflit d’aimer et de ne pas aimer le voir allait prendre fin dès que j’abandonnerais mon égocentrisme – n’était pas une solution pour moi. En fait, cette affirmation m’a rendu plus furieux ; elle m’a frustré encore plus. Et quand j’ai entendu don Juan parler de l’album comme d’un acte de guerre, je me suis déchaîné contre lui avec tout mon venin.
« L’idée que c’est une collection d’événements est déjà difficile à comprendre », dis-je d’un ton de protestation. « Mais qu’en plus de tout cela, tu appelles ça un album et que tu dises qu’un tel album est un acte de guerre, c’est trop pour moi. C’est trop obscur. Être obscur fait perdre son sens à la métaphore. »
« Comme c’est étrange ! C’est le contraire pour moi », répondit calmement don Juan. « Qu’un tel album soit un acte de guerre a tout le sens du monde pour moi. Je n’aimerais pas que mon album d’événements mémorables soit autre chose qu’un acte de guerre. »
Je voulais argumenter davantage mon point de vue et lui expliquer que je comprenais l’idée d’un album d’événements mémorables. Je m’opposais à la manière déroutante dont il le décrivait. Je me considérais à cette époque comme un défenseur de la clarté et du fonctionnalisme dans l’usage du langage.
Don Juan ne commenta pas mon humeur belliqueuse. Il secoua seulement la tête comme s’il était entièrement d’accord avec moi. Au bout d’un moment, soit j’ai complètement manqué d’énergie, soit j’en ai eu une poussée gigantesque. Tout à coup, sans aucun effort de ma part, j’ai réalisé la futilité de mes emportements. Je me suis senti infiniment embarrassé.
« Qu’est-ce qui me possède pour que j’agisse comme je le fais ? » demandai-je sérieusement à don Juan. À cet instant, j’étais complètement déconcerté. J’étais si secoué par ma prise de conscience que, sans aucune volonté de ma part, je me suis mis à pleurer.
« Ne t’inquiète pas des détails stupides », dit don Juan d’un ton rassurant. « Chacun de nous, homme et femme, est comme ça. »
« Veux-tu dire, don Juan, que nous sommes naturellement mesquins et contradictoires ? »
« Non, nous ne sommes pas naturellement mesquins et contradictoires », répondit-il. « Notre mesquinerie et nos contradictions sont plutôt le résultat d’un conflit transcendantal qui afflige chacun de nous, mais dont seuls les sorciers sont douloureusement et désespérément conscients : le conflit de nos deux mentals. »
Don Juan me scruta ; ses yeux étaient comme deux charbons noirs.
« Tu n’arrêtes pas de me parler de nos deux mentals », dis-je, « mais mon cerveau ne peut pas enregistrer ce que tu dis. Pourquoi ? »
« Tu sauras pourquoi en temps voulu », dit-il. « Pour l’instant, il suffira que je te répète ce que j’ai dit auparavant sur nos deux mentals. L’un est notre vrai mental, le produit de toutes nos expériences de vie, celui qui parle rarement parce qu’il a été vaincu et relégué dans l’obscurité. L’autre, le mental que nous utilisons quotidiennement pour tout ce que nous faisons, est une installation étrangère. »
« Je pense que le nœud du problème est que le concept du mental comme installation étrangère est si extravagant que mon mental refuse de le prendre au sérieux », dis-je, sentant que j’avais fait une réelle découverte.
Don Juan ne commenta pas ce que j’avais dit. Il continua d’expliquer la question des deux mentals comme si je n’avais pas dit un mot.
« Résoudre le conflit des deux mentals est une question d’intention », dit-il. « Les sorciers appellent l’intention en prononçant le mot intention haut et fort. L’intention est une force qui existe dans l’univers. Quand les sorciers appellent l’intention, elle vient à eux et établit le chemin de la réalisation, ce qui signifie que les sorciers accomplissent toujours ce qu’ils entreprennent. »
« Veux-tu dire, don Juan, que les sorciers obtiennent tout ce qu’ils veulent, même si c’est quelque chose de mesquin et d’arbitraire ? » ai-je demandé.
« Non, je ne voulais pas dire ça. L’intention peut être appelée, bien sûr, pour n’importe quoi », répondit-il, « mais les sorciers ont découvert, à leurs dépens, que l’intention ne vient à eux que pour quelque chose d’abstrait. C’est la soupape de sécurité pour les sorciers ; sinon, ils seraient insupportables. Dans ton cas, appeler l’intention pour résoudre le conflit de tes deux mentals, ou pour entendre la voix de ton vrai mental, n’est pas une affaire mesquine ou arbitraire. Bien au contraire ; c’est éthéré et abstrait, et pourtant aussi vital pour toi que tout peut l’être. »
Don Juan s’arrêta un moment ; puis il se remit à parler de l’album.
« Mon propre album, étant un acte de guerre, a exigé une sélection super-soigneuse », dit-il. « C’est maintenant une collection précise des moments inoubliables de ma vie, et de tout ce qui m’y a conduit. J’y ai concentré ce qui a été et sera significatif pour moi. À mon avis, l’album d’un guerrier est quelque chose de très concret, quelque chose de si pertinent que c’en est bouleversant. »
Je n’avais aucune idée de ce que don Juan voulait, et pourtant je le comprenais à la perfection. Il me conseilla de m’asseoir, seul, et de laisser mes pensées, mes souvenirs et mes idées venir à moi librement. Il me recommanda de faire un effort pour laisser la voix des profondeurs de moi parler et me dire quoi choisir. Don Juan me dit alors d’entrer dans la maison et de m’allonger sur un lit que j’avais là. Il était fait de caisses en bois et de douzaines de sacs de toile de jute vides qui servaient de matelas. Mon corps tout entier me faisait mal, et quand je me suis allongé sur le lit, c’était en fait extrêmement confortable.
Je pris ses suggestions à cœur et commençai à penser à mon passé, cherchant des événements qui m’avaient marqué. Je me suis vite rendu compte que mon affirmation selon laquelle chaque événement de ma vie avait été significatif était un non-sens. En me forçant à me souvenir, j’ai découvert que je ne savais même pas par où commencer. Des pensées et des souvenirs d’événements qui m’étaient arrivés défilaient sans fin dans mon esprit, mais je ne pouvais pas décider s’ils avaient eu ou non une quelconque signification pour moi. L’impression que j’ai eue était que rien n’avait eu la moindre importance. C’était comme si j’avais traversé la vie comme un cadavre capable de marcher et de parler, mais pas de ressentir quoi que ce soit. N’ayant aucune concentration pour poursuivre le sujet au-delà d’une tentative superficielle, j’ai abandonné et me suis endormi.
« As-tu eu du succès ? » me demanda don Juan lorsque je me suis réveillé des heures plus tard.
Au lieu d’être à l’aise après avoir dormi et me être reposé, j’étais de nouveau d’humeur maussade et belliqueuse.
« Non, je n’ai eu aucun succès ! » ai-je aboyé.
« As-tu entendu cette voix des profondeurs de toi ? » demanda-t-il.
« Je crois que oui », ai-je menti.
« Que t’a-t-elle dit ? » s’enquit-il d’un ton pressant.
« Je n’arrive pas à m’en souvenir, don Juan », ai-je marmonné.
« Ah, tu es de retour dans ton mental quotidien », dit-il en me tapant énergiquement dans le dos. « Ton mental quotidien a repris le dessus. Détends-le en parlant de ta collection d’événements mémorables. Je dois te dire que la sélection de ce qu’il faut mettre dans ton album n’est pas une mince affaire. C’est la raison pour laquelle je dis que faire cet album est un acte de guerre. Tu dois te refaire dix fois pour savoir quoi choisir. »
J’ai alors clairement compris, ne serait-ce que pour une seconde, que j’avais deux mentals ; cependant, la pensée était si vague que je l’ai perdue instantanément. Ce qui restait n’était que la sensation d’une incapacité à satisfaire l’exigence de don Juan. Au lieu d’accepter gracieusement mon incapacité, cependant, j’ai permis qu’elle devienne une affaire menaçante. La force motrice de ma vie, à cette époque, était de paraître toujours sous un bon jour. Être incompétent équivalait à être un perdant, quelque chose qui m’était totalement intolérable. Comme je ne savais pas comment répondre au défi que don Juan me posait, j’ai fait la seule chose que je savais faire : je me suis mis en colère.
« Il faut que je réfléchisse beaucoup plus à cela, don Juan », dis-je. « Il faut que je donne à mon esprit le temps de s’habituer à l’idée. »
« Bien sûr, bien sûr », m’assura don Juan. « Prends tout le temps du monde, mais dépêche-toi. »
Rien de plus ne fut dit sur le sujet à ce moment-là. À la maison, je l’ai complètement oublié jusqu’à un jour où, de manière assez abrupte, au milieu d’une conférence à laquelle j’assistais, l’ordre impérieux de rechercher les événements mémorables de ma vie m’a frappé comme une secousse corporelle, un spasme nerveux qui a secoué tout mon corps de la tête aux pieds.
J’ai commencé à travailler sérieusement. Il m’a fallu des mois pour ressasser des expériences de ma vie que je croyais significatives pour moi. Cependant, en examinant ma collection, j’ai réalisé que je ne traitais que d’idées sans aucune substance. Les événements dont je me souvenais n’étaient que de vagues points de référence que je me rappelais abstraitement. Une fois de plus, j’ai eu le soupçon le plus troublant que j’avais été élevé juste pour agir sans jamais m’arrêter pour ressentir quoi que ce soit.
L’un des événements les plus vagues dont je me souvenais, que je voulais rendre mémorable à tout prix, était le jour où j’ai découvert que j’avais été admis en troisième cycle à l’UCLA. J’avais beau essayer, je ne pouvais pas me souvenir de ce que j’avais fait ce jour-là. Il n’y avait rien d’intéressant ou d’unique ce jour-là, sauf l’idée qu’il devait être mémorable. Entrer en troisième cycle aurait dû me rendre heureux ou fier de moi, mais ce ne fut pas le cas.
Un autre échantillon de ma collection était le jour où j’ai failli me marier avec Kay Condor. Son nom de famille n’était pas vraiment Condor, mais elle l’avait changé parce qu’elle voulait être actrice. Son ticket pour la gloire était qu’elle ressemblait vraiment à Carole Lombard. Ce jour était mémorable dans mon esprit, non pas tant à cause des événements qui ont eu lieu mais parce qu’elle était belle et voulait m’épouser. Elle était plus grande que moi d’une tête, ce qui la rendait d’autant plus intéressante à mes yeux.
J’étais ravi à l’idée d’épouser une grande femme, lors d’une cérémonie à l’église. J’ai loué un smoking gris. Le pantalon était assez large pour ma taille. Ce n’étaient pas des pantalons à pattes d’éléphant ; ils étaient juste larges, et cela me dérangeait au plus haut point. Une autre chose qui m’ennuyait immensément était que les manches de la chemise rose que j’avais achetée pour l’occasion étaient trop longues d’environ trois pouces ; j’ai dû utiliser des élastiques pour les remonter. En dehors de cela, tout était parfait jusqu’au moment où les invités et moi avons découvert que Kay Condor avait eu la frousse et n’allait pas se présenter. Étant une jeune femme très convenable, elle m’avait envoyé un mot d’excuse par un coursier à moto. Elle écrivait qu’elle ne croyait pas au divorce et ne pouvait pas s’engager pour le reste de ses jours avec quelqu’un qui ne partageait pas tout à fait ses vues sur la vie. Elle m’a rappelé que je ricanai chaque fois que je disais le nom « Condor », ce qui montrait un manque total de respect pour sa personne. Elle disait qu’elle avait discuté de la question avec sa mère. Toutes deux m’aimaient tendrement, mais pas assez pour faire de moi un membre de leur famille. Elle a ajouté que, courageusement et sagement, nous devions tous limiter nos pertes.
Mon état d’esprit était celui d’un engourdissement total. Quand j’ai essayé de me souvenir de ce jour, je ne pouvais pas me rappeler si je m’étais senti horriblement humilié d’être resté planté devant une foule de gens dans mon smoking gris de location avec le pantalon à jambes larges, ou si j’étais anéanti parce que Kay Condor ne m’avait pas épousé.
C’étaient les deux seuls événements que j’étais capable d’isoler avec clarté. C’étaient de maigres exemples, mais après les avoir ressassés, j’avais réussi à les transformer en récits d’acceptation philosophique. Je me considérais comme un être qui traverse la vie sans vrais sentiments, qui n’a que des vues intellectuelles sur tout. Prenant les métaphores de don Juan comme modèles, j’en ai même construit une de mon cru : un être qui vit sa vie par procuration en fonction de ce qu’elle devrait être.
Je croyais, par exemple, que le jour où j’ai été admis en troisième cycle à l’UCLA aurait dû être un jour mémorable. Comme ce n’était pas le cas, j’ai fait de mon mieux pour lui insuffler une importance que j’étais loin de ressentir. Une chose similaire s’est produite avec le jour où j’ai failli épouser Kay Condor. Cela aurait dû être un jour dévastateur pour moi, mais ce ne fut pas le cas. Au moment de m’en souvenir, je savais qu’il n’y avait rien là et j’ai commencé à travailler aussi dur que possible pour construire ce que j’aurais dû ressentir.
La fois suivante où je suis allé chez don Juan, je lui ai présenté mes deux échantillons d’événements mémorables dès mon arrivée.
« C’est un tas de bêtises », a-t-il déclaré. « Rien de tout cela ne fera l’affaire. Les histoires sont exclusivement liées à toi en tant que personne qui pense, ressent, pleure ou ne ressent rien du tout. Les événements mémorables de l’album d’un chaman sont des affaires qui résisteront à l’épreuve du temps parce qu’elles n’ont rien à voir avec lui, et pourtant il est au cœur d’elles. Il sera toujours au cœur d’elles, pour la durée de sa vie, et peut-être au-delà, mais pas tout à fait personnellement. »
Ses paroles m’ont laissé abattu, totalement vaincu. Je croyais sincèrement à cette époque que don Juan était un vieil homme intransigeant qui trouvait un plaisir particulier à me faire sentir stupide. Il me rappelait un maître artisan que j’avais rencontré dans la fonderie d’un sculpteur où je travaillais pendant mes études d’art. Le maître artisan avait l’habitude de critiquer et de trouver des défauts à tout ce que faisaient ses apprentis avancés, et exigeait qu’ils corrigent leur travail selon ses recommandations. Ses apprentis se retournaient et faisaient semblant de corriger leur travail. Je me souvenais de la joie du maître lorsqu’il disait, en se voyant présenter le même travail : « Maintenant, vous avez quelque chose de vrai ! »
« Ne te sens pas mal », dit don Juan, me tirant de mes souvenirs. « En mon temps, j’étais dans la même situation. Pendant des années, non seulement je ne savais pas quoi choisir, mais je pensais n’avoir aucune expérience à choisir. Il semblait que rien ne m’était jamais arrivé. Bien sûr, tout m’était arrivé, mais dans mon effort pour défendre l’idée de moi-même, je n’avais ni le temps ni l’envie de remarquer quoi que ce soit. »
« Peux-tu me dire, don Juan, spécifiquement, ce qui ne va pas avec mes histoires ? Je sais qu’elles ne sont rien, mais le reste de ma vie est juste comme ça. »
« Je vais te répéter ceci », dit-il. « Les histoires de l’album d’un guerrier ne sont pas personnelles. Ton histoire du jour où tu as été admis à l’école n’est rien d’autre que ton affirmation de toi comme centre de tout. Tu ressens, tu ne ressens pas ; tu réalises, tu ne réalises pas. Vois-tu ce que je veux dire ? Toute l’histoire n’est que toi. »
« Mais comment pourrait-il en être autrement, don Juan ? » ai-je demandé.
« Dans ton autre histoire, tu touches presque à ce que je veux, mais tu la transformes à nouveau en quelque chose d’extrêmement personnel. Je sais que tu pourrais ajouter plus de détails, mais tous ces détails seraient une extension de ta personne et rien d’autre. »
« Je ne vois sincèrement pas où tu veux en venir, don Juan », ai-je protesté. « Toute histoire vue à travers les yeux du témoin doit être, forcément, personnelle. »
« Oui, oui, bien sûr », dit-il en souriant, ravi comme d’habitude de ma confusion. « Mais alors ce ne sont pas des histoires pour l’album d’un guerrier. Ce sont des histoires à d’autres fins. Les événements mémorables que nous recherchons ont la touche sombre de l’impersonnel. Cette touche les imprègne. Je ne sais pas comment expliquer cela autrement. »
J’ai alors cru avoir un moment d’inspiration et avoir compris ce qu’il voulait dire par la touche sombre de l’impersonnel. Je pensais qu’il voulait dire quelque chose d’un peu morbide. L’obscurité signifiait cela pour moi. Et je lui ai raconté une histoire de mon enfance.
Un de mes cousins plus âgés était en faculté de médecine. Il était interne, et un jour il m’a emmené à la morgue. Il m’a assuré qu’un jeune homme se devait de voir des morts parce que cette vision était très éducative ; elle démontrait la fugacité de la vie. Il m’a harangué, encore et encore, pour me convaincre d’y aller. Plus il parlait de notre peu d’importance dans la mort, plus je devenais curieux. Je n’avais jamais vu de cadavre. Ma curiosité de le voir en a fini par me submerger et je l’ai accompagné.
Il m’a montré divers cadavres et a réussi à me glacer d’effroi. Je n’ai rien trouvé d’éducatif ou d’éclairant à leur sujet. Ils étaient, sans conteste, les choses les plus effrayantes que j’aie jamais vues. Pendant qu’il me parlait, il n’arrêtait pas de regarder sa montre comme s’il attendait quelqu’un qui allait se présenter d’un moment à l’autre. Il voulait manifestement me garder à la morgue plus longtemps que mes forces ne le permettaient. Étant la créature compétitive que j’étais, je croyais qu’il testait mon endurance, ma virilité. J’ai serré les dents et j’ai décidé de rester jusqu’au bout.
La fin amère est arrivée d’une manière que je n’avais pas imaginée. Un cadavre qui était recouvert d’un drap s’est en fait relevé avec un râle sur la table de marbre où gisaient tous les cadavres, comme s’il s’apprêtait à s’asseoir. Il a émis un son de rot qui était si horrible qu’il m’a brûlé de l’intérieur et restera dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Mon cousin, le médecin, le scientifique, a expliqué que c’était le cadavre d’un homme mort de la tuberculose, et que ses poumons avaient été rongés par des bacilles qui avaient laissé d’énormes trous remplis d’air, et que dans des cas comme celui-ci, lorsque l’air changeait de température, il forçait parfois le corps à s’asseoir ou du moins à convulser.
« Non, tu n’as pas encore compris », dit don Juan en secouant la tête. « C’est simplement une histoire sur ta peur. J’aurais été moi-même mort de peur ; cependant, être effrayé comme ça n’illumine le chemin de personne. Mais je suis curieux de savoir ce qui t’est arrivé. »
« J’ai crié comme une banshee », dis-je. « Mon cousin m’a traité de lâche, de mauviette, pour avoir caché mon visage contre sa poitrine et pour avoir été malade sur lui. »
J’avais définitivement accroché à une veine morbide de ma vie. J’ai trouvé une autre histoire à propos d’un garçon de seize ans que je connaissais au lycée, qui avait une maladie glandulaire et qui avait atteint une taille gigantesque. Son cœur n’a pas grandi au même rythme que le reste de son corps et un jour il est mort d’une insuffisance cardiaque. Je suis allé avec un autre garçon au funérarium par curiosité morbide. Le croque-mort, qui était peut-être plus morbide que nous deux, a ouvert la porte de derrière et nous a laissé entrer. Il nous a montré son chef-d’œuvre. Il avait mis le garçon gigantesque, qui mesurait plus de sept pieds sept pouces, dans un cercueil pour une personne normale en lui sciant les jambes. Il nous a montré comment il avait disposé ses jambes comme si le mort les tenait dans ses bras comme deux trophées.
La frayeur que j’ai ressentie était comparable à celle que j’avais ressentie à la morgue dans mon enfance, mais cette nouvelle frayeur n’était pas une réaction physique ; c’était une réaction de révulsion psychologique.
« Tu y es presque », dit don Juan. « Cependant, ton histoire est encore trop personnelle. C’est révoltant. Ça me rend malade, mais je vois un grand potentiel. »
Don Juan et moi avons ri de l’horreur que l’on trouve dans les situations de la vie quotidienne. À ce moment-là, j’étais désespérément perdu dans les brins morbides que j’avais attrapés et relâchés. Je lui ai alors raconté l’histoire de mon meilleur ami, Roy Goldpiss. Il avait en fait un nom de famille polonais, mais ses amis l’appelaient Goldpiss parce que tout ce qu’il touchait, il le transformait en or ; c’était un grand homme d’affaires.
Son talent pour les affaires a fait de lui un être super-ambitieux. Il voulait être l’homme le plus riche du monde. Cependant, il a trouvé que la concurrence était trop rude. Selon lui, en faisant des affaires seul, il ne pouvait pas rivaliser, par exemple, avec le chef d’une secte islamique qui, à cette époque, était payé son poids en or chaque année. Le chef de la secte se goinfrait autant que son corps le lui permettait avant d’être pesé.
Alors mon ami Roy a revu ses ambitions à la baisse pour devenir l’homme le plus riche des États-Unis. La concurrence dans ce secteur était féroce. Il est descendu d’un cran : peut-être pourrait-il être l’homme le plus riche de Californie. Il était trop tard pour ça aussi. Il a perdu l’espoir qu’avec ses chaînes de pizzerias et de glaciers, il pourrait un jour s’élever dans le monde des affaires pour rivaliser avec les familles établies qui possédaient la Californie. Il s’est contenté d’être l’homme le plus riche de Woodland Hills, la banlieue de Los Angeles où il vivait. Malheureusement pour lui, de l’autre côté de la rue de sa maison vivait M. Marsh, qui possédait des usines produisant des matelas de première qualité dans tous les États-Unis, et il était riche au-delà de toute croyance. La frustration de Roy ne connaissait pas de limites. Sa volonté d’accomplir était si intense qu’elle a finalement nui à sa santé. Un jour, il est mort d’une rupture d’anévrisme cérébral.
Sa mort a eu pour conséquence ma troisième visite à une morgue ou un funérarium. La femme de Roy m’a supplié, en tant que son meilleur ami, de m’assurer que le corps était correctement habillé. Je suis allé au salon funéraire, où un secrétaire m’a conduit dans les chambres intérieures. Au moment précis de mon arrivée, le croque-mort, travaillant sur une haute table au plateau de marbre, poussait avec force les coins de la lèvre supérieure du cadavre, qui était déjà entré en rigor mortis, avec l’index et l’auriculaire de sa main droite tout en tenant son majeur contre sa paume. Alors qu’un sourire grotesque apparaissait sur le visage mort de Roy, le croque-mort s’est à moitié tourné vers moi et a dit d’un ton servile : « J’espère que tout cela est à votre satisfaction, monsieur. »
La femme de Roy – on ne saura jamais si elle l’aimait ou non – a décidé de l’enterrer avec tout le tape-à-l’œil que, selon elle, sa vie méritait. Elle avait acheté un cercueil très cher, une affaire sur mesure qui ressemblait à une cabine téléphonique ; elle avait eu l’idée dans un film. Roy allait être enterré assis, comme s’il passait un appel professionnel au téléphone.
Je ne suis pas resté pour la cérémonie. Je suis parti au milieu d’une réaction des plus violentes, un mélange d’impuissance et de colère, le genre de colère qui ne pouvait être déversée sur personne.
« Tu es certainement morbide aujourd’hui », commenta don Juan en riant. « Mais malgré cela, ou peut-être à cause de cela, tu y es presque. Tu y touches. »
Je n’ai jamais cessé de m’émerveiller de la façon dont mon humeur changeait chaque fois que j’allais voir don Juan. J’arrivais toujours d’humeur maussade, grincheux, rempli d’affirmations de soi et de doutes. Au bout d’un moment, mon humeur changeait mystérieusement et je devenais plus expansif, par degrés, jusqu’à ce que je sois aussi calme que je ne l’avais jamais été. Cependant, ma nouvelle humeur était formulée dans mon ancien vocabulaire. Ma façon habituelle de parler était celle d’une personne totalement insatisfaite qui se retient de se plaindre à voix haute, mais dont les plaintes sans fin sont implicites à chaque tournant de la conversation.
« Peux-tu me donner un exemple d’un événement mémorable de ton album, don Juan ? » ai-je demandé de mon ton habituel de plainte voilée. « Si je connaissais le modèle que tu recherches, je pourrais peut-être trouver quelque chose. En l’état, je siffle désespérément dans le noir. »
« Ne t’explique pas autant », dit don Juan avec un regard sévère dans les yeux. « Les sorciers disent que dans chaque explication il y a une excuse cachée. Ainsi, lorsque tu expliques pourquoi tu ne peux pas faire ceci ou cela, tu t’excuses en réalité pour tes lacunes, en espérant que celui qui t’écoute aura la gentillesse de les comprendre. »
Ma manœuvre la plus utile, lorsque j’étais attaqué, avait toujours été de déconnecter mes agresseurs en ne les écoutant pas. Don Juan, cependant, avait la capacité dégoûtante de capturer chaque parcelle de mon attention. Peu importe comment il m’attaquait, peu importe ce qu’il disait, il parvenait toujours à me river à chacun de ses mots. À cette occasion, ce qu’il disait de moi ne me plaisait pas du tout parce que c’était la vérité nue.
J’ai évité ses yeux. Je me sentais, comme d’habitude, vaincu, mais c’était une défaite particulière cette fois. Cela ne me dérangeait pas comme cela l’aurait fait si cela s’était produit dans le monde de la vie de tous les jours, ou juste après mon arrivée chez lui.
Après un très long silence, don Juan m’a de nouveau parlé. « Je ferai mieux que de te donner un exemple d’un événement mémorable de mon album », dit-il. « Je vais te donner un événement mémorable de ta propre vie, un qui devrait certainement figurer dans ta collection. Ou, devrais-je dire, si j’étais toi, je le mettrais certainement dans ma collection d’événements mémorables. »
J’ai pensé que don Juan plaisantait et j’ai ri bêtement. « Ce n’est pas une question de rire », dit-il sèchement. « Je suis sérieux. Tu m’as raconté une fois une histoire qui correspond à la description. »
« Quelle histoire est-ce, don Juan ? »
« L’histoire des « figures devant un miroir » », dit-il. « Raconte-moi encore cette histoire. Mais raconte-la moi avec tous les détails dont tu peux te souvenir. »
J’ai commencé à raconter l’histoire de manière superficielle. Il m’a arrêté et a exigé une narration soignée et détaillée, en commençant par le début. J’ai réessayé, mais mon interprétation ne l’a pas satisfait.
« Allons nous promener », proposa-t-il. « Quand tu marches, tu es beaucoup plus précis que lorsque tu es assis. Ce n’est pas une idée vaine que tu devrais faire les cent pas lorsque tu essaies de raconter quelque chose. »
Nous étions assis, comme nous le faisions habituellement pendant la journée, sous la ramada de la maison. J’avais développé une habitude : chaque fois que je m’asseyais là, je le faisais toujours au même endroit, le dos contre le mur. Don Juan s’asseyait à divers endroits sous la ramada, mais jamais au même endroit.
Nous sommes allés faire une randonnée au pire moment de la journée, à midi. Il m’a équipé d’un vieux chapeau de paille, comme il le faisait toujours lorsque nous sortions sous la chaleur du soleil. Nous avons marché longtemps en silence complet. J’ai fait de mon mieux pour me forcer à me souvenir de tous les détails de l’histoire. C’était en milieu d’après-midi lorsque nous nous sommes assis à l’ombre de quelques grands buissons, et j’ai raconté toute l’histoire.
Des années auparavant, alors que j’étudiais la sculpture dans une école des beaux-arts en Italie, j’avais un ami proche, un Écossais qui étudiait l’art pour devenir critique d’art. Ce qui me frappait le plus chez lui, et qui avait un rapport avec l’histoire que je racontais à don Juan, était l’idée grandiloquente qu’il avait de lui-même ; il se pensait le plus licencieux, le plus lubrique, le plus complet des érudits et des artisans, un homme de la Renaissance. Licencieux il l’était, mais la lubricité était en complète contradiction avec sa personne osseuse, sèche et sérieuse. Il était un adepte par procuration du philosophe anglais Bertrand Russell et rêvait d’appliquer les principes du positivisme logique à la critique d’art. Être un érudit et un artisan complet était peut-être sa plus folle fantaisie car il était un procrastinateur ; le travail était sa némésis.
Sa spécialité douteuse n’était pas la critique d’art, mais sa connaissance personnelle de toutes les prostituées des bordels locaux, qui étaient nombreux. Les récits colorés et longs qu’il me faisait – pour me tenir, selon lui, au courant de toutes les choses merveilleuses qu’il faisait dans le monde de sa spécialité – étaient délicieux. Il n’était donc pas surprenant pour moi qu’un jour il soit venu à mon appartement, tout excité, presque à bout de souffle, et m’ait dit que quelque chose d’extraordinaire lui était arrivé et qu’il voulait le partager avec moi.
« Dites donc, mon vieux, vous devez voir ça par vous-même ! » dit-il avec excitation dans l’accent d’Oxford qu’il affectait chaque fois qu’il me parlait. Il arpentait la pièce nerveusement. « C’est difficile à décrire, mais je sais que c’est quelque chose que vous apprécierez. Quelque chose dont l’impression vous durera toute la vie. Je vais vous faire un merveilleux cadeau pour la vie. Comprenez-vous ? »
J’ai compris qu’il était un Écossais hystérique. C’était toujours un plaisir pour moi de le flatter et de le suivre. Je ne l’avais jamais regretté. « Calme-toi, calme-toi, Eddie », dis-je. « Qu’est-ce que tu essaies de me dire ? »
Il m’a raconté qu’il avait été dans un bordel, où il avait trouvé une femme incroyable qui faisait une chose incroyable qu’elle appelait « les figures devant un miroir ». Il m’a assuré à plusieurs reprises, en bégayant presque, que je me devais de vivre personnellement cet événement incroyable.
« Dites donc, ne vous inquiétez pas pour l’argent ! » dit-il, car il savait que je n’en avais pas. « J’ai déjà payé le prix. Tout ce que vous avez à faire est de venir avec moi. Madame Ludmilla vous montrera ses « figures devant un miroir ». C’est une explosion ! »
Dans un accès de joie incontrôlable, Eddie éclata de rire, oubliant ses mauvaises dents, qu’il cachait normalement derrière un sourire ou un rire aux lèvres pincées. « Je dis que c’est absolument génial ! »
Ma curiosité grandissait de minute en minute. J’étais plus que disposé à participer à son nouveau plaisir. Eddie m’a conduit à la périphérie de la ville. Nous nous sommes arrêtés devant un bâtiment poussiéreux et mal entretenu ; la peinture s’écaillait des murs. Il avait l’air d’avoir été un hôtel à une époque, un hôtel transformé en immeuble d’appartements. Je pouvais voir les restes d’une enseigne d’hôtel qui semblait avoir été mise en pièces. Sur la façade du bâtiment, il y avait des rangées de balcons simples et sales remplis de pots de fleurs ou drapés de tapis mis à sécher.
À l’entrée du bâtiment se trouvaient deux hommes sombres et louches portant des chaussures noires pointues qui semblaient trop serrées à leurs pieds ; ils ont salué Eddie avec effusion. Ils avaient des yeux noirs, fuyants et menaçants. Tous deux portaient des costumes bleu clair brillants, également trop serrés pour leurs corps volumineux. L’un d’eux a ouvert la porte à Eddie. Ils ne m’ont même pas regardé.
Nous avons monté deux volées d’escaliers sur un escalier délabré qui avait dû être luxueux à une époque. Eddie a ouvert la voie et a parcouru un couloir vide, aux allures d’hôtel, avec des portes des deux côtés. Toutes les portes étaient peintes du même vert olive terne et sombre. Chaque porte avait un numéro en laiton, terni par l’âge, à peine visible sur le bois peint.
Eddie s’arrêta devant une porte. J’ai remarqué le numéro 112 dessus. Il a frappé à plusieurs reprises. La porte s’est ouverte, et une femme ronde et petite aux cheveux blonds décolorés nous a fait signe d’entrer sans dire un mot. Elle portait une robe de chambre en soie rouge avec des manches à plumes et froufrous et des pantoufles rouges avec des pompons en fourrure sur le dessus. Une fois que nous fûmes dans un petit hall et qu’elle eut fermé la porte derrière nous, elle salua Eddie dans un anglais terriblement accentué. « Salut, Eddie. Tu as amené un ami, hein ? »
Eddie lui serra la main, puis la baisa, galamment. Il agissait comme s’il était des plus calmes, mais j’ai remarqué ses gestes inconscients de malaise.
« Comment allez-vous aujourd’hui, Madame Ludmilla ? » dit-il, en essayant de sonner comme un Américain et en le ratant.
Je n’ai jamais découvert pourquoi Eddie voulait toujours sonner comme un Américain chaque fois qu’il faisait des affaires dans ces maisons de mauvaise réputation. J’avais le soupçon qu’il le faisait parce que les Américains étaient connus pour être riches, et qu’il voulait établir ses lettres de créance d’homme riche avec elles.
Eddie se tourna vers moi et dit avec son faux accent américain : « Je te laisse entre de bonnes mains, mon petit. »
Il sonnait si mal, si étranger à mes oreilles, que j’ai éclaté de rire. Madame Ludmilla ne sembla pas du tout perturbée par mon explosion d’hilarité. Eddie baisa à nouveau la main de Madame Ludmilla et partit.
« Tu parles anglais, mon garçon ? » cria-t-elle comme si j’étais sourd. « Tu as l’air égyptien, ou peut-être turc. »
J’ai assuré à Madame Ludmilla que je n’étais ni l’un ni l’autre, et que je parlais anglais. Elle m’a alors demandé si j’aimais ses « figures devant un miroir ». Je ne savais pas quoi dire. J’ai simplement hoché la tête affirmativement.
« Je te donne un bon spectacle », m’a-t-elle assuré. « Les figures devant un miroir ne sont que des préliminaires. Quand tu seras chaud et prêt, dis-moi d’arrêter. »
Du petit hall où nous nous trouvions, nous sommes entrés dans une pièce sombre et étrange. Les fenêtres étaient lourdement rideautées. Il y avait quelques ampoules à basse tension sur des appliques fixées au mur. Les ampoules avaient la forme de tubes et sortaient tout droit à angle droit du mur. Il y avait une profusion d’objets dans la pièce : des meubles comme des petites commodes, des tables et des chaises anciennes ; un bureau à cylindre placé contre le mur et rempli de papiers, de crayons, de règles et d’au moins une douzaine de paires de ciseaux. Madame Ludmilla me fit asseoir sur un vieux fauteuil rembourré.
« Le lit est dans l’autre pièce, chéri », dit-elle en montrant l’autre côté de la pièce. « C’est mon antisala. Ici, je donne un spectacle pour te chauffer et te préparer. »
Elle laissa tomber sa robe de chambre rouge, donna un coup de pied à ses pantoufles et ouvrit les doubles portes de deux armoires placées côte à côte contre le mur. Attaché à l’intérieur de chaque porte se trouvait un miroir en pied.
« Et maintenant la musique, mon garçon », dit Madame Ludmilla, puis elle remonta un Victrola qui semblait être en parfait état, brillant, comme neuf. Elle mit un disque. La musique était une mélodie envoûtante qui me rappelait une marche de cirque.
« Et maintenant mon spectacle », dit-elle, et elle commença à tournoyer sur l’accompagnement de la mélodie envoûtante. La peau du corps de Madame Ludmilla était tendue, pour la plupart, et extraordinairement blanche, bien qu’elle ne soit pas jeune. Elle devait avoir la quarantaine bien vécue. Son ventre s’affaissait, pas beaucoup, mais un peu, tout comme ses seins volumineux. La peau de son visage s’affaissait également en bajoues notables. Elle avait un petit nez et des lèvres fortement peintes en rouge. Elle portait un épais mascara noir. Elle me faisait penser au prototype d’une prostituée vieillissante. Pourtant, il y avait quelque chose d’enfantin en elle, un abandon et une confiance de jeune fille, une douceur qui me secoua.
« Et maintenant, les figures devant un miroir », annonça Madame Ludmilla tandis que la musique continuait.
« Jambe, jambe, jambe ! » dit-elle, levant une jambe en l’air, puis l’autre, en rythme avec la musique. Elle avait la main droite sur le dessus de sa tête, comme une petite fille qui n’est pas sûre de pouvoir exécuter les mouvements.
« Tourne, tourne, tourne ! » dit-elle, tournant comme une toupie.
« Fesses, fesses, fesses ! » dit-elle alors, me montrant son derrière nu comme une danseuse de cancan.
Elle a répété la séquence encore et encore jusqu’à ce que la musique commence à s’estomper lorsque le ressort du Victrola s’est déroulé. J’ai eu l’impression que Madame Ludmilla s’éloignait en tournoyant, devenant de plus en plus petite à mesure que la musique s’estompait. Un désespoir et une solitude dont je ne savais pas l’existence en moi ont fait surface, des profondeurs de mon être, et m’ont fait me lever et sortir en courant de la pièce, descendre les escaliers comme un fou, sortir du bâtiment, dans la rue.
Eddie se tenait devant la porte, parlant aux deux hommes en costumes bleu clair brillants. En me voyant courir ainsi, il éclata de rire.
« N’était-ce pas une explosion ? » dit-il, en essayant toujours de sonner comme un Américain. « « Les figures devant un miroir ne sont que les préliminaires. » Quelle chose ! Quelle chose ! »
La première fois que j’avais mentionné l’histoire à don Juan, je lui avais dit que j’avais été profondément affecté par la mélodie envoûtante et la vieille prostituée tournoyant maladroitement sur la musique. Et j’avais également été profondément affecté par la prise de conscience de la cruauté de mon ami.
Quand j’eus fini de raconter mon histoire à don Juan, alors que nous étions assis dans les collines d’une chaîne de montagnes de Sonora, je tremblais, mystérieusement affecté par quelque chose d’assez indéfini.
« Cette histoire », dit don Juan, « devrait figurer dans ton album d’événements mémorables. Ton ami, sans avoir la moindre idée de ce qu’il faisait, t’a donné, comme il l’a dit lui-même, quelque chose qui te durera en effet toute la vie. »
« Je vois cela comme une histoire triste, don Juan, mais c’est tout », ai-je déclaré. « C’est en effet une histoire triste, tout comme tes autres histoires », répondit don Juan, « mais ce qui la rend différente et mémorable pour moi, c’est qu’elle touche chacun de nous, êtres humains, pas seulement toi, comme tes autres récits. Tu vois, comme Madame Ludmilla, chacun de nous, jeunes et vieux, fait des figures devant un miroir d’une manière ou d’une autre. Fais le compte de ce que tu sais sur les gens. Pense à n’importe quel être humain sur cette terre, et tu sauras, sans l’ombre d’un doute, que peu importe qui ils sont, ou ce qu’ils pensent d’eux-mêmes, ou ce qu’ils font, le résultat de leurs actions est toujours le même : des figures insensées devant un miroir. »
(Carlos Castaneda, Le Voyage Définitif)