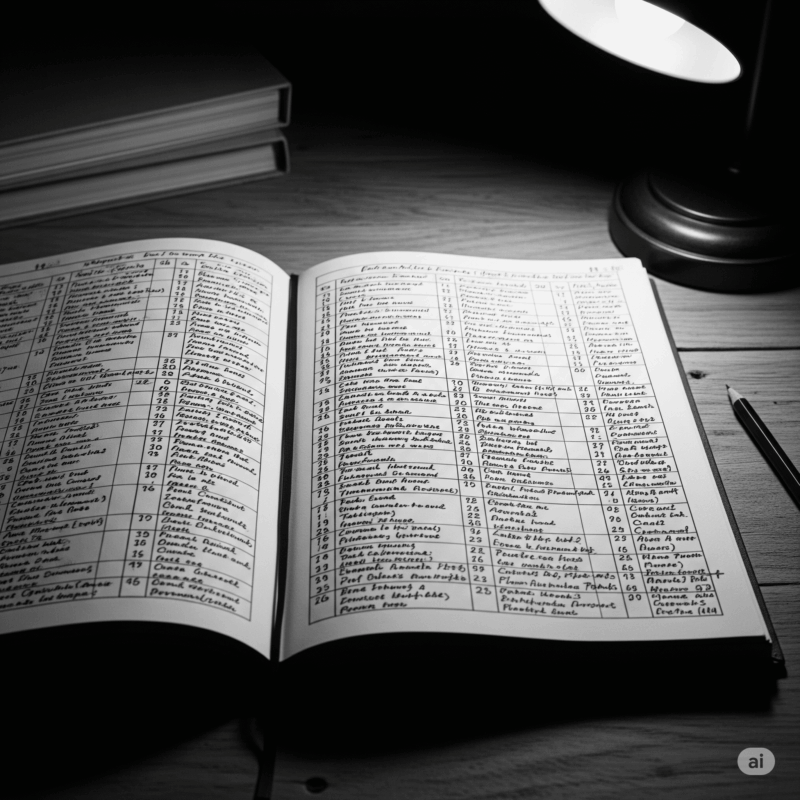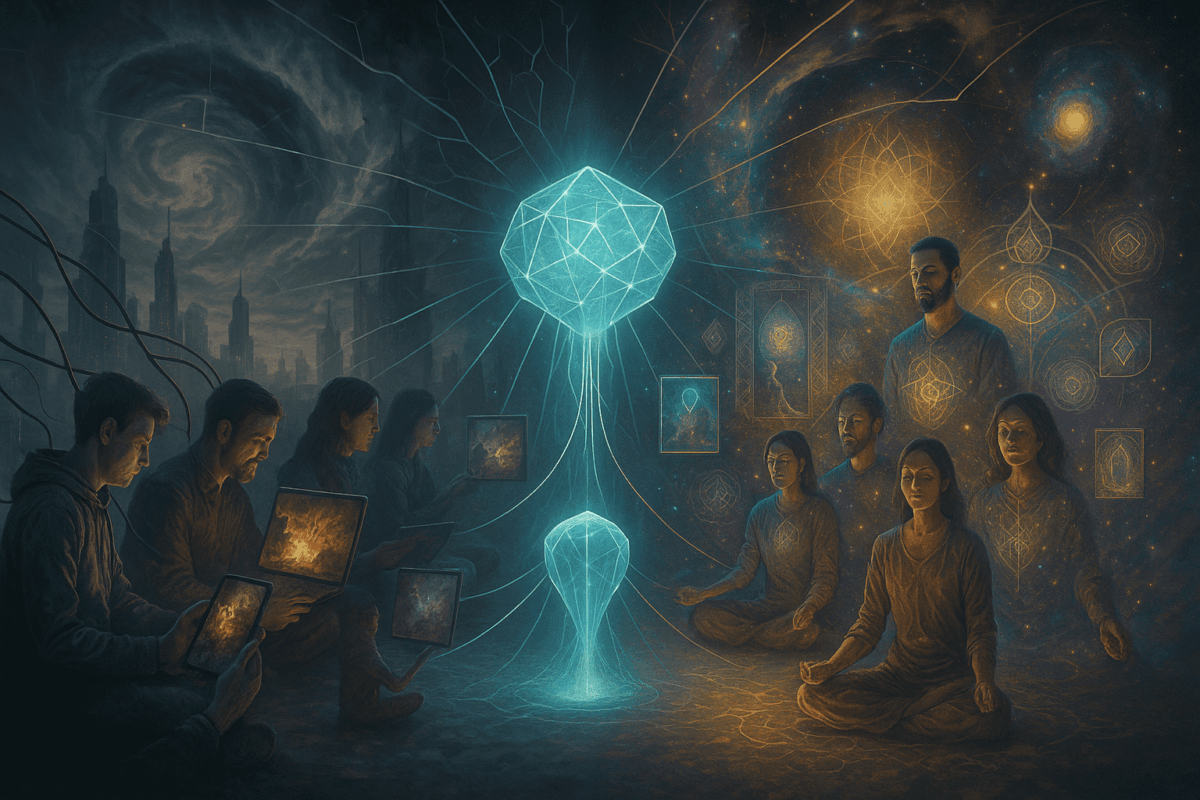Voici la traduction du texte en français, avec les paragraphes et les sauts de ligne corrigés :
« Nous traversons une terre magique, » dit-elle en sirotant le délicieux chocolat, « une terre magique peuplée de guerriers. »
« Quels sont ces guerriers ? » demandai-je, en essayant de ne pas paraître condescendante.
« Les Yaquis de Sonora, » répondit-elle, puis elle se tut, mesurant peut-être ma réaction. « J’admire les Indiens Yaquis car ils ont été constamment en guerre. Les Espagnols d’abord ; puis les Mexicains – aussi récemment qu’en 1934 – ont ressenti la sauvagerie, la ruse et l’implacabilité des guerriers Yaquis. »
« Je n’admire pas la guerre ni les gens belliqueux, » dis-je. Puis, pour m’excuser de mon ton agressif, j’expliquai que je venais d’une famille allemande déchirée par la guerre.
« Ton cas est différent, » soutint-elle. « Tu n’as pas les idéaux de la liberté. »
« Un instant ! » protestai-je. « C’est précisément parce que je défends les idéaux de la liberté que je trouve la guerre si abominable. »
« Nous parlons de deux types de guerre différents, » insista-t-elle.
« La guerre, c’est la guerre, » interjectai-je.
« Ta sorte de guerre, » continua-t-elle, ignorant mon interruption, « est entre deux frères qui sont tous deux des chefs et qui se battent pour la suprématie. » Elle se pencha vers moi, et dans un murmure urgent ajouta : « La sorte de guerre dont je parle est entre un esclave et le maître qui pense qu’il possède les gens. Vois-tu la différence ? »
« Non, je ne la vois pas, » insistai-je obstinément, et je répétai que la guerre était la guerre, quelle qu’en soit la raison.
« Je ne peux pas être d’accord avec toi, » dit-elle, et soupirant bruyamment, elle se pencha en arrière sur son siège. « Peut-être la raison de notre désaccord philosophique, » continua-t-elle, « est que nous venons de réalités sociales différentes. »
Étonnée par son choix de mots, je ralentis automatiquement la voiture. Je ne voulais pas être impolie, mais l’entendre débiter des concepts universitaires était si incongru et inattendu que je ne pus m’empêcher de rire.
Delia ne s’offensa pas. Elle me regarda, souriante, entièrement satisfaite d’elle-même, et dit : « Quand tu auras connu mon point de vue, tu changeras peut-être d’avis. » Elle dit cela si sérieusement et pourtant si gentiment que je me sentis honteuse d’avoir ri d’elle. « Tu pourras même t’excuser d’avoir ri de moi, » ajouta-t-elle comme si elle avait lu dans mes pensées.
« Je te prie de m’excuser, Delia, » dis-je et je le pensais sincèrement. « Je suis terriblement désolée de mon impolitesse. J’ai été si surprise par tes déclarations que je n’ai pas su quoi faire. » Je la regardai brièvement, et ajoutai avec contrition : « Alors j’ai ri. »
« Je ne parle pas d’excuses sociales pour ta conduite, » dit-elle, secouant la tête de déception. « Je parle d’excuses pour ne pas avoir compris le sort de l’homme. »
« Je ne sais pas de quoi tu parles, » dis-je avec malaise. Je pouvais sentir ses yeux me transpercer.
« En tant que femme, tu devrais très bien comprendre ce sort, » dit-elle. « Tu as été une esclave toute ta vie. »
« De quoi parles-tu, Delia ? » demandai-je, irritée par son impertinence. Puis je me calmai immédiatement, certaine que la pauvre Indienne avait sans doute un mari insupportable et accablant. « Crois-moi, Delia, je suis tout à fait libre. Je fais ce que je veux. »
« Tu peux faire ce que tu veux, mais tu n’es pas libre, » persista-t-elle. « Tu es une femme, et cela signifie automatiquement que tu es à la merci des hommes. »
« Je ne suis à la merci de personne ! » criai-je.
Je ne savais pas si c’était mon affirmation ou le ton de ma voix qui fit éclater Delia de rire aux éclats. Elle rit de moi aussi fort que j’avais ri d’elle auparavant.
« Tu sembles savourer ta vengeance, » dis-je, agacée. « C’est ton tour de rire maintenant, n’est-ce pas ? »
Soudain sérieuse, elle dit : « Ce n’est pas du tout la même chose. Tu as ri de moi parce que tu te sentais supérieure. Un esclave qui parle comme un maître ravit toujours le maître un instant. »
J’essayai de l’interrompre et de lui dire qu’il ne m’était même pas venu à l’esprit de la considérer comme une esclave, ou de me considérer comme un maître, mais elle ignora mes efforts. Dans le même ton solennel, elle dit que la raison pour laquelle elle avait ri de moi était que j’avais été rendue stupide et aveugle à ma propre féminité.
« Qu’est-ce qui t’arrive, Delia ? » demandai-je, perplexe. « Tu m’insultes délibérément. »
« Certainement, » admit-elle volontiers et elle gloussa, complètement indifférente à ma colère montante. Elle me frappa le genou d’une claque retentissante. « Ce qui me préoccupe, » continua-t-elle, « c’est que tu ne sais même pas que par le simple fait que tu es une femme, tu es une esclave. »
Rassemblant toute la patience dont j’étais capable, je dis à Delia qu’elle se trompait : « Personne n’est esclave de nos jours. »
« Les femmes sont des esclaves, » insista Delia. « Les hommes asservissent les femmes. Les hommes embrument les femmes. Le désir des hommes de marquer les femmes comme leur propriété nous embrume, » déclara-t-elle. « Ce brouillard nous pend au cou comme un joug. »
Mon regard vide la fit sourire. Elle s’allongea sur le siège, les mains croisées sur la poitrine. « Le sexe embrume les femmes, » ajouta-t-elle doucement, mais avec emphase. « Les femmes sont si complètement embrumées qu’elles ne peuvent pas envisager la possibilité que leur faible statut dans la vie soit le résultat direct de ce qui leur est fait sexuellement. »
« C’est la chose la plus ridicule que j’aie jamais entendue, » prononçai-je. Puis, plutôt lourdement, je me lançai dans une longue diatribe sur les raisons sociales, économiques et politiques du faible statut des femmes. Longuement, je parlai des changements qui avaient eu lieu au cours des dernières décennies ; comment les femmes avaient réussi à lutter contre la suprématie masculine. Agacée par son expression moqueuse, je ne pus m’empêcher de remarquer qu’elle était sans doute influencée par ses propres expériences ; par sa propre perspective temporelle.
Tout le corps de Delia tremblait d’un rire contenu. Elle fit un effort pour se contenir et dit : « Rien n’a vraiment changé. Les femmes sont des esclaves. Nous avons été élevées pour être des esclaves. Les esclaves instruites sont maintenant occupées à dénoncer les abus sociaux et politiques commis contre les femmes. Aucune des esclaves, cependant, ne peut se concentrer sur la racine de son esclavage—l’acte sexuel—à moins qu’il n’implique un viol ou qu’il ne soit lié à une autre forme d’abus physique. » Un petit sourire fendit ses lèvres lorsqu’elle dit que les hommes religieux, les philosophes et les hommes de science ont maintenu pendant des siècles, et bien sûr le font toujours, que les hommes et les femmes doivent suivre un impératif biologique donné par Dieu, qui a directement trait à leurs capacités sexuelles reproductives.
« Nous avons été conditionnées à croire que le sexe est bon pour nous, » souligna-t-elle. « Cette croyance et cette acceptation inhérentes nous ont empêchées de poser la bonne question. »
« Et quelle est cette question ? » demandai-je, m’efforçant de ne pas rire de ses convictions totalement erronées.
Delia ne sembla pas m’avoir entendue. Elle resta silencieuse si longtemps que je crus qu’elle s’était assoupie. Je fus surprise lorsqu’elle dit : « La question que personne n’ose poser est : qu’est-ce que le fait de se faire monter nous fait, à nous les femmes ? »
« Vraiment, Delia, » la réprimandai-je avec une fausse consternation.
« L’embrumement des femmes est si total que nous nous concentrons sur toutes les autres questions de notre infériorité, sauf celle qui en est la cause, » soutint-elle.
« Mais, Delia, nous ne pouvons pas vivre sans sexe, » ris-je. « Qu’arriverait-il à l’espèce humaine si nous ne… »
Elle arrêta ma question et mon rire d’un geste impératif de sa main.
« De nos jours, des femmes comme toi, dans leur zèle pour l’égalité, imitent les hommes, » dit-elle. « Les femmes imitent les hommes à un degré si absurde que le sexe qui les intéresse n’a rien à voir avec la reproduction. Elles assimilent la liberté au sexe, sans jamais considérer ce que le sexe fait à leur bien-être physique et émotionnel. Nous avons été si complètement endoctrinées que nous croyons fermement que le sexe est bon pour nous. » Elle me donna un coup de coude, puis, comme si elle récitait une litanie, elle ajouta sur un ton chantant : « Le sexe est bon pour nous. C’est agréable. C’est nécessaire. Cela soulage la dépression, la répression et la frustration. Cela guérit les maux de tête, l’hypotension et l’hypertension. Cela fait disparaître les boutons. Cela fait grossir tes seins et tes fesses. Cela régule ton cycle menstruel. Bref, c’est fantastique ! C’est bon pour les femmes. Tout le monde le dit. Tout le monde le recommande. » Elle marqua une pause, puis prononça avec une finalité dramatique : « Une baise par jour éloigne le docteur pour toujours. »
Je trouvai ses déclarations terriblement amusantes, mais je me repris brusquement en me souvenant comment ma famille et mes amis, y compris notre médecin de famille, avaient suggéré – pas si crûment, bien sûr – le sexe comme remède à tous les maux adolescents que j’avais eus en grandissant dans un environnement strictement répressif. Le médecin avait dit qu’une fois mariée, j’aurais des cycles menstruels réguliers. Je prendrais du poids. Je dormirais mieux. Je serais de caractère doux.
« Je ne vois rien de mal à désirer le sexe et l’amour, » dis-je défensivement. « Quelle que soit mon expérience en la matière, je l’ai beaucoup aimée. Et personne ne m’embrume. Je suis libre ! Je choisis qui je veux et quand je veux. »
Il y eut une étincelle de joie dans les yeux sombres de Delia quand elle dit : « Le fait que tu choisisses ton partenaire ne change en rien le fait que tu te fasses baiser. » Puis, avec un sourire, comme pour atténuer la rudesse de son ton, elle ajouta : « Assimiler la liberté au sexe est l’ironie suprême. L’embrumement par les hommes est si complet, si total, qu’il nous a ôté l’énergie et l’imagination nécessaires pour nous concentrer sur la véritable cause de notre asservissement. » Elle insista : « Vouloir un homme sexuellement ou tomber amoureuse de lui romantiquement sont les deux seuls choix offerts aux esclaves. Et tout ce qu’on nous a dit sur ces deux choix n’est rien d’autre que des excuses qui nous entraînent dans la complicité et l’ignorance. »
J’étais indignée contre elle. Je ne pouvais m’empêcher de penser qu’elle était une sorte de mégère refoulée, qui détestait les hommes.
« Pourquoi n’aimes-tu pas tant les hommes, Delia ? » demandai-je sur mon ton le plus cynique.
« Je ne les déteste pas, » m’assura-t-elle. « Ce à quoi je m’oppose passionnément, c’est notre réticence à examiner à quel point nous sommes profondément endoctrinées. La pression exercée sur nous est si féroce et si moralisatrice que nous sommes devenues des complices consentantes. Quiconque ose s’opposer est rejeté et moqué comme un misandre ou un monstre. »
Rouge, je la regardai subrepticement. Je décidai qu’elle pouvait parler si dédaigneusement du sexe et de l’amour parce qu’elle était, après tout, vieille : les désirs physiques étaient tous derrière elle.
Riant doucement, Delia mit ses mains derrière sa tête. « Mes désirs physiques ne sont pas derrière moi parce que je suis vieille, » confia-t-elle, « mais parce qu’on m’a donné la chance d’utiliser mon énergie et mon imagination pour devenir quelque chose de différent de l’esclave que j’ai été élevée à être. »
Je me sentis profondément insultée plutôt que surprise qu’elle ait lu mes pensées. Je commençai à me défendre, mais mes mots ne firent que déclencher plus de rires. Dès qu’elle s’arrêta, elle se tourna vers moi. Son visage était aussi sévère et sérieux que celui d’une maîtresse sur le point de gronder un élève. « Si tu n’es pas une esclave, comment se fait-il qu’ils t’aient élevée pour être une Hausfrau ? » demanda-t-elle. « Et comment se fait-il que tu ne penses qu’à heiraten, et à ton futur Herr Gemahl qui dich mitnehmen ? »
Je ris si fort à son utilisation de l’allemand que je dus arrêter la voiture de peur d’avoir un accident. Plus intéressée à découvrir où elle avait si bien appris l’allemand, j’oubliai de me défendre de ses remarques peu flatteuses selon lesquelles tout ce que je voulais dans la vie était de trouver un mari qui m’emporterait. Cependant, malgré mes supplications insistantes, elle ignora avec dédain mon intérêt pour son allemand.
« Toi et moi aurons amplement le temps de parler de mon allemand plus tard, » m’assura-t-elle. Elle me regarda d’un air moqueur et ajouta : « Ou de ton fait d’être une esclave. » Avant que j’aie eu la chance de répliquer, elle suggéra que nous parlions de quelque chose d’impersonnel.
(Florinda Donner, Les Portes du Rêve)